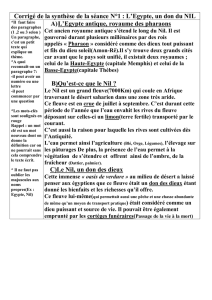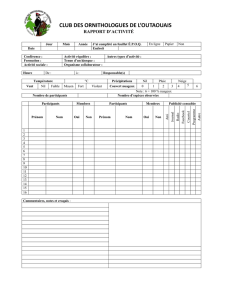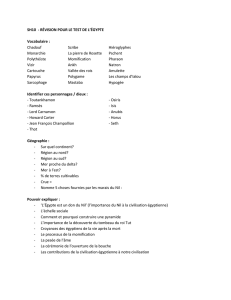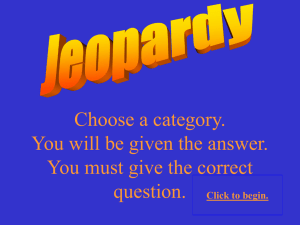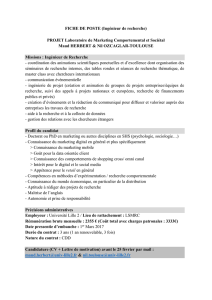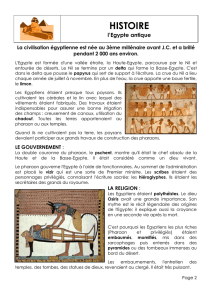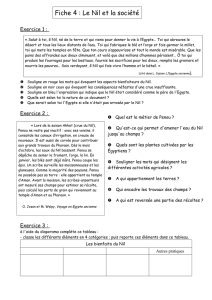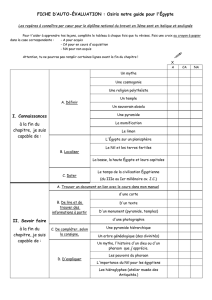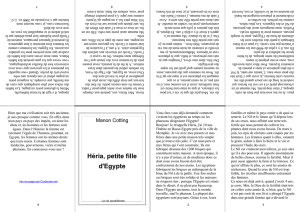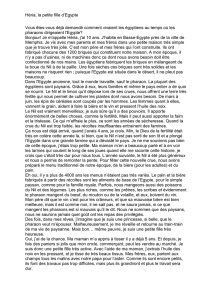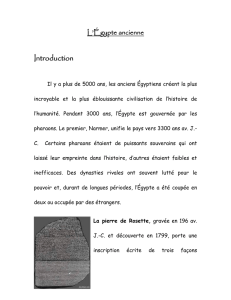LE NIL

1
LE NIL
Le mot Nil vient du grec Νειλος (Neilos) signifiant la « vallée de la rivière ».
Les Egyptiens anciens l’appelaient iteru ce qui signifie la « grande rivière ». Le Nil est
un fleuve de 6671 kilomètres. C’est le deuxième fleuve le plus long du monde après
l’Amazone. Il traverse l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la
République démocratique du Congo, l’Erythrée, le Soudan et l’Egypte. En 1992, le
docteur Boutros-Ghali, Secrétaire général des Nations Unies, déclara : « le prochain
conflit dans la région du Proche-Orient portera sur la question de l’eau(…) L’eau
deviendra une ressource plus précieuse que le pétrole. » A l’heure actuelle alors que
l’on entend souvent parler de possibles guerres de l’eau on peut donc se demander
de quelle manière le Nil, qui traverse tant de pays, illustre le problème de l’eau dans
le monde.
Tout d’abord nous présenterons le bassin fluvial du Nil qui est un cadre physique
précis. Puis nous vous décrirons l’évolution des relations entretenues par l’Homme
avec le Nil depuis l’Antiquité. Enfin nous vous montrerons les enjeux de la gestion et
du partage des eaux du Nil.
I. Un cadre physique précis, le bassin fluvial du
Nil
Les 6 671 km du Nil en font un des fleuves les plus longs du monde. Son
immense bassin de 2 870 000 km² est inégalement partagé entre 9 pays (Egypte,
Ethiopie, Soudan, Burundi, Rwanda, Erythrée, Kenya, Ouganda et Tanzanie), qui
dépendent de manière plus ou moins importante de ses eaux. Pour saisir
l’importance des enjeux de l’eau dans cette région du monde, il est nécessaire de
situer le Nil dans un cadre physique précis, d’en décrire ses caractéristiques.
1. Le bassin nilotique et ses Nils
A) Un cadre naturel contraignant
Le bassin du Nil est un espace de transition entre 2 régimes climatiques, du
Sud au Nord : une zone équatoriale en Afrique Orientale, une zone tropicale puis une
zone désertique et avant de se jeter dans la Mer, une zone de type tempéré
méditerranéen.
Les précipitations que reçoit le littoral sont comprises entre 100 et 400 mm
d’eau par an et dans les immenses zones désertiques qui atteignent le littoral et
s’étendent bien après le Tropique du Cancer, elles sont de l’ordre de 100 mm par an.
Et dans la zone tropicale, elles sont de l’ordre de 400 à 600 mm d’eau par an, mais
n’atteignent que très localement les 600 mm. Les précipitations sont trop faibles.

2
Mais elles sont aussi irrégulières :
- dans l’année, les pluies tombent quand la végétation est ralentie autrement dit
lorsqu’elle en a le moins besoin, il y a donc nécessité de stocker l'eau l'hiver pour
l'utiliser l’été.
- d'une année sur l'autre le total pluviométrique peut varier dans de très fortes
proportions et comme le total annuel moyen est faible il faut donc stocker l'eau
d'une année sur l'autre.
Le climat est aride. Les températures sont élevées et l’amplitude annuelle ainsi
que l’amplitude diurne sont fortes.
Les conditions climatiques influent directement sur les écoulements. Les
régimes du cours d'eau sont très irréguliers : de très fortes crues, extrêmement
brutales, soudaines, s'opposent à des étiages très creusés en été.
On peut parler d’un climat « agressif ».
B) Le Nil Blanc, source lointaine du Nil
Deux sources à l’origine de ce bras du fleuve :
- la source Kasumo (2 050m d’altitude) provenant du Mont Moujoumbiro au Burundi
donne naissance à la Kagera qui se jette dans le lac Victoria (1 300m d’altitude). De
là coule le Nil Victoria qui va jusqu’au lac Mobutu (ou lac Albert)
- une source à 5 119 m d’altitude, provenant des monts Ruwenzori en Ouganda,
alimente avec d’autres torrents la rivière Semliki qui, après les lacs Edouard et
George, se jette dans le Nil Victoria au sortir du lac Mobutu.
Le Nil Victoria devient ensuite le Nil Albert au sortir du lac du même nom. Il est
alimenté par les pluies du climat équatorial. Mais en pénétrant au Soudan, le Nil
Blanc est appelé le Bahr el-Gebel, c'est-à-dire le « Nil de la Montagne ».
Au Soudan, le Bahr el-Gebel s’étale dans une cuvette : ce sont les marais
du Sudd, Sudd signifiant « obstacle » en arabe.
Il s’agit d’une zone mal drainée, une plaine argileuse immense, qui s’étend sur 320
km de long et 240 km de large. Ce sont des marais de roseaux, de papyrus où les
plantes aquatiques forment de vrais barrages… La surface d’eau passe de 10 000 à
30 000 km² lorsque les pluies tombent (de mai à septembre). Ici l’évaporation est
gigantesque : 14 milliards de m3 d’eau sont perdus chaque année, soit plus de la
moitié du débit du fleuve. Ainsi le fleuve perd-il plus d’eau dans le Sudd que dans les
3000 km du désert de Nubie.
Au sortir des marais, le Bahr el-Gebel reçoit le Bahr el-Ghazal, une rivière
permanente. À ce confluent, le fleuve devient le Nil Blanc (ou Bahr el-Abiad). Il
traverse alors une zone tropicale aride et ne reçoit aucun affluent jusqu’à Khartoum
(capitale du Soudan), située à 800 km au Nord du confluent.
C’est le Nil Blanc qui assure l’essentiel du débit du Nil en hiver, c'est-à-dire
de juin à septembre.
C) Le Nil Bleu ou pourquoi le Nil est un don de l’Ethiopie
En Ethiopie, le Nil Bleu ou l’Abbey pour les Ethiopiens, prend sa source à
2900 m d’altitude, dans les montagnes de l’Agaumeder puis rejoint le lac Tana
(1840m d’altitude). Il est long de 1530 km et traverse le Soudan pour fournir au Nil
Blanc 59% de son débit. Le Nil Bleu fournit les caractéristiques essentielles du Nil

3
grâce à ses crues impressionnantes qui apportent d’énormes masses de sédiments
boueux : les limons.
Avec ses affluents, il apporte même 86% des eaux atteignant l’Egypte.
Comme l’Ethiopie n’utilise pour l’instant que 0,3% du débit du Nil Bleu pour irriguer
seulement 2% de ses terres arables, la situation de ce pays ne peut qu’inquiéter les
pays en aval.
À Khartoum, se forme le Nil, à 2700 km de son embouchure, par la rencontre
du Nil Bleu et du Nil Blanc.
D) Vers le Nil égyptien
Le Nil parcourt 2700 km à travers le
désert, dont 1 250 km sur le territoire
égyptien. À la hauteur d’Assouan, le fleuve est
à 87m d’altitude et il lui reste encore 1180 km
à parcourir. Une bande verte et fertile s’étale
de chaque côté de ses berges mais ne
dépasse pas en générale la dizaine de
kilomètres.
Le Nil des cataractes va du confluent
du Nil Blanc et du Nil Bleu jusqu’à Assouan,
traçant un gigantesque S qui le conduit
jusqu'à la frontière égyptienne. Ses cataractes
sont des rapides plutôt que des chutes d’eau.
Ils sont dus à des encombrements rocheux
dans le lit du fleuve. Les cataractes sont au
nombre de 6, elles rendent parfois la
navigation difficile et dangereuse mais ne
l’interrompent pas.
Au-delà de la 6e cataracte, la plus en amont,
le Nil reçoit son dernier affluent l'Atbara qui
représente 13% du débit du fleuve.
Mais aujourd’hui la première et la deuxième
cataracte ont été englouties par le barrage
d’Assouan et celui de Merowe devait engloutir
la quatrième mais il est toujours possible d’en
observer le début.
Les cataractes sur le Nil

4
Profil longitudinal du Nil
Après le Caire, c’est le delta du Nil, avec 24 000 km2 et 260 km de côte
entre Rosette et Damiette. Initialement composé de sept branches principales, le
delta n’en possède plus que deux qui ont résisté à l’assèchement ou au comblement
: le bras de Rosette à l’ouest du delta et le bras de Damiette à l’Est. A l’embouchure
du fleuve, 3 milliards de m3 d’eau/an arrive en Méditerranée alors que le potentiel du
Nil est de 54 milliards de m3. Il comporte aussi quatre canaux principaux d’irrigation
et 24 000 canaux de drainage et d’irrigation qui permettent l’exploitation des terres
agricoles du delta. La densité de population y est l’une des plus fortes du monde :
1600 habitants/km².
2. Les aménagements sur le fleuve face à une
demande toujours croissante
Par exemple, en Egypte, l’eau est actuellement utilisée pour 83% par
l’agriculture, 4.5% par le secteur industriel, et 6% pour la consommation urbaine. La
population égyptienne connaît un taux de croissance de 1,8% par an, la disponibilité
hydraulique doit être augmentée si le pays veut éviter la pénurie. Or toute l’eau vient
directement ou indirectement du Nil. Ce pays est totalement dépendant de son fleuve
et pour s’assurer un volume d’eau suffisant l’Egypte comme d’autres pays, a
aménagé le Nil.
A) Les barrages sur le fleuve
a) Le Haut Barrage d’Assouan, un ouvrage gigantesque
Avant le barrage
Le régime moyen annuel du Nil lorsqu’il entre en Egypte est de 84 milliards de m3/an
soit 2 700 m3/s, ce qui est faible si on le compare aux 6 000 milliards de m3 de
l'Amazone. Au Caire il n’est plus que de 2000 m3/s. Le Nil s’affaiblit tout au long de
son parcours. La «crue» du Nil submerge la vallée au cœur et à la fin de l'été, c'est-
à-dire au bon moment. Le débit en mai est de 520 m3/s, il grimpe à 8 500 m3 en

5
septembre. Avant les aménagements récents, l'élévation du plan d'eau était de 8 à
10 mètres à Assouan, de 6 à 8 mètres au Caire. La dernière crue du Nil a eut lieu en
1964.
Le barrage Sadd el Ali:
Les travaux ont débuté en 1959, à 7 km en amont du premier barrage d’Assouan.
Sadd el Ali est ancré sur une étroite gorge granitique, il fait 3600 mètres de long, 980
mètres d'épaisseur à la base, 40 mètres au sommet, 111 mètres de haut. Son
réservoir s’étend sur plus de 500 km en amont et constitue le lac Nasser de 12 km de
large et d’une superficie de 6500 km2 (soit 11 fois celle du Léman). Sa capacité de
retenue est gigantesque : elle est de 168 km3, dont 30 km3 destinés à stocker les
limons sur 500 ans, et 48 km3 pour faire face aux crues exceptionnelles. Les 90 km3
restants correspondent au débit moyen charrié par le fleuve qui est de 84 km3/an. 10
à 15 km3 se perdent par évaporation dans le lac Nasser, dont 1/3 est situé au Soudan
et le reste en Egypte.
Inauguré en 1971, il ne fonctionne vraiment que depuis 1975.
Trois buts étaient recherchés pour ce projet : l’extension des superficies irriguées,
l’amélioration de la navigation, la production d’électricité.
Le barrage a permis le passage d’une agriculture saisonnière à un calendrier agricole
qui s’étend sur plus de 11 mois pour tout le territoire égyptien. La culture du riz se
généralise, elle a lieu pendant l’été. Mais c’est une culture très consommatrice d’eau,
qui est aujourd’hui montrée du doigt par le gouvernement et qui cherche à limiter son
développement. Toutefois l’agriculture reste peu mécanisée, mais est néanmoins très
intensive.
La crue est aujourd’hui totalement maîtrisée.
b) Les autres barrages
Sur le Nil Blanc, on compte trois barrages : en Ouganda, celui d’Owen
datant de 1954 et au Soudan, en amont de Khartoum celui de Djebel Aulia (1937) et
en aval de Khartoum celui de Merowe, terminé en avril 2008. Djebel Aulia, d’une
capacité de 3,5 milliards de m3, compense les effets du barrage de Sennar : il retient
la crue de la Sobat (affluent provenant d’Ethiopie) et permet de soutenir le débit du
Nil en Égypte d'octobre à février. Plusieurs projets ou barrages en construction se
situent en aval de celui-ci (deux en Ouganda et un autre au Soudan avant les marais
du Sudd).
Sur le Nil Bleu, on compte 3 barrages : le premier, celui de Finchaa (1962) se
situe en Ethiopie tandis que les deux autres ont été construits au Soudan, celui de
Roseires en 1966 et celui de Sennar (1925, 1958). Ce dernier, avec sa retenue de
800 millions de m3, permet de stocker l'eau des crues dont a besoin l'agriculture
soudanaise. Mais en contrepartie, le Soudan renonce à tout prélèvement entre
janvier et juillet. De plus il est, avec le barrage de Kahshm el-Girba (1964) sur
l’Atbara, une réponse du Soudan au Haut Barrage d’Assouan. Et depuis avril 2008 le
barrage de Merowe fonctionne.
Mais c’est surtout l’Egypte qui a totalement domestiqué le fleuve avec 8
barrages dont 3 entre le premier barrage d’Assouan et le barrage du delta. Ensuite
en aval du Caire il y a un barrage sur chaque bras du delta, datant tous les deux du
XIXème siècle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%