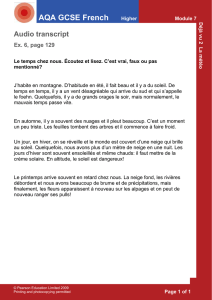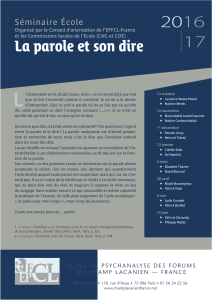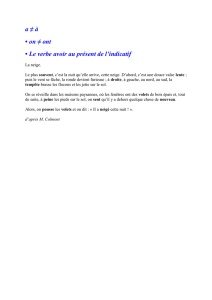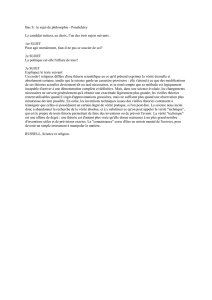146. Pourquoi tout ce qui n`est pas femme serait-il homme

« POURQUOI TOUT CE QUI N’EST PAS FEMME
SERAIT-IL HOMME
1
? »
Notre époque est portée à toiser de haut les siècles et presque les millénaires qui l’ont
précédée du fait de se sentir libérée du lourd fardeau de la procréation comme raison sans appel du
rapport sexuel. Être homme ou être femme ne s’est compris, dans l’ère judéo-chrétienne qui est la
nôtre, que dans cet axe reproductif – quelles que fussent les subtilités religieuses, sociologiques,
politiques, psychologiques ou morales qui ont diversement entouré cette bipartition au fil des temps.
Au point qu’au cours de la grande réforme grégorienne, durant laquelle la papauté catholique,
apostolique et romaine établit son pouvoir politique auprès des États naissants entre le XI et le XIIIe
siècles, fut inventé le terme « sodomie
2
» pour désigner TOUS les comportements sexuels qui ne
visaient pas à « mettre la semence dans le bon vase ». Cette parfaite adéquation, toujours disponible,
et remise en selle par la psychiatrie scientifisante de la fin du XIXe siècle avec sa découverte de
l’« instinct génésique » (d’où elle s’empressa de tirer le concept de « perversion ») est aujourd’hui
battue en brèche, tant du côté de la médecine avec ses contraceptifs et ses procréations diversement
assistées, que du côté des minorités agissantes qui entendent plus que jamais vivre une sexualité
hors les voies de la reproduction. La psychanalyse n’est certes pas pour rien dans ce vaste virage
puisqu’elle a vulgarisé l’idée selon laquelle la sexualité est une composante centrale de l’identité
psychique, indépendamment de la procréation puisqu’elle est tenue pour aller bien en deçà et bien
au-delà de la génitalité inhérente à la conjonction des gamètes. Si l’on ajoute à cela l’immense vague
du féminisme qui, bien que commencée vers le milieu du XIXe siècle, n’en est encore qu’à ses débuts
dans les bouleversements sociaux qu’elle promet, alors oui, on se dit que le strict rabattage de la
répartition des rôles sexuels sur l’impératif reproductif a fait long feu. Sept milliards d’humains
aujourd’hui, quinze à l’horizon 2100 ! Il semble qu’on puisse se préoccuper d’autre chose au moment
de forniquer que de transmettre la vie. Le danger a changé de côté, l’écologie nous en rebat les
oreilles. Ah ! le temps où la terre débordait de forêts oxygénantes et où, à plein poumons, on pouvait
baiser dans les clairières et les alcôves sans autre souci officiel que celui de perpétuer l’espèce ! À
l’inverse, et désormais, la surpopulation, voilà le risque majeur. Mais tout cela maintient le rut dans les
rets de la routine qui ne lit dans « femme » que « femelle ».
1
Jacques Lacan, … ou Pire, séance du 10 mai 1972.
2
Ce n’est que bien plus tard que ce terme, inventé par Pierre Damien en 1050, prit un sens sexuel plus
« technique », désignant alors plus spécifiquement le rapport sexuel anal, plutôt entre hommes. Pour la création
du terme, voir Mark. D. Jordan, L’invention de la sodomie dans la théologie médiévale, Paris, Épel, 2005, trad.
Guy Le Gaufey. Pour le rétrécissement du sens sexuel du terme à Florence au XVe siècle : Michael Rocke,
Forbidden Friendships, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 19-80.

« Pourquoi tout ce qui n’est pas femme… », p. 2
Je n’oublierai pas, dans ce qui suit, que la première parle, et la seconde non
3
, ce qui introduit
une rupture décisive entre les deux. Mais cette rupture intervient, si je puis dire, verticalement, au
sens où la première est installée aux lieu et place de la seconde, que cela lui importe ou pas, ni plus
ni moins que son comparse dans l’affaire de la procréation, l’homme donc, est lui-même installé aux
lieu et place du mâle. La latitude de mouvement qu’homme et femme possèdent au regard de cette
assignation dans l’espèce ne les libère pas pour autant de cette même assignation dans laquelle ils se
trouvent pris, moins réellement que discursivement.
Je ne prétends pas pour autant que le sexe soit construit, comme l’est de toute évidence le
genre, mais je ne pense pas non plus qu’il joue comme un élément réel qui s’imposerait hors langage
à tout être humain, et de ce seul fait vaudrait comme une vérité ultime, imparable. Dans sa réalité
génétique, hormonale, physiologique, physique et caractérielle, le sexe constitue une donne, comme
on dit au jeu de cartes, mais cela n’indique à personne comment va se jouer la partie qui ainsi
s’annonce. J’accepterai donc volontiers qu’on le tienne pour une série d’éléments réels, si du moins
on convient en retour de ne pas confondre si vite à cet endroit réel et vérité. Cela est difficile,
entraînés que nous sommes tous à considérer comme vrais les jugements qui établissent l’existence
d’éléments ou d’événements tenus pour « réels ». Le succès actuel d’un mot comme
« incontournable » est un des signes forts de cette conviction qui soude vérité et réel, puisque, de fait,
on est poussé à penser qu’elle se règle sur lui (théorie de l’adequatio). Pour inéliminable que soit le
cas, il n’est pas le seul à régler le fonctionnement du concept de vérité, et les considérations
prétendument « réalistes » sur « le sexe » le montrent à l’envi pour autant qu’elles révèlent à l’examen
un certain nombre de postulats logiques et rhétoriques qui pèsent lourd dans la balance.
Que l’on compare donc, pour commencer, la définition de cette vérité comme adequatio selon
Tarski
4
: « ‘La neige est banche’ est vrai si et seulement si la neige est blanche », avec l’un de ses
deux équivalents sexués : « ‘Je suis une femme’ est vrai si et seulement si je suis une femme ». La
difficulté de la comparaison tient d’abord à l’appréciation de l’accès à l’élément factuel. Que la neige
soit blanche est conçu comme fait d’observation directe pour lequel seul l’aveugle et le daltonien se
trouveront disqualifiés. Que je sois une femme sera tenu pour un fait de même force si l’on se donne
une lecture chromosomique du corps que « je » dit être sien : XX ou XY ne laisse place à aucun tiers.
À minima, l’inspection de la zone génitale paraît passible de la même logique disjonctive, les cas
d’hermaphrodisme ne constituant pas à eux seuls des cas d’espèce qui permettraient de jeter un
3
Pour ce qui est de la femelle en tant qu’elle ne parle pas, et de son rapport au mâle dans la perspective de la
reproduction, on se reportera au livre époustouflant de Thierry Lodé, La Guerre des sexes chez les animaux,
Paris, Odile Jacob, poches sciences, 2011. L’incroyable diversité des comportements animaux relativement à la
rencontre sexuelle défie l’imagination, et ce que tout le monde sait sur les comportements cannibales de la mante
religieuse ne constitue qu’une infime et superficielle partie de l’iceberg.
4
En sus de l’introduction à son article extrêmement technique « Le concept de vérité dans les langages
formalisés » (Alfred Tarski, Logique, sémantique, métamathématique, Paris, Armand Colin, 1972, p. 157-269,
tome 1), on peut aussi se reporter à son article, plus abordable, « La conception sémantique de la vérité et les
fondements de la sémantique », p. 265-306 du deuxième tome. Tarski insiste sur le fait que sa définition ne vaut
en toute rigueur que dans le cadre des langages formalisés comme la logique des classes, mais butte rapidement
sur des contradictions dans les langues naturelles. Il soutient néanmoins que la conception dite « classique » de
la vérité relève principiellement de ce genre de définition dans laquelle un nom (ce qui est entre guillemets, ici
une proposition) réfère à un état de fait de façon congruente (ici la même proposition sans guillemets).

« Pourquoi tout ce qui n’est pas femme… », p. 3
doute général sur la pertinence de la disjonction ainsi opérée par le regard inquisiteur. Les deux
énoncés logiques semblent à première vue recéler la même structure interne.
Il faut donc élargir un peu le cadre pour percevoir une différence que l’on pressent d’emblée
sans pouvoir aussi aisément la localiser. Si la neige n’est pas blanche, elle peut bien être positivement
tout ce qu’on voudra – bariolée, beige, bise, bleutée, boueuse, brunâtre, butyreuse, etc. – elle sera au
regard de notre énoncé « non-blanche », et cela suffira pour invalider la proposition affirmant « la
neige est blanche ». Pas de problème, dans ce cas, puisque « non-blanc » n’est rien que le
contradictoire de blanc : je prends la qualité dite « blanc » et je la nie, sans rien lui ajouter ni lui
soustraire, en la faisant simplement précéder du signe de la négation dite « classique », qui veut que
« non-non-blanc » soit strictement équivalent à « blanc ».
Les raisons de cette équivalence sont à étudier de près pour qui cherche à établir les conditions
de validité d’un énoncé comme « ‘je suis une femme’ est vrai si et seulement si je suis une femme ».
La négation de « blanc » ne produit pas en effet son contraire (disons : « noir »), mais bien son
contradictoire : tout ce qui n’est pas blanc sera dit « non-blanc ». Ce « non-blanc »-là se présente
donc, du point de vue ensembliste, comme le complémentaire de « blanc » relativement à ce qu’il faut
bien poser comme « univers du discours », indispensable pour rassembler sous une seule
détermination la multiplicité de tout ce qui n’est pas blanc. Ceci est dit « non-blanc » parce que c’est
autre que blanc, sans que j’aie besoin de préciser positivement quel est cet « autre ». Et donc « non-
blanc » n’est pas une qualité donnée qui s’opposerait d’elle-même à « blanc », c’est n’importe quoi
autre que blanc, sans que j’aie besoin d’affirmer le trait positif qui le caractérise. Parce que j’ai pu,
grâce à l’opérateur visible de la négation et au postulat implicite de l’existence d’un « univers du
discours », ramener toute cette diversité à une même absence d’une même qualité-prédicat
(« blanc »), je peux maintenant opérer une disjonction limpide qui rend clair mon « si et seulement
si ». Et si donc, après avoir fabriqué ce « non-blanc » comme une entité à part entière en prenant
l’univers du discours et en lui retirant le sous-ensemble « blanc », je nie ce complémentaire de
« blanc » qu’est « non-blanc », il me faut bien admettre que je réintègre sur le champ le sous-
ensemble « blanc ».
Ce faisant, je reste dans la logique du tiers exclu, qui admet le vrai et le faux et rien d’autre,
puisque cet opérateur de négation m’a permis d’instaurer à partir d’une qualité et d’un seule une
bipartition stricte relativement, encore une fois, au très discret « univers du discours », relativement,
donc, à l’affirmation de tous les prédicats possibles et imaginables.
Or, de ce point de vue-là, « femme » ne se présente pas comme un équivalent de « blanc »
dans la mesure où « femme » ne prend sens que sur fond d’une bipartition déjà donnée. À la
différence de « non-blanc », « non-femme » ne collectivise pas tout ce qui serait autre que femme
pour l’enclore dans l’orbe d’une seule détermination négative, car « femme » s’articule d’abord comme
l’un des termes d’une différence sexuelle qui précède et excède la donne logique : ce qui ne tombe
pas sous son registre semble appartenir d’emblée au registre opposé « homme » qui, du coup,

« Pourquoi tout ce qui n’est pas femme… », p. 4
fonctionne du point de vue ensembliste comme son complémentaire
5
. Ici gît donc l’ultime différence
entre les faits allégués dans les des deux énoncés « à la Tarski » relativement à leur prédicat de
départ : dans le premier, aucun trait positif ne vient subsumer la détermination négative de « non-
blanc », alors que le trait le plus positif qui soit, le trait phallique, vient à tout coup subsumer la
détermination négative « non-femme ».
Il faut alors atteindre la négation suivante pour sentir vraiment où le bât blesse. Si je nie « non-
blanc », il est clair que je reviens à « blanc » puisque la négation est un opérateur qui fait passer
d’une proposition à son complémentaire dans l’univers du discours, et vice versa ; si alors je nie
« non-femme », dois-je en conclure que je reviens de même à « femme
6
» ? On pourrait le croire,
mais pour peu que j’aie, au passage, identifié « non-femme » à « homme », comme m’y presse la
prééminence de la différence sexuelle, dois-je de même en conclure qu’à nier « homme », j’en reviens
derechef à « femme » ? Tout dépendra de la qualité de mon identification de « non-femme » à
« homme », dont on conviendra qu’elle ne relève pas de la seule logique. Si cette identification est
stricte, Tarski a raison sur tous les plans. Or il y a lieu de la questionner à plus d’un chef, non pas en
étudiant le comportement logique du prédicat – on vient de le faire – mais en observant celui du sujet
censé supporter ledit prédicat.
« Neige » est un terme positif qui possède un référent simple
7
, constatation qu’il n’est pas
possible de faire pour « je ». Pour faire bref : « je » ne réfère pas de la même façon que « neige ». Or
c’est là que cesse, s’interrompt, se brise, l’identification de la femme à la femelle vers laquelle nous
pressait silencieusement le raisonnement à la Tarski. Et qu’on n’imagine pas que cela tient à la
« première personne » et à ses prestiges de toujours, car j’aurais pu aussi bien prendre « ‘elle est une
femme’ est vrai si et seulement si elle est une femme », disqualifiant ainsi le « je » qui prétend être
ceci ou cela et semble plonger dans les mystères de la subjectivité. Va donc pour la troisième
personne : « Elle » et « la neige » : quelle différence ?
L’écart entre les deux n’est pas total : la troisième personne constitue en effet, au dire des
linguistes, le « délocutoire », ce dont parlent « je » et « tu » quand ils conversent de « quelque
chose », quoi que ce soit, et donc, qu’ils parlent de neige ou de femme, au fond, peu leur chaut. Sauf
qu’en virant ainsi de première personne à la troisième, il aura fallu… que je décide d’un genre
grammatical, anticipant d’autant sur le sens de la proposition dont je me promets d’étudier la valeur. Si
« elle » n’est pas une femme, qu’est-elle donc ? L’énoncé « la neige est blanche » pose, lui, la
5
On remarquera que l’énoncé « ‘je suis une blonde’ est vrai si et seulement si je suis une blonde » est
entièrement passible, lui, d’un registre à la Tarski, justement parce que « non-blonde » n’est pas aussi aisément
réductible à « brune », sauf à ignorer les rousses, les auburn, les châtain, les décolorées, les grisonnantes, etc.
6
Lacan en est venu à poser explicitement la question : « […] cette bipartition à chaque instant fuyante de
l’homme et de la femme : tout ce qui n’est pas homme est-il femme, on tendrait à l’admettre. Mais puisque la
femme n’est “pas toute”, pourquoi tout ce qui n’est pas femme serait-il homme ? » J. Lacan, … ou pire, séance du
10 mai 1972.
7
Y compris pour les Inuits, à qui l’on attribue sans raison près de soixante-dix mots pour dire chacun des états de
la neige auxquels ils ont affaire, en laissant croire que pour eux, « La neige » n’existe pas plus que « La femme »
chez Lacan. Malheureusement pour une aussi élégante démonstration, la langue inuit est une langue
« agglutinante » et tous les mots pour « neige ceci » « neige cela » ne sont que des « mots-phrases », soit une
même racine suivie d’une multitude de désinences qui qualifient les très nombreux états de la neige. J’ignore s’il
existe en inuit des occurrences du radical de « neige » sans aucune désinence, mais ça me paraît hautement
vraisemblable.

« Pourquoi tout ce qui n’est pas femme… », p. 5
question de sa vérité pour autant que l’on admet au départ qu’elle pourrait ne pas l’être sans cesser
de s’avérer « neige », que l’on n’est donc pas en train d’affirmer une tautologie, en train de dire « le
blanc est blanc ». Si, à l’inverse, je pars de « elle » pour risquer l’affirmation « est une femme », le
risque est quasi nul. L’obligation que me fait la troisième personne d’opter pour un genre grammatical
ou pour un autre dès qu’il s’agit du genre humain la disqualifie pour ce type d’énoncé à la Tarski.
Aventurons-nous alors vers la deuxième personne : « ‘Tu es une femme’ est vrai si et
seulement si tu es une femme ». Comme bien souvent avec le couple je/tu, ça sent la querelle de
ménage du fait de la question : qui dit ça, et pourquoi ? Qui est donc en train de douter du sexe de la
personne à qui s’adresse un tel énoncé ? Qui tient tant que ça à établir cette vérité factuelle ? Voilà
que, avec « tu », toute une psychologie vient interférer là où nous ne voulions qu’y voir clair dans le
statut logique d’un énoncé. Plutôt donc se rabattre à nouveau sur la première personne et s’assurer
des conditions de son fonctionnement dans l’énoncé étudié.
Il y en a d’emblée plusieurs : 1°) le sujet logique, apte à supporter des prédicats (en cela
identique à « neige ») ; 2°) le sujet grammatical, qui doit pouvoir passer salva veritate à la deuxième et
troisième personne (et donc devra fatalement verser au compte d’un « il » ou d’un « elle ») ; 3°) le
sujet de l’énonciation (puis de l’énoncé), celui qui affirme lui-même quelque chose de lui-même (ce
que ne faisait pas la neige, qui la bouclait dans sa supposée blancheur). Ça fait beaucoup.
Mais il y a pire : « je » est tout aussi prêt à soutenir le prédicat « non-femme » que le prédicat
« homme », ou bien d’autres puisqu’il est ce fragment de langue, ce « shifter » censé référer à ce qui
précéderait la moindre identification préalable
8
, échappant de ce fait à une référence extra langagière.
Tout ce qu’on peut lui reconnaître ne dépassera pas, soit la simple
9
certitude d’exister du fait de sa
pensée si l’on est cartésien, soit la sensation aussi floue qu’oppressante d’une existence liée à l’effort
si l’on suit Maine de Biran, soit d’autres solutions encore inventées par la gent philosophique à travers
les âges. À part ça, selon la grande formule de Benveniste : « est ‘je’ qui dit ‘je’ ». Aucun prédicat ne
viendra donc déplier dans un procès véridictionnel les qualités inhérentes à ce ‘je’-là que ce ‘je’ n’aura
pas déjà reconnues comme siennes.
Nous voilà donc revenus, au terme de ce petit parcours logique, au point de recouvrement
femme/femelle, dont on peut maintenant mesurer à quel point il ne résulte pas, lui, d’un jugement
« objectif ». Ce dernier peut bien trancher, de visu, le point de savoir pour quiconque si « femelle » ou
« non-femelle » ; mais il n’aura aucun instrument autre que l’ensemble de ses préjugés pour passer
de « femelle » à « femme », comme pour résister à la tentation de confondre « non-femme » et
« homme ». Seul le « je » qui s’affirme tel a les moyens de le faire en toute rigueur.
On se souvient peut-être qu’écrivant Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, Freud en
vient à chercher une définition convaincante du mot d’esprit. Il aboutit à : « Il n’y a de mots d’esprit
que ce que je reconnais comme tels
10
». Quel scandale, s’écriera le rationaliste intégral ! Faut-il être
8
Contrairement à « moi », du moins au moi spéculaire tel que le conçoit Lacan depuis Marienbad (1936).
9
Non qu’elle soit simplette, mais elle est indivise.
10
Sigmund Freud, Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1988, trad. Denis
Messier, p. 203. Phrase allemande : » Sie besagt, daß nur das ein Witz ist, was ich als einen Witz gelten lasse. «
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%