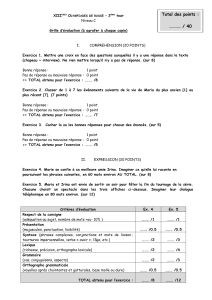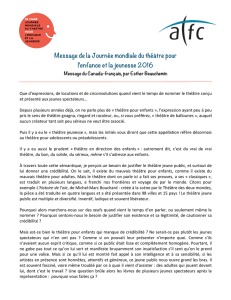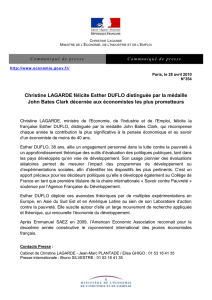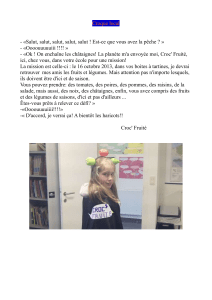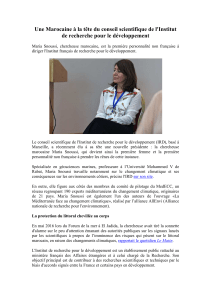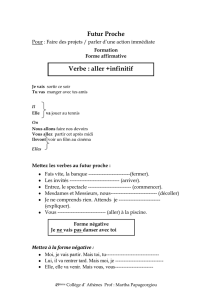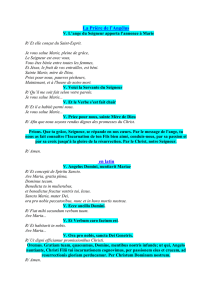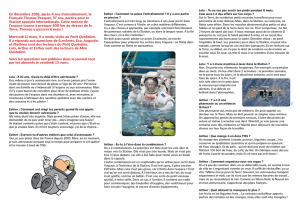Servantes

Genre littéraire et idéologie religieuse.
L'image de la servante domestique dans la fiction édifiante méthodiste
Jean-Pierre van Noppen
L’édification par la lecture
La quasi totalité de la littérature enfantine du 18e/19e siècle appartenait au
genre didactique. Les auteurs anglais et américains de l’époque se sentaient
chargés d’une mission divine d’évangéliser et éduquer les générations futures
dès leur plus jeune âge et choisirent, pour ce faire, de se lancer avec
application dans la production de littérature édifiante. Les maisons d’édition
protestantes d’outre-Atlantique publièrent des milliers de volumes (reliés en
format «poche», 9 x 14 cm) consacrés au seul but d’instruire par la lecture, et
en assurèrent la distribution par le biais, notamment, des écoles du dimanche
des églises protestantes. Cette littérature, nourrie par les importations
britanniques autant que par la production évangélique locale, suivait la même
démarche que les films et des jeux éducatifs d’aujourd’hui: on y donnait aux
prescriptions morales une forme extérieure généralement associée au plaisir et à
la détente.
Initialement, le genre s’inspirait des tracts religieux du 18e siècle, tels
que les histoires pieuses d’Hannah More et de Mary Butts Sherwood – des récits
quasi hagiographiques qui relataient la vie, la conversion et (surtout) la mort
de jeunes enfants, cette dernière selon les conventions de l’ars moriendi, genre
fort prisé à une époque où la mort était une réalité omniprésente et où
l’espérance de vie dans certaines régions d’Angleterre ne dépassait guère la
jeune adolescence. Les personnages immortalisés par ces biographies pieuses
n’étaient ni nobles ni sages, mais de simples gosses, représentés avec réalisme,
auxquels les jeunes lecteurs pouvaient sans peine s’identifier. Ce
conditionnement par les «bonnes lectures» relevait d’une pédagogie rousseauiste
qui postulait que l’enfant, être malléable par excellence, pouvait être édifié à
force de bons exemples, et que les mémoires d’enfants pieux et autres récits
exemplaires constituaient autant de «flèches dirigées vers le coeur»
susceptibles de conduire la vie des lecteurs dans les voies du salut – le salut
éternel, cela s’entend, mais aussi une part de salut sur terre, manifesté par
une vie plus supportable et une position plus élevée sur l’échelle sociale.
En effet, le genre édifiant se fit, à la tournure du siècle, le reflet et
l’instrument d’une vision plus utilitaire de l’éthique religieuse. Même si le
«réalisme» des récits était grossier et le schéma narratif cousu de fil blanc
(du péché au salut en passant par la découverte de la volonté divine, le
remords, et la conversion), le lien avec la réalité de la vie de l’époque
(perçue à travers les yeux de l’écrivain moralisateur) constituait une
composante essentielle du genre. Dans ses développements au 19e siècle, le genre
se caractérisait par une volonté délibérée de participer à un courant moderniste
selon lequel la religion, pour être efficace, devait être «exciting», et
s’adresser à l’imagination et aux émotions de l’individu. Par conséquent,

l’autorité et les considérations doctrinales y furent progressivement
subordonnées aux sentiments (les «passions du coeur») et à l’engagement, qui
permettaient à l’individu de s’affirmer et se mettre en valeur. Le réveil
méthodiste du 18e siècle, qui prêchait une grâce accessible à tous, avait déjà
permis au croyant, même le plus humble, de prendre conscience de sa valeur aux
yeux de Dieu, et de son devoir de faire bon usage des dons reçus en partage – de
faire, comme les serviteurs dans la parabole biblique, fructifier ses talents.
Par le truchement de certaines pratiques dans les communautés de croyants, le
méthodisme du 19e siècle permit, voire encouragea, un glissement du centre
d’intérêt vers l’individu lui-même: l’examen de conscience, la confession
publique, les échanges au cours des études bibliques, les prières spontanées et
les activités sociales constituaient autant d’occasions où chacun, grand ou
petit, riche ou pauvre, homme ou femme, pouvait acquérir le sens de sa propre
importance et du potentiel – spirituel mais aussi psychique et social – qui lui
était donné à développer. C’est dans cette perspective que les maîtres à penser
cherchèrent à canaliser la passion évangélique dans des voies qui permettraient
aux jeunes convertis d’opérer leur «self-management», c’est-à-dire de construire
leur identité et de gérer leur propre avenir dans le monde. L’idée, relativement
nouvelle, de l’accès gratuit pour tous à l’alphabétisation et la lecture, permit
à ces auteurs anonymes mais ambitieux de se servir des écoles du dimanche et de
leurs bibliothèques comme vecteurs d’une éthique évangélique et sociale.
En effet, les écrivains moralisateurs trouvaient dans la fiction édifiante
un champ d’action et un public à la taille de leurs ambitions, car les petits
lecteurs avides des villes en pleine expansion et des communautés pionnières à
la «frontier» firent une consommation massive de cette littérature, s’il faut en
juger par les rapports des prédicateurs méthodistes itinérants et des journaux
tenus par les mères de famille. Vers le milieu du 19e siècle, la popularité de
ces histoires, souvent la seule forme de culture à la portée des familles, avait
permis la création d’un nouveau créneau sur le marché de l’édition. Les auteurs
évangéliques saisirent les possibilités offertes par les nouveaux développements
technologiques (la presse à vapeur et la reliure peu couteuse) pour répandre le
message du salut à travers une littérature à bon marché, et espérèrent ainsi
remplacer (tant par la quantité que par la qualité) les hornbooks et récits
vulgaires sur feuilles volantes qui constituaient la littérature enfantine de
l’époque. Les situations, les illustrations et l’imagerie furent choisis
(consciemment ou non) pour promouvoir ce que les auteurs estimaient être un mode
de vie évangélique réalisable par leur public.
Ces livres didactico-anecdotiques semblent relever davantage d’une écriture
populaire bien intentionnée que d’une sérieuse intention pastorale. Mais pour
cette raison justement, ils nous donnent un reflet, sinon une idée
représentative, de la façon dont le message religieux du méthodisme et les idées
morales et sociales qu’il prêchait, furent adoptés, relayés et enfin intégrés
dans la culture de l’époque. L’impact de ce type de littérature sur la culture
populaire fut d’autant plus significatif que de nombreux enfants entre 5 et 15
ans fréquentaient les écoles du dimanche, qui dans de nombreux villages
possédaient les seules bibliothèques publiques gratuites et donc accessibles à
toute la population. Les méthodistes, qui dès le début avaient encouragé la
lecture et cherché à rendre la littérature religeuse très largement accessible,
reconnurent que «la parole du prédicateur s’envole comme le souffle qui la
porte, mais les mots du livre imprimé subsistent, pour s’adresser aux

générations à naître ». Le livre à bon marché fut qualifié d’«enseignant
infatigable» – une image révélatrice de la métaphore directrice «la vie est une
école» sur laquelle se fondaient les auteurs des ouvrages édifiants. Nous y
reviendrons.
Une éthique du succès
Quels que soient le public visé ou la doctrine religieuse sous-tendant le
récit, les livres destinés aux écoles du dimanche étaient porteurs de deux
messages fondamentaux, à savoir 1) que tout problème, spirituel ou séculier,
pouvait être réduit à un nombre de composantes maîtrisables une à une, et ainsi
résolu; et 2) qu’avec l’aide de Dieu et des valeurs éthiques protestantes,
l’effort individuel devait conduire au succès. Il existait, toutefois, un genre
largement similaire de littérature édifiante et admonitoire dans les milieux
non-croyants, également peuplé de personnages modèles qui avaient réponse à tous
les problèmes éthiques et domestiques. Dans un cas comme dans l’autre, la
«naïveté» du récit – le manque de finesse dans la caractérisation, la facilité
avec laquelle les personnages atteignaient leurs buts, le manque de subtilité
dans la moralisation, le caractère stéréotypé des descriptions – rend cette
littérature un peu ridicule, voire agaçante, aux yeux du lecteur contemporain.
Mais l’idéologie sous-jacente, c’est-à-dire, la promesse de succès et
d’ascendance sociale offerte par une saine auto-gestion, devait à l’époque
exercer un attrait non négligeable sur des milliers de lecteurs aux perspectives
limitées; d’autant plus que le réalisme primitif et la réduction de l’éthique à
une série de maximes toutes faites semblaient mettre cet idéal de l’élevation
sociale à la portée des lecteurs les plus démunis. En fait, même si l’on peut
supposer que les auteurs étaient sans doute capables de davantage de finesse,
l’absence de sophistication littéraire était une qualité soigneusement cultivée
par ces écrivains: animés par la ferme conviction que «l’enfant ne demandait
qu’une chose, à savoir, la vérité pure et simple», ils/elles mettaient leur
point d’honneur à éviter «les tournures extravagantes, qui ne peuvent plaire
qu’aux esprits pervertis», et réservaient leurs rares éclats de grandiloquence à
la louange du progrès technique et social, qui devait profondément modifier tout
le paysage humain : le chemin de fer («un monstre volant»), le paquebot («un
magnifique palais aquatique») ou l’éducation universelle («un fleuve majestueux
et puissant coupant à travers les couches sociales»). Dans cette perspective
optimiste, l’école du dimanche devint, à l’échelon local, l’outil qui promettait
d’apporter jusqu’aux confins de la civilisation (la «frontier» américaine), les
bienfaits de l’éducation, la respectabilité et la dignité; tout comme elle
avait, un demi-siècle auparavant, aidé à transformer les enfants des mineurs et
ouvriers anglais «de loups et tigres en êtres humains».
La notion d’école constitua d’ailleurs l’une des métaphores directrices
régissant l’univers de ces écrivains moralisateurs. Elle permit de combiner les
impératifs évangéliques avec le nouveau réalisme littéraire dans une démarche
délibérément et explicitement didactique. Ainsi, dans un des ouvrages distribués
par les écoles du dimanche, Learning to Feel (1845), la famille est représentée
comme une «école», où le père de famille réunit ses rejetons une fois par
semaine autour de son fauteuil, pour leur «enseigner» par l’exemple et l’image
«les sentiments corrects» – une morale basée sur le contraste à peine nuancé
entre les enfants «sages» et «désobéissants». Dans une de ses anecdotes, le

père raconte qu’il a vu, au cours d’une promenade, un mastiff enchaîné, et un
paon en liberté faisant la roue. Morale de cette observation: «Soyez sages comme
le maître de ces animaux: gardez sous contrôle les sentiments susceptibles de
faire du tort à autrui, et laissez libre cours à ceux qui créent la beauté et
donnent la joie». Ainsi, le Papa joue au «maître» éclairé qui instruit ses
enfants – et le lecteur – dans l’art de vivre et de poursuivre le bien. Notons
en passant que les menaces d’enfer et de damnation, si caractéristiques d’une
certaine pédagogie du 18e siècle, sont absentes des raisonnements paternels, et
que le but des entretiens ne semble plus être de déclencher la conscience du
péché et la crise de la conversion, comme c’était la cas dans la littérature
pieuse antérieure. Dans la famille du 19e siècle, installée dans le confort de
sa demeure bourgeoise, la volonté de faire le bien fait partie des acquis; le
chantage par la peur n’a plus de raison d’être.
L’image de la famille-école peut être vue à son tour comme une projection à
l’échelle humaine de Dieu, Père céleste, réunissant ses enfants dans son Église
pour leur apprendre à suivre le voies de l’obéissance, du salut et, conformément
à l’idéologie de l’époque, du succès. Le message, pour religieux qu’il fût, y
prenait moins la forme d’une théologie que d’un ensemble de valeurs et d’images
répondant aux aspirations et anxiétés du monde de l’époque. La quête du salut,
le passage des ténèbres à la lumière, y passait par la découverte de l’identité
et la réalisation du potentiel de chacun – pas uniquement l’ascension sur
l’échelle sociale, pour désirable qu’elle pût paraître, mais aussi et surtout la
conversion, par l’enseignement, d’un état d’illettrisme, d’ignorance et
d’impuissance à l’éducation, la culture, la discipline, le respect de soi et
l’intégrité morale.
My Station and its Duties ([1830], 1845)
Le livre qui nous intéresse relève lui aussi du genre scolaire, mais se
montre plus explicite, tant dans son exploitation de la métaphore de l’école que
dans son caractère utilitaire. Le récit se déroule dans une école de village qui
forme les demoiselles à un futur emploi comme servantes domestiques; un emploi
subalterne, certes, mais qui offrait aux jeunes filles des classes ouvrières et
agricoles une certaine mobilité sociale en leur permettant de fréquenter les
classes supérieures. L’enseignant est perçu non comme un oppresseur qui
contraindrait les jeunes filles à adopter un rôle de service et d’obéissance,
mais comme un bienfaiteur et un guide: tout comme le père de famille dans
Learning to Feel, le professeur dans My Station and Its Duties cherche à donner
à ses élèves les repères verbaux, moraux et psychologiques qui leur permettront
de s’orienter elles-mêmes dans la vie et de trouver dans la société la place et
les attitudes (la «station» et les «duties») qui conviennent à de jeunes
chrétiennes.
Le titre même rappelle l’attitude réputée «protestante» selon laquelle la
place de chacun dans la société correspondrait à une vocation divine. Le
catéchisme anglais en usage parmi les méthodistes stipulait que «les dix
commandements m’apprennent à discerner mes devoirs envers Dieu et envers mon
prochain [...] à la place («state of life») où il plaira à Dieu de m’appeler»;
de même, un cantique d’école du dimanche victorien, All Things Bright and
Beautiful, suggère que le statut de chacun est ordonné par Dieu: «The rich man
in his castle / The poor man at his gate / God made them, high or lowly / And

ordered their estate», mais la littérature donne à comprendre que l’amélioration
du rang social est une récompense séculière accordée à celles et ceux qui savent
faire bon usage des talents reçus. Sur ce point, la philosophie de l’école pour
enfants de classe ouvrière et moyenne ne diffère guère de celle qui régit la
formation des enfants des classes aisées: si les enseignants ne permettaient pas
aux enfants de développer leur potentiel, «ce serait une perte regrettable, tant
pour l’élève que pour la société». Notons toutefois que l’école ne prodigue pas
d’enseignement professionnel pratique (cuisine, nettoyage, ...), mais la lecture
et, surtout, une formation morale, visant essentiellement à développer les
attitudes et réflexes qui, appliqués à bon escient, permettront aux jeunes
filles d’acquérir elles-mêmes les savoir-faire requis dans les maisons où elles
seront engagées. Le savoir-faire ménager n’est qu’un détail par rapport à
l’attitude «correcte» d’obéissance et d’humilité, attitude légitimée par la
religion, qui doit se pratiquer au travail tout comme à l’école et dans la
famille. C’est à ce point que les idéologies religieuse et utilitariste se
rejoignent: les jeunes élèves sont appelées à se prendre en main et à gérer
leurs attitudes et sentiments; mais comme nous le verrons, les sentiments qui
conduisent au succès restent, dans ce cas , ceux du chrétien humblement soumis à
une instance divine qui dirige son destin. Ainsi, le récit des aventures
scolaires des jeunes filles peut être lu à la fois comme métaphore de la vie
chrétienne et comme mise en oeuvre pratique de l’éthique qui résulte de
l’interaction entre la religion et la société de l’époque. Au cours de
l’instruction, Teacher circulait parmi les élèves, et leur rappelait leur
«état». Le rôle à jouer dans la société constituait une partie intégrante de
l’identité à acquérir par chaque élève; mais le rang à prendre n’était pas
synonyme de statut socio-économique : à ce stade-ci, il se définissait en vertu
des rôles de fille, de soeur, d’élève et de compagne de classe, avec toutes les
responsabilités que cela impliquait. La négligence de ces responsabilités
déplairait, évidemment, aux parents, aux frères et soeurs, aux enseignants et
aux condisciples, mais par-dessus tout, à Dieu. Selon Teacher, «il est tout à
votre avantage d’accomplir votre devoir: vous y gagnerez le respect de votre
entourage, et par la même, vous vous éléverez». Reste à voir quelle sera la
«récompense» réservée aux élèves qui se conforment à ces consignes.
Trois candidates-servantes: Esther, Maria et Hannah
L’école est fréquentée par de jeunes filles âgées de six à quinze ans, les
plus âgées fonctionnant comme monitrices encadrant les petites, sous la
surveillance du professeur. Chacune d’elles incarne une ou plusieurs attitudes
à adopter ou à éviter. Le lecteur rencontre aussi quelques jeunes filles qui
n’ont pas fréquenté l’école; celles-ci, illettrées, irresponsables et
inefficaces, jalousent les demoiselles qui ont connu les bienfaits de
l’instruction; mais même parmi les élèves, les candidates indisciplinées,
immodestes, ou trop ambitieuses voient leurs chances de succès compromises, et
parfois «tournent mal».
L’élève modèle est Esther Emmet, dont le nom annonce déjà les qualités:
dans l’anglais du 18e siècle, «emmet» est un des mots désignant la fourmi,
animal donné en exemple (avec l’abeille) d’une existence active, industrieuse et
prévoyante. Son amie Maria, en revanche, est moins parfaite, mais apparaît
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%