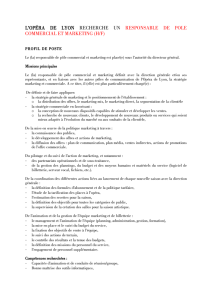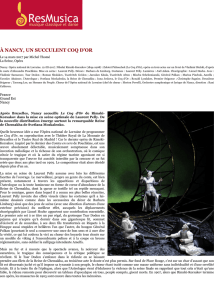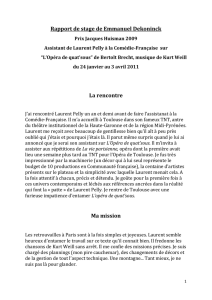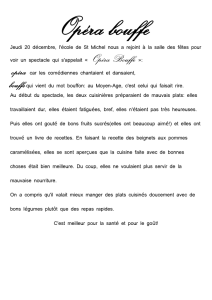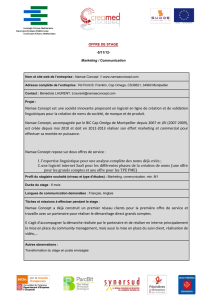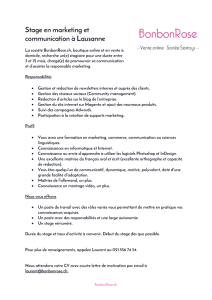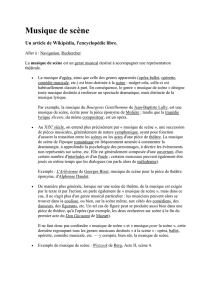Inventer pour continuer à rêver

Inventer pour continuer à rêver
Entretien avec Laurent Pelly, metteur en scène des Puritains
Avec Les Puritains, à l'affiche de l'Opéra Bastille du 25 novembre au 19 décembre, Bellini
signait en 1835 une histoire d’amour et de vengeance dans l’Angleterre du XVIIe siècle, portée
par le plus beau chant qui soit. Un nouveau défi lancé à Laurent Pelly, auquel il incombe de
faire théâtre de ce chant. Entretien.
En tant que metteur en scène de théâtre et d’opéra, vous fréquentez assidûment le XIXe
siècle. Comment situez-vous Les Puritains dans votre géographie personnelle de cette
période ?
Laurent Pelly : Entre l’opéra romantique et le bel canto. Ce qui me fascine dans le dernier
opéra de Bellini, je crois que c’est avant tout le chant. Il est vrai que j’ai beaucoup travaillé sur le
XIXe siècle, mais plutôt sur la seconde moitié. Je n’ai jamais vraiment abordé le bel canto : ni
Rossini, ni Verdi – à l’exception de La Traviata que j’ai mise en scène à Santa Fe. Mais La
Traviata n’est déjà plus du bel canto : c’est du théâtre. Je me souviens que lorsque j’ai
fait L’Elixir d’amour à l’Opéra Bastille – mon premier Donizetti – je me posais beaucoup de
questions : certes c’était une pièce comique, très théâtrale, certes ce n’était pas l’aria da capo
de Haendel… mais je ne me trouvais pas moins en présence d’un code nouveau pour moi, un
code fait de répétitions et de variantes… loin du dialogue chanté. Or, en tant que metteur en
scène, ce qui m’intéresse avant tout, c’est de me servir de la forme pour raconter une histoire.
Pour « L’Elixir », petit à petit, en utilisant l’énergie des chanteurs, j’étais parvenu à apprivoiser
ces codes, à les rendre vivants, à donner du sens à la moindre note, à ne jamais laisser la
musique se dérouler gratuitement. Aujourd’hui, j’en suis exactement au même point avec Les
Puritains : comment, à partir de cette nouvelle matière musicale, construire une théâtralité ?
C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec le chef et les interprètes. Mon
plus grand plaisir est de travailler au plus proche des chanteurs et des chœurs, de prendre
appui sur leur interprétation pour dessiner ma mise en scène.
Dans une œuvre telle que Les Puritains, le chant – plus que le livret – représente pour
vous le véritable enjeu de la mise en scène ?

Laurent Pelly : Oui. Je pars du principe que la musique prédomine parce que l’intrigue est
étrangement construite. Sérieuse sans l’être tout à fait. Comment comprendre sinon qu’au
début de la pièce, les habitants de la forteresse en liesse annoncent le mariage d’Elvira avec un
homme du camp adverse sans que la jeune femme semble être au courant ? Comment
comprendre qu’elle essaie son voile nuptial sur une prisonnière qu’elle ne connaît pas, qui se
révèlera être la Reine et qui s’enfuira avec Arturo. Tout cela me semble davantage tenir du
fantasme que de la réalité. C’est ce qui a motivé notre décision de raconter cette histoire à
travers le regard subjectif d’Elvira. Tirer ce fil nous a permis de construire une dramaturgie
solide, quitte à s’éloigner de la réalité historique, mais en se référant constamment à la
musique. D’ailleurs, cette trame historique m’apparaît davantage comme un prétexte que
comme un ressort profond du drame. Contrairement à Victor Hugo qui, lorsqu’il écrit
son Cromwell, réunit une documentation considérable, interroge passionnément – à travers la
figure du Lord-protecteur – son rapport au mythe napoléonien et à sa propre époque, je ne crois
pas que Bellini et son librettiste Pepoli se soient réellement passionnés pour l’Angleterre du
xviie siècle et le conflit entre Royalistes et Puritains…
Cette façon de raconter une histoire à travers les yeux d’un personnage semble tenir
davantage des codes de l’écriture romanesque ou cinématographique que de ceux du
théâtre…
Laurent Pelly : Ce sont des médias qui m’inspirent beaucoup. Le cinéma, surtout.
J’appréhende souvent l’espace scénique – la construction d’une scénographie – à travers les
mouvements d’une caméra imaginaire. Champ, contrechamp, travellings, plans d’ensemble et
plans rapprochés… Au théâtre, comment puis-je transposer ces techniques
cinématographiques ? Comment puis-je obtenir un rythme de montage ?
Pour Les Puritains, comment traduisez-vous ce principe de «caméra subjective» avec les
moyens proprement théâtraux que sont la scénographie, les costumes … ?
Laurent Pelly : L’idée était de traiter l’époque – en jouant en costumes et dans un décor
historiques – tout en la revisitant : créer un univers mental, rêveur. Avec ma scénographe
Chantal Thomas, nous avons imaginé un objet scénographique assez fou, à la fois pur et très
complexe. Le décor représente un château anglais inspiré du xviie siècle, mais qui se réduirait
à ses angles et à ses arêtes : une immense cage sur un plateau tournant qui enferme le
personnage dans un monde rigoureux et austère, historique et irréel. Il en va de même pour les
costumes, pour lesquels j’ai travaillé sur des lignes d’époque mais complètement épurées, avec
des matières qui ne sont absolument pas réalistes. Nous traitons le choeur, par exemple, d’une
façon très graphique. Il apparaît comme un ensemble de pions sur un grand échiquier, de
silhouettes extrêmement rigides. Le monde est comme vu à travers le regard d’une Elvira en
proie à la folie.
Le recours aux projections vidéo – assez rare dans vos mises en scène – participe-t-il
également de ce processus ?
Laurent Pelly : Oui, et c’est intéressant parce que l’utilisation d’un tel dispositif est nouvelle
pour moi. C’est une expérience supplémentaire que je tente avec ces Puritains. À certains
moments du spectacle, sont projetées des images en noir et blanc, des plans rapprochés des
personnages, qui nous font perdre nos repères spatiaux et contribuent à cette atmosphère
cauchemardesque, cet enfermement dans l’espace mental d’Elvira. Par extension, cette idée
dramaturgique me permet également d’aborder le thème du personnage féminin sacrifié,
comme dans toutes les oeuvres - ou presque - du XIXe siècle.
La question de la condition des femmes au XIXe siècle est-elle un sujet qui vous touche
particulièrement ?
Laurent Pelly : Non pas la condition des femmes, mais plutôt la jubilation qu’éprouve le
spectateur du XIXe siècle à voir souffrir, et souvent mourir, les grandes héroïnes, sacrifiées sur
l’autel de la morale bourgeoise. Je viens de refaire La Traviata cet été… Manon est dans le
même cas, Carmen également… Parce que ces femmes sortent de la norme, sont en quête de

liberté, il y a une sorte de scandale, mais aussi d’excitation réactionnaire à les voir payer de leur
vie leur désir d’émancipation. Certes, dans Les Puritains, Elvira survit, mais elle fait tout de
même l’expérience de la folie. Et comme elle vit dans un univers guerrier, très masculin, au sein
duquel elle tente de vivre ses désirs, je trouve que rêver la pièce à travers ses yeux a du sens.
Parallèlement à la carrière prolifique que vous menez à l’opéra, vous travaillez très
régulièrement au théâtre. Que vous apporte ce va-et-vient entre l’art dramatique et l’art
lyrique ?
Laurent Pelly : Même si les deux sont liés, même si j’ai l’impression de faire le même métier,
travailler à l’opéra a beaucoup apporté à l’homme de théâtre que j’étais. Ce qui m’intéresse
beaucoup dans l’art lyrique, c’est la « convention absolue » : dès lors qu’un personnage chante,
il faut trouver, inventer des solutions pour pouvoir continuer à rêver. Et comme j’aime justement
construire des dramaturgies oniriques, cette « contrainte » me convient parfaitement. L’opéra
m’a également appris les grands espaces : c’est très rare que l’on travaille sur d’aussi grands
plateaux au théâtre. Et puis, les hasards des programmations ont fait que j’ai beaucoup travaillé
sur le répertoire du XIXe à l’opéra et qu’au théâtre, j’ai monté dernièrement deux pièces de
Victor Hugo. Alors forcément, les univers se mettent à dialoguer - les époques, les styles, les
façons d’envisager le spectacle…
Vous faites souvent référence à Victor Hugo que, de fait, vous avez beaucoup mis en
scène. vous me disiez tout à l’heure, en plaisantant, qu’au théâtre, vous pourriez très
bien vivre en ne montant que Shakespeare et Hugo. En quoi ces deux auteurs
nourrissent-ils particulièrement votre théâtre ?
Laurent Pelly : Hugo et Shakespeare - qui l’inspirait beaucoup - sont pour moi deux grands
maîtres parce que leur théâtre mêle intimement tragédie et comédie humaines. Récemment, j’ai
mis en scène Macbeth : il s’agit d’une pièce terrible, violente, sanglante, mais dans laquelle je
ne peux m’empêcher de voir une dimension farcesque – qu’a très bien perçue Jarry dans
«Ubu» - : assassiner tout le monde pour s’approprier et conserver le pouvoir, se murer dans sa
propre folie… Cette façon qu’ont Shakespeare et Hugo d’osciller constamment entre profondeur
et légèreté m’aide beaucoup à appréhender les œuvres que je mets en scène, jusqu’à cette
production des Puritains : ce château-prison gigantesque et transparent, cette guerre meurtrière
et dérisoire…
Comparées à celles d’autres metteurs en scène dont les esthétiques sont immédiatement
identifiables, vos mises en scène se suivent mais ne se ressemblent pas – alors même
que vous collaborez sou vent avec la même scénographe. Est-ce un souci permanent
que vous avez de vous renouveler, d’inventer sans reproduire ?
Laurent Pelly : Je ne me pose pas tout à fait le problème en ces termes. Disons que j’ai la
conviction que c’est l’oeuvre qui doit m’imposer son esthétique. C’est pour cette raison que ma
mise en scène des Puritains ne ressemblera ni à Giulio Cesare, ni à L’Elixir d’amour, ni
à Platée. Avec ma scénographe Chantal Thomas, nous n’avons aucune recette. Nous aimons
toujours repartir à zéro. Bien sûr, j’ai des obsessions, et ma façon de raconter les histoires s’en
ressent : je suis fasciné par l’illusion théâtrale, et cette fascination peut se retrouver d’un
spectacle à l’autre. Mais ce qui m’intéresse avant tout, c’est de me laisser complètement
imprégner par l’oeuvre. Il arrive que j’éprouve le besoin de transposer, de changer l’époque, de
déstructurer une œuvre, parce que nous n’avons plus les références culturelles pour la
comprendre. Mais pour d’autres, je m’y refuse absolument. Je viens par exemple de remonter
au Japon L’Enfant et les sortilèges. Quand je mets en scène un chef-d’œuvre si complexe
dramaturgiquement et scénographiquement, mon rôle est d’abord de tout faire pour qu’il «
fonctionne ». Si je commence à le déstructurer, je risque de le tuer… Simon Hatab
© En Scène !
12 novembre 2013
1
/
3
100%