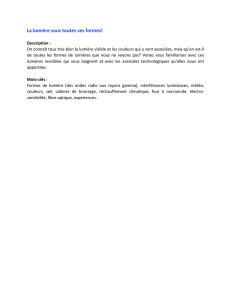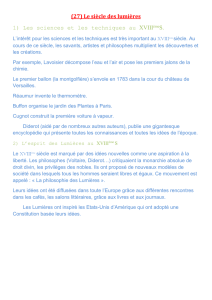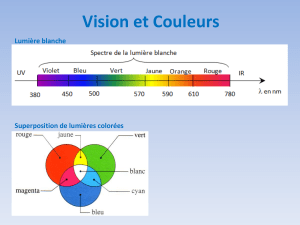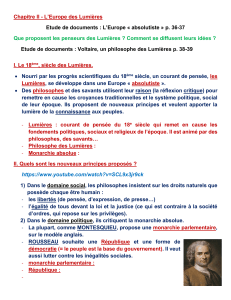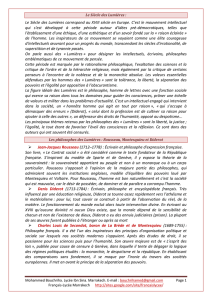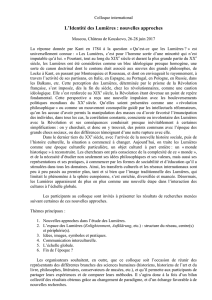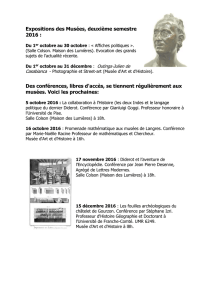"L`esprit des Lumières a encore beaucoup à faire dans le

"L'esprit des Lumières a encore beaucoup à faire dans le monde d'aujourd'hui"
Le Monde 5/03/06
Entretien avec Tzvetan Todorov (Historien des idées et essayiste, Tzvetan Todorov est, avec Yann Fauchois,
commissaire de la nouvelle exposition "Lumières ! Un héritage pour demain")
Pourquoi, aujourd'hui, une exposition sur l'esprit des Lumières ?
— Il y a eu, au départ, une intention militante : rappeler les grands principes des Lumières nous a paru
indispensable dans un moment historique marqué par le 11-Septembre, par les attaques d'un certain
fanatisme religieux contre la laïcité, contre l'égalité des hommes et des femmes. Mais on ne pouvait s'en
tenir à cette opposition simple : les Lumières sont parfois trahies par ceux-là mêmes qui s'en réclament.
Qu'avez-vous choisi dans cet héritage ?
— Le premier pas des Lumières est une critique des tutelles traditionnelles contrôlant les conduites
humaines, et pour commencer de la religion. L'idée de critique est consubstantielle aux Lumières. A tel
point que les critiquer aujourd'hui, c'est leur être fidèle ! La connaissance s'affranchit des autorités
anciennes et devient une libre recherche de vérité, conduite par la raison et appuyée sur l'observation.
Sur le plan politique, cela mènera à contester la royauté de droit divin dans laquelle il faut obéir au roi
ou aux nobles simplement parce que la tradition les a institués tels. C'est le peuple souverain, c'est-à-dire
la totalité des habitants d'un pays, qui décidera de la conduite à suivre. Dans la sphère personnelle,
l'individu ne se soumet plus qu'à sa propre volonté. Mais le peuple souverain peut-il décider par exemple
de manger les plus faibles ou de tuer les vieillards parce qu'ils sont improductifs ? Non, la volonté
collective est limitée par deux grands principes. D'abord celui d'humanité. Le but de l'action sociale n'est
pas de plaire aux dieux, ni de construire un avenir radieux, mais d'accroître le bien-être des humains pris
un par un. L'être humain est devenu la finalité ultime de l'action.
Le deuxième principe, c'est l'universalité. Ce qui se traduit à l'intérieur d'un pays par l'exigence d'égalité
: que vous soyez riche ou pauvre, intelligent ou stupide, femme ou homme, vous êtes pourvu de la même
dignité. A l'extérieur, entre peuples, la reconnaissance de l'unité du genre humain coexiste avec une
reconnaissance du droit de chacun à choisir sa voie, ce qui implique le renoncement à imposer le bien par
la force.
Pourquoi les Lumières naissent-elles en Europe ?
— Pluralité est le maître mot. C'est la confrontation avec les étrangers qui favorise l'esprit critique.
Descartes est critiqué par Newton, qui lui-même est critiqué par des penseurs allemands ou italiens. Les
hommes des Lumières voyagent sans cesse. Persécutés pour leurs idées, Voltaire, l'abbé Prévost, Rousseau
vont partir en Angleterre. Mais, pendant ce temps, des Britanniques viennent en France : Bolingbroke,
Hume, Sterne. Beaucoup seront accueillis en Prusse chez Frédéric II. Cette sorte de circulation
permanente n'est pas un hasard : on subit des persécutions dans son pays, mais on y échappe en devenant
un étranger, un visiteur, un exilé. Il y a aussi une forte émulation : c'est parce que Priestley développe ses
théories sur l'oxygène en Angleterre que Lavoisier va pousser aussi loin ses recherches en France. Le
philosophe écossais Hume pose la question : pourquoi l'Europe est-elle la terre des Lumières ? Parce
qu'elle est le continent le plus morcelé, à la différence de la Chine, Etat unifié. Cette diversité est une
valeur positive, perçue comme constitutive de l'Europe. Elle reste d'une actualité formidable pour L'Union
européenne, qui est un aboutissement, encore partiel, de ce projet des Lumières.
D'autres projets sont-ils à parachever ?
— Les Lumières sont destinées à rester à tout jamais inachevées. On a beaucoup dit, mais à tort, qu'elles
se confondaient avec l'idée de progrès. Pourtant, leurs plus grands protagonistes n'ont nullement cru à un
progrès automatique et linéaire. Rousseau, dans son Discours sur l'inégalité, expose une vision de l'histoire
dans laquelle chaque progrès dans une direction s'accompagne d'une perte dans une autre. Le fait que nos
voitures nous transportent de plus en plus vite mais qu'en même temps leurs pots d'échappement nous
asphyxient : constatation qui n'aurait pas surpris Rousseau. Le moindre progrès se paye, et souvent
chèrement. L'obscurité ne disparaîtra jamais définitivement.
Débarrassons-nous aussi de ce cliché selon lequel les Lumières voulaient tout soumettre à la raison,
rationalisme aride que nous aurions battu en brèche en découvrant l'inconscient. Les penseurs des
Lumières savaient que l'homme est conduit par ses passions, mais aussi que la raison est l'instrument

donné en partage à tous. Pour engager le dialogue, nous devons faire appel à ce qui nous est commun,
cette capacité de raisonner et d'argumenter. Idée fausse encore : les Lumières pécheraient par trop
d'abstraction. "L'homme, monsieur, je ne l'ai jamais rencontré", ironisait Joseph de Maistre, ennemi juré
de la Révolution. Or les Lumières ont inventé à la fois l'histoire et l'anthropologie, qui exigent toutes deux
la reconnaissance de la singularité des sociétés. Il est vrai qu'elles ont maintenu aussi l'héritage de l'école
du droit naturel, à savoir que les êtres humains, en tant que tels, étaient pourvus de droits, valables quels
que soient le régime, le lieu ou le climat.
Parlons des personnages emblématiques de cette époque. Qui sont-ils ?
— Deux figures familières accueillent les visiteurs de l'exposition, celles de Mozart et de Rousseau. Ce
dernier est un critique des Lumières et, à ce titre, leur penseur le plus profond. Mozart, dont les opéras
chantent l'aspiration à l'amour et au bonheur purement humains, est une brillante incarnation des
Lumières. Comme d'ailleurs des peintres comme Fragonard, maître de la sensualité, ou Chardin, dont La
Fontaine exprime mieux que de longs discours la dignité des humbles.
Douze personnages encadrent les six grands thèmes de l'exposition. Parmi eux, pour les sciences,
Benjamin Franklin : cet américain autodidacte, inventeur du paratonnerre, était aussi un remarquable
écrivain, un pédagogue et un homme politique qui a séjourné longtemps en France. L'italien Vico plaide
pour l'histoire au nom de l'irréductibilité des nations. L'écossais Adam Smith, les allemands Kant et
Goethe sont autant de figures indispensables.
Leur vision du monde peut-elle encore nous guider ?
— Je le crois, et j'ai essayé de le montrer dans un petit livre, L'Esprit des Lumières. Rousseau voit les
immenses dangers qui pèsent sur notre monde, mais, en même temps, il croit en la perfectibilité, qui est la
possibilité pour chacun d'entre nous, s'il livre les efforts nécessaires, de se transformer. Mais cette liberté
qui nous permet de nous perfectionner peut aussi nous conduire vers le mal.
Chez le juriste Beccaria, on trouve une remarquable argumentation contre la torture et la peine de mort.
Or non seulement ces pratiques subsistent dans les faits en beaucoup d'endroits, mais elles ont été de
nouveau théorisées à la suite des attentats du 11 Septembre : comme en France au moment de la guerre
d'Algérie, on a proclamé que, dans la guerre contre le terrorisme, tous les moyens sont bons pour obtenir
des renseignements. L'esprit des Lumières peut nous aider à combattre ces dérives effrayantes de la part
des grandes démocraties. De même, il est là pour nous rappeler que l'économie ne doit pas être sa propre
finalité - le développement pour le développement -, mais qu'elle doit être au service des êtres humains.
Une vie politique dans laquelle garder le pouvoir serait la seule motivation de ceux qui y aspirent est un
autre exemple de cette abolition néfaste de la finalité humaine.
L'exigence d'universalité nous indique qu'au sein d'un pays il ne peut y avoir des citoyens de première et
de seconde catégorie ; la participation démocratique ne saurait être déniée à ceux qui ne nous ressemblent
pas parce qu'ils viennent d'ailleurs ou sont d'une autre religion. Bref, l'esprit des Lumières a encore
beaucoup à faire dans le monde d'aujourd'hui.
Pourtant, des aspects peu reluisants de notre époque naissent des Lumières...
— Les adversaires évidents, comme l'obscurantisme, sont les plus faciles à combattre. Plus sournois sont
des travers enracinés dans les idées mêmes des Lumières. Par exemple le scientisme : alors que la science
doit être servante, on l'a vue souvent sortir de son domaine pour dicter ses fins à la société. Dérive encore
quand, de l'individu autonome des Lumières, on passe à l'individu autosuffisant. Or nous naissons dans le
langage, dans la culture, et nous dépérissons dans l'isolement. Les Lumières ne sont pas davantage un
éloge hédoniste de l'instant présent. L'être humain est pourvu de ces capacités spécifiques que sont la
mémoire et l'imaginaire. Vivre seulement dans la sensation, c'est nier l'humain. Perversion enfin que le
colonialisme, qui s'est paré des oripeaux des Lumières pour justifier ses conquêtes.
Avons-nous failli dans la transmission de l'héritage des Lumières ?
— Ne nous berçons pas de l'idée que les démocraties libérales sont là pour toujours. Les forces opposées
aux Lumières sont enracinées : la préférence pour la soumission plutôt que pour la liberté, le besoin de
consolation, le goût du pouvoir ne sont pas moins humains que les valeurs promues par les Lumières. C'est
pourquoi raviver les principes est une nécessité qui ne s'arrête jamais : la pierre risque toujours de rouler
vers le bas, que ce soit dans notre propre existence ou dans la vie publique.
Propos recueillis par Sophie Gherardi Dessin de Chloe Poizat
1
/
2
100%