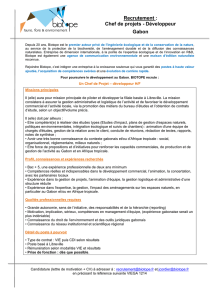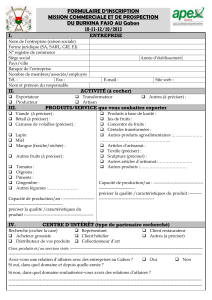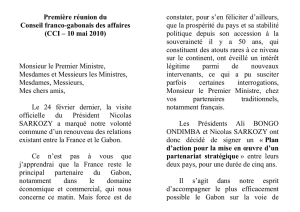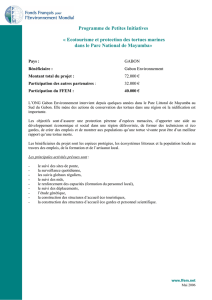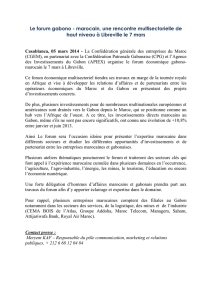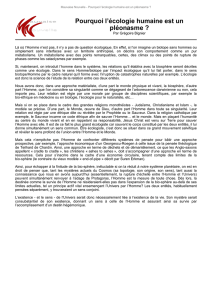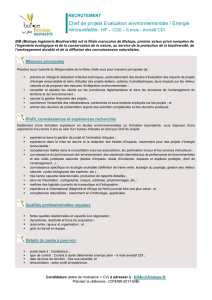gabon: quel developpement durable? - E

Paul MBA ABESSOLE
LE GABON :
QUEL DEVELOPPEMENT
DURABLE
?

Le développement durable est en vogue actuellement. Il n’y a pas un discours sur
l’économie où on ne parle de développement durable. A y voir de près, on s’aperçoit qu’il
s’agit là d’un concept utilisé entre les experts de différents pays. Mais le peuple qui
devrait être le bénéficiaire de cette réalité n’y comprend pas grand-chose, tant les
explications qu’on en donne sont confuses.
Je ne suis pas un spécialiste de l’économie, mais je voudrais dire, à partir de mon bon
sens, ce que le développement durable doit être pour le Gabon aujourd’hui,
indépendamment de ce qu’on pourrait aller copier chez les autres. Nous sommes des
répétiteurs spécialisés des autres, alors que nous sommes nous-mêmes capables de
concevoir après des analyses de nos réalités.
Ma démarche est simple. Je ferai d’abord un état de la question, puis j’en présenterai un
bref aperçu historique. En troisième lieu, je dirai ce qu’il faut, dans notre contexte entre
par développement durable. En quatrième lieu, je répondrai à la question de savoir si le
Gabon peut s’engager dans un processus véritable de développement durable et quelles
sont les pesanteurs auxquelles nous devons faire face. En cinquième lieu, je mettrais en
relief nos atouts évidents. En sixième lieu, je montrerai que le développement durable
est tout à fait possible chez nous si nous savons partir de notre patrimoine ancestral.
Enfin, j’indiquerai la voie inévitable, la recherche dont je donne quelques principes.
Je conclurai en disant que ce que nous voulons faire est l’affaire de tous : les hommes
politiques, les fonctionnaires, les élèves, les professeurs, les villageois, les associations
etc. L’intelligence est présente en chacun de nous, elle peut produire dans n’importe
quelle situation.

1. L’état de la question.
Depuis des siècles, les pays occidentaux exploitent au maximum les richesses de leurs
anciennes colonies et d’autres pays sous-développés. Depuis une trentaine d’années, ils
se sont rendu compte qu’un déséquilibre était en train de se faire jour, déséquilibre qui
atteint progressivement le monde entier. Ils ont pris conscience qu’ils n’étaient pas seuls
et que les autres avaient besoin de vivre bien comme eux. Les richesses qu’ils
exploitaient, disons-le sauvagement, participaient à l’équilibre du monde. Si ces
richesses exploitées n’étaient pas remplacées, le monde allait en être déstabilisé et tout
le monde y perdrait. Ils ont compris enfin que tous les êtres humains sont destinés à
vivre bien. Ils ont voulu agir comme si les lois de la nature n’existaient pas. Mais ils ont
été contraints de se soumettre à ces lois. Si bien qu’aujourd’hui tout le monde parle de
l’écologie, de l’équilibre de la nature.
2. L’historique.
Le développement durable, comme tout concept a une histoire qui lui donne un sens.
Contrairement à ce qu’on croit, cette idée n’est pas seulement pour réduire les inégalités
sociales, mais surtout de créer une harmonie entre l’homme et la nature et l’usage qu’il
fait de celle-ci. L’on peut tracer quelque étape de ce concept.
1909.
L’année 1909 est celle où est né le concept de Géonomie en Europe Centrale. Elle est la
science des rapports entre les sociétés humaine et leur environnement naturel.
Après la création du terme écologie qui par l’Allemand Ernest Haeckel en 1866, le terme
d’écologie qui signifie connaissance de la maison - il entendait par maison, notre planète
et sa biosphère- il devenait nécessaire de trouver un terme signifiant « gestion de la
maison » dans le sens haeckelien de gestion de notre planète et de sa biosphère, de nos
rapports avec elles. On ne pouvait pas utiliser économie (dont gestion de la maison est
précisément le sens) car ce terme, dû à Xénophon et Aristote, était déjà pris dans un
sens étroitement productiviste. Après la création en 1866,

C’est ainsi qu’’un des étudiants d’Haeckel, le naturaliste et géographe Grigoire Antipa,
eut alors l’idée d’utiliser, en 1909, le terme de géonomie qui signifie gestion de la terre ,
pour décrire le système de gestion rationnelle des ressources naturelles des bassins du
Danube et de la Mer Noire, qu’il avait mis en 1898, avec l’appui du roi Charles I de
Roumanie. Ce système devait faciliter la navigation, augmenter la production du poisson
et de cannes, et diminuer la biomasse des moustiques, sans contrarier les équilibres
écologiques ni le rôle de filtre et d’éponge à crues que jouent les zones humides. La
géonomie est une branche de la géologie. Elle traite des lois physiques qui président aux
transformations de la forme superficielle de la Terre, peut-on lire dans l’Encyclopédie
roumaine, édition 1900, tome II, p. 528.
Après la Première Guerre Mondiale, le terme géonomie fut introduit en français par le
géographe Albert Demangeon qui en eut connaissance par son collègue Emmanuel De
Martonne, qui avait travaillé en Roumanie.
1953.
Dans le cadre de son cours d’Organisation de l’espace à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Maurice-François Rouge définit la géonomie comme un « ensemble de
connaissances scientifiques pris dans les sciences et disciplines de base (géographie
physique et humaine, géologie, pédologie, climatologie, écologie, démographie,
sociologie, économie…) qui sont mises à contribution pour décrire la réalité des espaces
et les lois et conditions de leurs modifications possibles ; ensuite une série de
combinaisons de ces apports, aidées par différentes techniques (mathématiques,
cartographiques, statistiques) qui constituent les moyens utilisés par le « géonome »
dans son art de recherche des solutions les meilleures. »
Pour un géonomiste, les problèmes de l’économie, du climat, de l’environnement sont
reliés : les solutions doivent l’être aussi. Dans cette perspective, écologie et économie ne
sauraient suivre des logiques antagonistes, mais précisément deux aspects d’une même
réalité. Pour un géonomiste, histoire naturelle et histoire humaine ne sont qu’une seule
histoire. La terre, l’eau, le climat, la vie, l’humanité forment un tout dépendant les uns des
autres : apprendre à décrypter le passé, c’est mieux comprendre notre présent et mieux
anticiper notre avenir.

1968.
L’année 1968 est celle de la création du Club de Rome. Celui-ci regroupait quelques
personnalités occupant des postes relativement importants dans leur pays respectifs et
souhaitant que la recherche s’empare du problème de l’évolution du monde pris dans sa
globalité pour tenter de cerner les limites de la croissance économique.
1972.
L’année 1972 a été importante dans l’évolution du concept développement durable. Des
documents marquants ont été publiés sur ce sujet. La croissance effrénée des Trente
Glorieuses a beaucoup inquiété du fait qu’elle se faisait un peu à l’état sauvage. Il fallait
mettre un frein à cette évolution des choses pour prendre de meilleures orientations.
Mais pour bien comprendre le bien-fondé du rapport Meaddows, il faut expliquer ce que
sont les Glorieuses. Cette expression a été créée par Jean Fourastié pour faire écho aux
Trois Glorieuses, journées révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui avaient vu la
chute de Charles X (1824 - 1830) et l’instauration de la Monarchie de Juillet de Louis-
Philippe Ier (1830-1848).
L’expression désigne la période de forte croissance économique qu’on connue entre
1947 et 1974 une grande majorité des pays développés, principalement les membres de
l’OCDE. La période d’une trentaine d’années, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale
en 1945 et le choc pétrolier de 1973 se caractérise, après un début difficile, par la
reconstruction économique des pays dévastés par la guerre, par un plein emploi dans la
grande majorité des pays, une croissance forte de la production industrielle et à une
expansion démographique importante dans certains pays et nord-américain, notamment
en France, en Allemagne de l’Ouest, aux Etats-Unis et au Canada.
Les Trente Glorieuses furent une « révolution silencieuse » parce que porteuses de
changements économiques et sociaux majeurs ; elles ont marqué le passage en Europe
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%