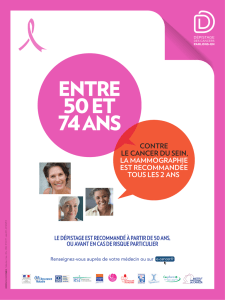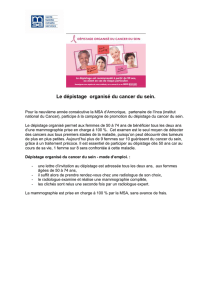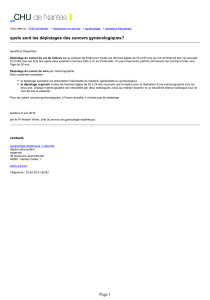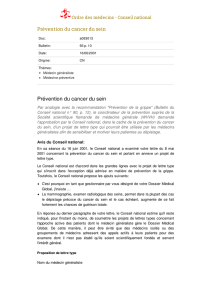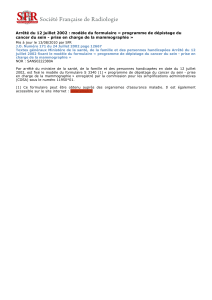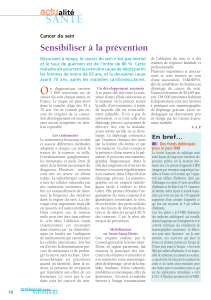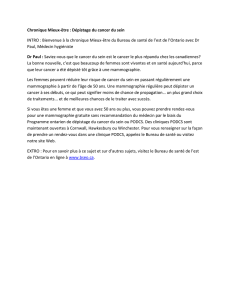Le dépistage organisé du cancer du sein

1
Le dépistage organisé du cancer du sein
Réalisé avec l’aide du Dr Laurent Verzaux
Vice-Président de la SFR
Radiologue libéral (Le Havre)
En France, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont incitées à participer tous les deux ans au
dépistage organisé du cancer du sein.
Elles sont invitées par les structures départementales en charge de l’organisation des dépistages à se
rendre chez un radiologue agréé de leur choix afin de bénéficier d’un examen clinique des seins et
d’une mammographie. Ces examens sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans
avance de frais.
Avec près de 53 000 nouveaux cas chaque année, le cancer du sein est, en France, le plus fréquent
des cancers féminins. Son pronostic est bon avec une survie relative à 5 ans de 85 % (tous stades
confondus). Lorsqu’il est détecté précocement, il peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10, avec des
traitements moins lourds, moins invalidants et une qualité de vie améliorée. D’où l’intérêt de le
dépister suffisamment tôt.
La mammographie permet, en l’absence de tout symptôme, de déceler plus de 90 % des cancers du
sein sur des signes radiologiques. Mais un tiers des femmes ne se fait pas dépister ou pas assez
régulièrement.
Un dépistage de qualité
Le dépistage organisé s’adresse à toutes les femmes, y compris celles qui ont recours au dépistage
individuel (c’est-à-dire réalisé à l’initiative de son médecin) sauf si elles signalent à la structure de
gestion qu’elles ont déjà bénéficié d’une mammographie.
C’est un dépistage de qualité. Il offre ainsi la garantie d’une double lecture par deux radiologues
spécialement formés, ce qui n’est pas le cas pour le dépistage individuel.

2
Le programme, défini par un cahier des charges publié au Journal officiel, est réévalué régulièrement
afin d’assurer aux femmes les meilleures conditions de détection et de prise en charge. Il répond à
des critères exigeants :
la structure en charge de l’organisation du dépistage envoie tous les deux ans un courrier
personnalisé aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Elle s’assure également du respect des procédures
d’assurance-qualité ;
les femmes sont invitées à se rendre chez un radiologue spécialement formé dont les
coordonnées figurent dans la liste jointe au courrier ;
le radiologue effectue un examen clinique des seins afin de repérer d’éventuels signes suspects :
nodule, grosseur dans le sein, rougeur, œdème, rétraction de la peau ou du mamelon,
écoulement mammaire, ganglions palpables au niveau des aisselles ;
il réalise ensuite une mammographie complète avec deux clichés par sein (face et oblique) ;
toute mammographie jugée normale est systématiquement vérifiée par un second radiologue
expert. Les deuxièmes lecteurs doivent signaler les clichés de mauvaise qualité pour qu’ils soient
refaits et rattraper les images anormales passées inaperçues (actuellement, moins de 1 % des
clichés sont jugés techniquement insuffisants et 5 à 8 % des cancers sont diagnostiqués en
seconde lecture) ;
lorsqu’une anomalie est détectée, le radiologue effectue immédiatement un bilan de diagnostic
(clichés complémentaires localisés, échographie et/ou cytoponction). Cela évite à la patiente une
attente angoissante et raccourcit le délai d’une éventuelle prise en charge. Cette possibilité est
spécifique à la France.
Une formation spécifique des radiologues
Le niveau d’exigence que se sont fixés les radiologues pour la réalisation de la mammographie est
très élevé et bénéficie aussi bien au dépistage organisé qu’au dépistage individuel. Pour avoir le droit
de pratiquer cet examen, ils doivent en effet :
- avoir suivi une formation spécifique ;
- réaliser au moins 500 mammographies par an ;
- être engagé dans le programme de dépistage organisé.
Dans ce cadre, les radiologues « premiers lecteurs » effectuent au moins 500 mammographies par
an, tandis que les radiologues assurant la deuxième lecture s’engagent à relire au moins 2000
mammographies supplémentaires par an.
Des techniques qui évoluent
La mise en place du programme de dépistage organisé s’est accompagnée d’une amélioration
continue de la qualité des mammographies. L’ensemble des installations présentes en France a été
vérifiée, ce qui a également bénéficié au dépistage individuel.
Les appareils radiologiques font l’objet de normes strictes et leur qualité est contrôlée deux fois par
an par des organismes agréés. Les critères de qualité évoluent régulièrement pour s’adapter aux
nouvelles techniques d’imagerie.

3
La mammographie numérique a été autorisée en 2008 dans le cadre du dépistage organisé, après
une période de validation et de formation de l’ensemble des radiologues à cette technique. Mais
c’est la mammographie conventionnelle qui reste pour l’instant la plus utilisée.
Le système numérique apporte une amélioration de la qualité de l’image qui bénéficie surtout aux
femmes les plus jeunes (de moins de 50 ans) qui ont des seins plus denses et donc plus difficiles à
examiner. Elle a permis le développement des techniques de tomosynthèse et
d’angiomammographie.
La tomosynthèse (ou mammographie en 3D)
Elle permet d’éviter la superposition des structures anatomiques normales du sein avec d’éventuelles
lésions bénignes ou malignes, comme c’est parfois le cas en mammographie conventionnelle.
L’angiomammographie
C’est un examen mammographique avec injection intraveineuse de produit de contraste iodé. Elle
peut s’avérer utile dans les seins très denses, lorsqu’il existe une lésion suspecte à la palpation
clinique ou en échographie.
Participation au dépistage
Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en 2004.
En 2010, plus de 2 360 000 femmes ont bénéficié de ce programme, ce qui représente 52 % de la
population visée par le dépistage (femmes âgées de 50 à 74 ans). Dans ce groupe d’âge, 20 à 30 %
des femmes ont encore recours au dépistage sur prescription individuelle, mais leur nombre exact
est difficile à évaluer.
La participation est variable d’une région à l’autre. Certaines ont des taux de participation supérieurs
à 60 % (Pays-de-la Loire, Limousin, Bretagne), d’autres des taux inférieurs à 45 % (Ile-de-France,
Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Un seuil de 70 % de femmes dépistées est préconisé au niveau européen, car on estime que c’est le
taux nécessaire pour réduire, grâce à une prise en charge précoce, la mortalité par cancer du sein.
En France, il est encore trop tôt pour mesurer l’impact du programme de dépistage organisé. Dans
d’autres pays où il a pu être évalué, une réduction de 20 à 30 % de la mortalité par cancer du sein a
été observée.
Impact des programmes : les cancers dépistés
En 2008, la mammographie était anormale pour 7,8 % des femmes et le bilan de diagnostic immédiat
a confirmé l’anomalie pour 41,1 % d’entre elles (soit 3,3 % des femmes dépistées). Une
mammographie normale était associée à un examen clinique anormal dans 0,2 % des cas. Enfin,
1,3 % des femmes ont été rappelées après la seconde lecture.
Plus de 14 000 cancers ont été dépistés, soit un taux de 6,3 pour 1000 femmes dépistées (7,7 % l’ont
été après la seconde lecture). Parmi ces cancers, 14,3 % sont des formes in situ (cancers localisés, de
très bon pronostic alors que les cancers invasifs envahissent les tissus avoisinants). Concernant les
cancers invasifs, 37 % ont une taille inférieure ou égale à 10 mm et 75 % n’ont pas d’envahissement
ganglionnaire (et sont donc d’évolution plus favorable).
Certains cancers in situ ou lésions précancéreuses dépistés par la mammographie sont susceptibles
de ne pas évoluer (on parle alors de « sur-diagnostic »). Mais dans l’état actuel des connaissances, il
est impossible de les distinguer d’anomalies plus agressives, ils font donc l’objet d’un traitement.

4
Les freins au dépistage
Le taux de participation au dépistage organisé ne progresse plus et reste insuffisant, alors que son
existence est largement connue des femmes.
La peur du cancer, de ses traitements, le sentiment de maladie incurable et mutilante sont en partie
les freins qui empêchent les femmes de participer au dépistage.
« Le diagnostic est redouté. Il faut le dédramatiser, car on est de plus en plus dans la guérison et de
moins en moins dans le traitement mutilant… »
Dépistage des femmes à risque
Certaines femmes ont un risque élevé (image anormale lors de la dernière mammographie,
antécédent personnel de cancer du sein, néoplasie lobulaire in situ, hyperplasie épithéliale atypique)
ou très élevé de cancer du sein (prédisposition génétique au cancer du sein). Elles ne rentrent pas
dans le cadre du dépistage organisé car elles font l’objet d’une surveillance personnalisée.
Les femmes à très haut risque doivent bénéficier :
d’une surveillance annuelle associant un examen clinique minutieux, l’IRM mammaire et
l’imagerie standard (mammographie ± échographie) ;
l’IRM, à réaliser en premier, est la technique la plus sensible pour détecter une anomalie chez
ces femmes ;
si elle est normale ou bénigne, une mammographie complète le bilan pour rechercher des
calcifications suspectes (risque de faux négatifs de l’IRM dans les cancers in situ) ;
ces patientes doivent être suivies par des équipes ou des centres spécialisés en imagerie du sein.
Pour en savoir plus au cours du congrès
Vendredi 21 octobre
16h00 - 17h30 - amphithéâtre Bleu
Imagerie du sein : état des lieux et contexte médico-légal. Séance thématique.
Samedi 22 octobre
10h30 - 12h00 - amphithéâtre Bleu
IRM et imagerie du sein, les standards en 2011 : la technique. Séance thématique.
14h00 - 15h30 - amphithéâtre Bordeaux
Cours approfondi : Imagerie de la femme - IRM en imagerie de la femme.
Dimanche 23 octobre
10h30 - 12h00 – salle 252
IRM et imagerie du sein, les standards en 2011 : les indications. Séance thématique.
Lundi 24 octobre
16h00 - 17h30 - amphithéâtre Bleu
Nouveautés en imagerie du sein. Séance thématique.
1
/
4
100%