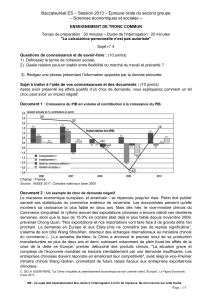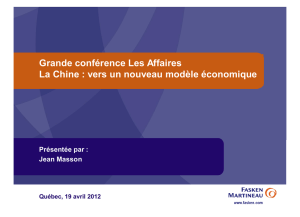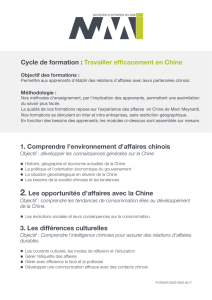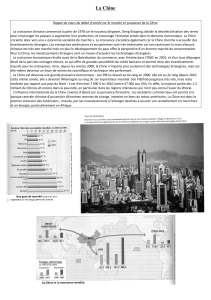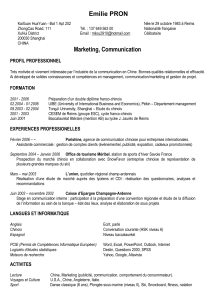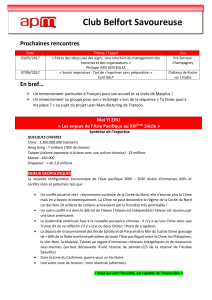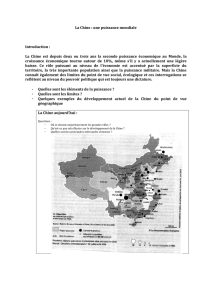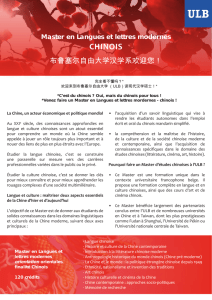173 ESCTER 05 F - Une Chine en plein essor et l`éc

ECONOMIE ET
SECURITE
173 ESCTER 05 F bis
Original : anglais
Assemblée parlementaire de l'OTAN
SOUS-COMMISSION SUR LES RELATIONS
ECONOMIQUES TRANSATLANTIQUES
UNE CHINE EN PLEIN ESSOR ET L’ECONOMIE
TRANSATLANTIQUE
RAPPORT
HUGH BAYLEY (ROYAUME-UNI)
CORAPPORTEUR PAR INTERIM
JOHN BOOZMAN (ETATS-UNIS)
CORAPPORTEUR
Secrétariat international novembre 2005
Les documents de l’Assemblée sont disponibles sur son site web, http://www.nato-pa.int

173 ESCTER 05 F bis
i
TABLE DE MATIERES
I. INTRODUCTION .................................................................................................................... 1
II. LES ASPECTS GÉOPOLITIQUES DE L’ÉMERGENCE DE LA CHINE ET LEURS
IMPLICATIONS TRANSATLANTIQUES ................................................................................. 3
III. LES IMPLICATIONS COMMERCIALES DE L’ÉMERGENCE DE LA CHINE .......................... 7
IV. LA BATAILLE DANS LE SECTEUR TEXTILE : UNE ETUDE DE CAS ................................. 10
V. L’ANGLE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU DEVELOPPEMENT ............................................ 13
VI. LES IMPLICATIONS MONÉTAIRES ..................................................................................... 14
VII. LES FAIBLESSES DU MODÈLE CHINOIS ........................................................................... 16
VIII. LA CHINE : L’ENVIRONNEMENT ET LES MARCHÉS PÉTROLIERS .................................. 19
IX. CONCLUSIONS .................................................................................................................... 21
X. BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 24

173 ESCTER 05 F bis
1
I. INTRODUCTION
1. Depuis sa mise en place par l’Amérique du nord et l’Europe après la Deuxième guerre
mondiale, le système économique libéral ne cesse d’évoluer. D’ailleurs, alors qu’un nombre
croissant de régions dans le monde adoptait les stratégies libérales de marché, le club des pays
développés s’est élargi, avec – pour conséquence – une évolution du système international. Ce
processus ne se déroule pas sans heurts ; des modifications dans l’équilibre économique altèrent
inévitablement les relations entre les Etats et, ce faisant, génèrent de considérables frictions.
L’émergence économique explosive de la Chine laisse cependant entrevoir le bouleversement le
plus important de l’ordre économique d’après-guerre. Cela modifiera inévitablement les relations
internationales et, par extension, les relations américano-européennes, de manière radicale et
peut-être inattendue.
2. La Chine ne peut cependant pas être considérée comme une puissance économique
nouvelle. Avant la fermeture de ses frontières en 1500, elle constituait l’économie la plus
importante et la plus sophistiquée de la planète. Au cours des siècles qui ont suivi, l’Europe
moderne a certes rapidement rattrapé et fini par dépasser la Chine, mais celle-ci représentait
toujours 32 % des richesses mondiales en 1820. (Hale & Hale) Imposée par les puissances
coloniales, la réouverture de ses frontières marqua le début du retour de la Chine sur la scène
mondiale, mais le colonialisme, l’anarchie, les ravages provoqués par les seigneurs de la guerre,
les réactions nationalistes, les deux guerres mondiales, l’occupation, la guerre civile et la
révolution communiste en firent un processus extrêmement chaotique et terriblement douloureux.
3. Il aura en fait fallu attendre les réformes initiées en 1978 par Deng Xiaoping pour que la
Chine communiste entame une évolution plus organique. La réforme a paradoxalement débuté
dans les campagnes, lorsque l’Etat a soudainement autorisé les paysans à adopter des structures
de marché afin d’encourager la production et de stimuler le revenu. Depuis 1994, la révolution
économique de la Chine s’est largement muée en un phénomène urbain et industriel. La
croissance enregistrée sur la côte orientale a largement dépassé celle des campagnes. Entre
1978 et 2003, le PIB chinois par habitant s’est accru de 6,1 % par an, pour enregistrer une
progression de 337 % sur cette période. (Wolf) D’immenses territoires du vaste arrière-pays
chinois échappent cependant à cette évolution.
4. Les changements ont été rapides en Chine, puisque le pays est passé d’un modèle de
propriété communiste, dans lequel l’Etat possédait pratiquement tous les moyens de production, à
un système beaucoup plus complexe, dans le cadre duquel la propriété privée supplante de plus
en plus la propriété d’Etat. La Chine a en outre rapidement progressé sur l’échelle de la
production, en passant d’assemblages très simples à des processus de fabrication sans cesse
plus complexes.
5. D’une façon générale, les possibilités d’action autonome par les individus progressent
également en Chine, en dépit des limitations persistantes, regrettables et en fin de compte contre-
productives imposées à la liberté politique. Le peuple chinois jouit désormais d’une liberté de
circulation sans précédent, tandis que les flux d’informations sont beaucoup plus développés et
ouverts aujourd’hui. Les jeunes Chinois peuvent davantage prendre leur destin en mains, en dépit
des contraintes politiques bien réelles auxquelles ils sont confrontés. Comme l’explique un
analyste occidental, les Chinois ont enfin la liberté de se désintéresser de la politique. Cette
situation ne peut certainement pas être qualifiée de démocratique, mais suggère une évolution
importante par rapport au totalitarisme de la Révolution culturelle, époque à laquelle les Chinois
étaient contraints de ne vivre que pour la politique.
6. Cependant, dans le cadre défini en grande partie par le leadership communiste, le boom
économique de la Chine fournit un exutoire aux énergies commerciales du pays longtemps

173 ESCTER 05 F bis
2
réprimées et aux aspirations de son peuple à une vie meilleure. Ces possibilités nouvelles
détournent certainement une partie des passions politiques à l’origine des graves événements de
la place Tiananmen en 1989 (Hutzler) même si la répression joue également un rôle. La
gigantesque population estudiantine chinoise compte sa part de démocrates en herbe, mais
nombre d’entre eux renoncent tout simplement à la politique pour se focaliser sur leur carrière.
D'après de récents sondages, les Chinois sont en outre formidablement optimistes face à l’avenir,
en particulier ceux qui bénéficient d’une solide formation, car ils sont les mieux placés pour profiter
de l’expansion économique et de l’intégration globale de la Chine. (Giles)
7. La société civile chinoise est devenue plus complexe et plus structurée depuis 1989, et cela
aussi conditionne les aspirations de la population et la manière probable dont les futurs
changements politiques devraient intervenir. De nombreux Chinois reconnaissent aujourd’hui que
leur intérêt réside dans le maintien de l’ordre civil. Cela ne veut pas dire qu’une réforme
démocratique n’interviendra pas, mais permet plutôt de penser que ces changements seront
suscités par de nouvelles stratégies qui émaneront à la fois de l’élite dirigeante et d’une société
civile sachant mieux s’exprimer. Pour reprendre les termes de l’historien Lanxin Xiang, les Chinois
ont fait leur la perestroïka (restructuration) mais ils n’ont aucun désir de promouvoir la glasnost
(ouverture). (Rencontre avec Lanxin Xiang) Il se pourrait que la grande menace pour l’ordre actuel
ne provienne pas de la catégorie d’étudiants visés lors de la répression de Tiananmen mais plutôt
des millions de citoyens privés de droit électoral dans l’immense "Chine profonde", qui ne
bénéficient pas de la réforme et de la croissance économiques. L’élite chinoise en est consciente
et espère clairement qu’en assouplissant les conditions dans l’immense arrière-pays, le régime
sera mieux à même de défendre le statu quo politique et la stabilité requise pour générer la
croissance économique. Mais même cela ne représente qu’une solution provisoire au problème à
long terme que pose l’absence de démocratie en Chine.
8. Voici quelques années, suite à l’éclatement de la bulle financière des valeurs de haute
technologie, les économistes américains se demandaient fiévreusement quel pays pourrait le cas
échéant servir de moteur à la relance économique mondiale. A leurs yeux, l’Europe croulait sous
des réglementations la rendant de moins en moins concurrentielle, les Etats-Unis empruntaient
résolument le chemin de l’accroissement de la dette publique et privée, des scandales financiers
et de l’incertitude des investisseurs, tandis que l’économie japonaise demeurait embourbée dans
une récession déflationniste. Ils considéraient alors que les deux seuls pays prometteurs, l’Inde et
la Chine, étaient trop petits économiquement parlant pour que leurs taux de croissance élevés
puissent avoir un réel impact sur la croissance mondiale. (Voir les commentaires de
Steven Roach, Rapport du secrétariat de l’AP-OTAN, Visite à New York et San Francisco) Il
semble que ces prévisions aient été faites en fonction de l’ancien postulat considérant l’économie
mondiale et les pays membres de l’OCDE comme étant, plus ou moins et en dépit de quelques
oppositions nationales importantes, une seule et unique chose.
9. Cette hypothèse s’est révélée erronée. D’après une récente enquête de l’Economist, la
Chine représente actuellement 13 % de la production mondiale en termes de parité de pouvoir
d’achat (seuls les Etats-Unis la précèdent) et constituera bientôt le troisième exportateur mondial
derrière les Etats-Unis et l’Allemagne. Sa demande intérieure constitue le principal facteur
expliquant le récent redressement de l’Asie et elle joue un rôle de garant majeur du déficit
budgétaire des Etats-Unis, grâce à ses achats de bons du trésor américains. Le FMI estime que,
si la Chine parvient à mettre en œuvre les réformes bancaires tellement nécessaires, elle
poursuivra sa croissance à un rythme de 7 à 8 % par an au cours des dix prochaines années, un
taux qui pourrait propulser le PIB chinois au-dessus de celui des Etats-Unis dès 2020 en termes
de parité du pouvoir d’achat. (The Economist, 2 octobre 2004)
10. La Chine franchit donc un seuil. Son économie ne peut plus être considérée comme une
simple potentialité. Elle constitue désormais un acteur intégral de l’économie mondiale et son

173 ESCTER 05 F bis
3
poids économique international augmente en conséquence de façon spectaculaire. Au cours de
l’année écoulée, l’économie mondiale a enregistré une progression de 5 %. Les deux moteurs de
cette croissance ont été, d’une part, une économie américaine stimulée par des politiques
monétaire et fiscale assouplies, des taux d’épargne fort bas et une forte propension à importer et,
de l’autre, les producteurs chinois, qui orchestrent l’une des plus grandes expansions
économiques de l’histoire récente. Pourtant, la Chine demeure un pays en développement, ce qui
lui confère une position assez unique dans l’économie mondiale, d’autant plus paradoxale
peut-être du fait que cette société qui n’a jamais été aussi libérale, en termes économiques, reste
administrée par un parti communiste.
II. LES ASPECTS GÉOPOLITIQUES DE L’ÉMERGENCE DE LA CHINE ET LEURS
IMPLICATIONS TRANSATLANTIQUES
11. L’émergence économique de la Chine est chargée d’implications géopolitiques, dont
beaucoup ne peuvent manquer de remodeler des éléments cruciaux des relations
transatlantiques. La Chine ne constitue pas encore une puissance véritablement mondiale,
certainement pas au sens où le sont les Etats-Unis. Elle représente toutefois une puissance
majeure en Asie de l’Est et son influence s’étend. Il s’agit, naturellement, d’une puissance
nucléaire qui possède des missiles intercontinentaux, qui a une armée considérable dotée de
systèmes d’armement toujours plus sophistiqués et qui est membre du Conseil de sécurité des
Nations unies. Quant à son poids économique mondial, il progresse à pas de géants. Considérer
la Chine en termes exclusivement statiques serait donc faire preuve d’une extrême négligence.
Elle constitue une puissance mondiale ascendante, même si elle présente certaines
contradictions, et sa présence de plus en plus affirmée sur la scène mondiale modifie la carte
stratégique et économique.
12. Parallèlement, la Chine renonce fortement à l’idéologie révolutionnaire qui inspirait jadis sa
politique étrangère. On la considère de plus en plus comme une puissance privilégiant le statu quo
car elle accorde un soutien accru à un ordre économique mondial et régional libéral, auquel ses
dirigeants se rallient désormais - ce qui constitue la clef de sa prospérité nationale, de sa stabilité
interne et du maintien de l’hégémonie du parti. Elle a également modifié, tactiquement du moins,
sa politique étrangère. Alors que la Chine considérait autrefois les pays en développement comme
sa principale priorité en politique étrangère, ce sont désormais ses relations avec les Etats-Unis, le
Japon et l’Europe qui occupent la place d’honneur, suivies de ses relations avec ses voisins
régionaux et ensuite ses relations avec les pays en développement. (European Policy Centre
Conference, remarques de M. Xinning Song) L’adhésion récente de la Chine à l’OMC et ses
objectifs clairement exprimés au sein de cette instance confirment le fait qu’elle devient une
puissance conservatrice, dédiée à la protection d’un marché de libre échange. Cette approche
facilite les relations de la Chine avec les pays développés, qui entretiennent pour l’essentiel des
relations commerciales meilleures et fructueuses avec ce pays, en dépit de la persistance de
tensions sur des questions telles que les droits de l’homme, l’ambition militaire de la Chine,
Taiwan, la Birmanie et les ventes d’armes. Bien que Taiwan constitue certainement le point
d’ignition stratégique le plus probable de la région, il existe d’autres dangereux défis pour la
sécurité régionale, y compris les tentatives de la Corée du Nord de se doter de l’arme nucléaire et
la dégradation alarmante des relations de la Chine avec le Japon. S’accommoder d’une Chine
sans cesse plus puissante et prospère entraîne inévitablement des défis pour les autres grandes
puissances de la planète. (Schwarz)
13. Depuis 2003, la Chine a accueilli quatre des sessions de pourparlers à six avec la Corée du
Nord, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon et la Russie. Elle se considère comme un
médiateur entre la Corée du Nord et les Etats-Unis dans les négociations sur le problème
nucléaire nord-coréen en pleine aggravation. La Chine a élaboré le cadre des négociations. Les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%