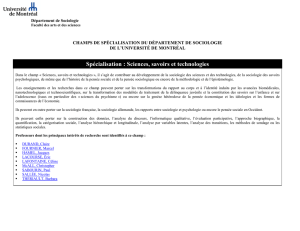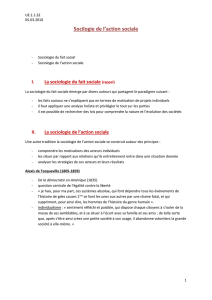la societe

LA SOCIETE
(Réunion d’hommes ayant une même origine et des lois communes / Etat des êtres qui vivent en groupe
organisé)

LA CULTURE ET L’HISTOIRE CULTURELLE
(CULTURE: Ensemble des données acquises et transmises au sein d’un groupe social)
(HISTOIRE : Récit des événements relatifs aux peuples en particulier, à l’humanité en général)
INTRODUCTION
L’histoire se décline en plusieurs périodes entrecoupées d’évolutions. Ces évolutions propres à
certains peuples à certaines époques continuent d’exister aujourd’hui à travers l’intérêt que nous en avons
tiré. L’histoire est ainsi un héritage multiple dont nous ne pouvons pas vraiment nous défaire. Nous
sommes seulement en mesure de l’accepter ou d’y ajouter nos découvertes. Ce riche édifice semble
parfois maltraité, renié, et quelque part condamné. Le respect que nous lui témoignons dépend de notre
attitude face au passé. Avant de le juger, peut-être devrions-nous prendre conscience des possibilités qu’il
nous a apportées. Au fil du temps, l’héritage s’est complexifié, donnant naissance à de nombreux concepts
sur lesquels nous nous basons aujourd’hui. Parmi eux, l’établissement de certains principes. Ainsi, la vie ne
société n’est possible que si l’on respecte certains principes moraux, les lois et des valeurs communes
(liberté, égalité, justice) et les conceptions des autres.
LES DIFFERENTS TYPES DE CULTURES
Mais, qu’est-ce que la culture ? Le mot est ambigu, polysémique. De plus, son sens a varié au
cours des temps. La culture peut se définir selon deux aspects principaux : la culture qui s’apparente à une
compétence acquise par un individu qui cultive ses goûts et sa créativité et la culture qui est le patrimoine
auquel s’identifie un groupe. Notons que cette unité autour d’une culture commune est à l’origine du
nationalisme. La conscience de cette culture commune fut exacerbée lors des révolutions industrielles. Le
nationalisme rattache la culture à l’Etat, ce qui n’est pas sans dangers. Il convient de remarquer qu’une
culture s’établit au gré d’échanges et sous diverses influences extérieures. C’est là sa richesse. Ainsi
s’édifia la société multiculturelle Américaine par une vague d’immigration au début du XXè siècle. D’autre
part, si les hommes semblent s’unir autour d’une culture commune, la culture peut également être à
l’origine de conflits sociaux.
CULTURE ET CIVILISATION
Culture et civilisation sont souvent confondus. La distinction paraît s’imposer. La culture est le
savoir, l’érudition (idées, sciences, littérature, art …). Elle représente le niveau spirituel. Elle est effort
personnel pour enrichir son esprit et s’acquiert avec les années. La civilisation est non seulement
l’instruction, le savoir, l’érudition mais aussi l’éducation, le savoir-vivre, la politesse, l’apprentissage,
l’organisation de la vie, les mœurs, les rites, les lois, l’hygiène, les réalisations techniques et artistiques …
Elle est le développement technique et matériel d’une société. Notons que les nations qui ont le plus
souvent la même langue, la même histoire, des mœurs identiques et le même niveau culturel éprouvent le
besoin de vivre ensemble. Au contraire, des moeurs et des religions différents peut naître une certaine
suspicion, de la crainte, mais également le racisme. Notons simplement que la culture ne connaît pas de
frontières alors que les civilisations en ont.
CULTURE ET CULTURE GENERALE
De même que s’opposent culture et civilisation, culture générale et culture spécialisée méritent
d’être identifiées. La culture générale peut se définir comme l’ensemble des connaissances acquises qui
permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. Mais la culture est aussi le plaisir de
découvrir le monde qui nous entoure et de comprendre ses évolutions. La culture s’acquiert avec le temps
mais il convient de faire attention à ce qu’elle n’inscrive pas dans notre façon de penser des préjugés. Etre
cultivé reviendrait à avoir un point de vue juste sur beaucoup de choses. Pascal disait d’ailleurs : « Il est
bien plus beau de saisir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose ». Il est également judicieux
de distinguer la culture « élitique » et la culture « de masse » qui fait plus appel aux perceptions qu’à la
réflexion. Elle est subie et non pas choisie.
Enfin se pose le problème de l’application du marketing à la culture. Les publicités ne risquent-
elles pas bientôt d’aliéner la culture par un conditionnement abusif ? La culture de masse peut avoir
comme danger d’empêcher l’individu de penser par lui-même, ne faisant plus de la culture le dernier
refuge de l’identité mais le premier pas vers l’uniformisation.

LES MUTATIONS CULTURELLES
La culture a souvent évolué par bonds en véritables mutations culturelles ; après des périodes de
stagnation parfois longues sont venues des phases d’évolution rapides au cours desquelles de nouvelles
voies d’évolution se sont ouvertes. Afin de mieux saisir cet enchaînement, opérons un retour
chronologique :
- La préhistoire est marquée par les premières traces de la culture (peintures et enterrement des
morts). Des inventions rudimentaires voient le jour : outils de chasse, culture de certaines plantes,
élevages. Ils élaborent des croyances et des cultures : mégalithes, rites funèbres, représentations …
L’invention de l’écriture il y a environ 6000 ans marque le début de l’histoire. Grâce à elle fut créé un
excellent moyen de transmission et de conservation de la pensée et de la culture dans l’espace et dans le
temps.
- En Antiquité, des foyers se développent le long des fleuves et sur les bords de la Méditerranée.
Ainsi commence l’urbanisation. L’écriture est sans cesse perfectionnée. C’est une période de conquêtes et
de mythes. Au cinquième siècle Ap. J.C, en Grèce se développe le pensée rationnelle sous l’impulsion de
savants et de philosophes (Socrate, Platon, Aristote, Archimède, Pythagore, Hippocrate…). Le christianisme
s’implanta dans les classes populaires car à la différence des autres cultes, il n’était pas imposé par un
conquérant. Les notations tant littéraires que scientifiques que nous utilisons aujourd’hui ont parfois une
origine que l’on ignore. Par exemple, les Indiens inventèrent le zéro au Vè siècle mais ce n’est qu’au IXè
siècle que les Arabes transmirent cette notion à l’Occident. On peut également s’intéresser aux origines et
aux formes multiples de l’écriture. Hiéroglyphes en Egypte, idéogrammes en Chine, alphabet phénicien
dont dérive l’alphabet aujourd’hui répandu dans le monde, autant de preuves que notre héritage culturel
est multiple. D’autre part, on peut aussi remarquer l’influence de la culture grecque antique en ce qui
concerne l’éducation et l’apprentissage. Quelques siècles plus tard, c’est aussi l’apparition du mouvement
Sophiste qui a contribué à la démocratisation de l’enseignement.
- Le Moyen-âge est marqué par le maintien d’empires menacés par diverses invasions. Il fut une
période d’immobilisme culturel sauf dans le domaine artistique. Malgré tout, le Moyen-âge finit dans
l’accumulation des catastrophes : famines, épidémies, guerres, schismes religieux.
- Les Temps modernes sont une période d’éveil. La Renaissance est caractérisée par un état
d’esprit nouveau : les routes du savoir, tout comme celles du monde furent ouvertes à la curiosité et à la
critique. On fit un retour vers l’Antiquité et de celui-ci naquit le courant humaniste. En même temps,
l’invention de l’imprimerie par Gutenberg eut une importance considérable puisqu’il devint possible de
diffuser les livres et le savoir. Science et religion se trouvèrent fortement opposées puisque la première
remit en question les croyances fondamentales de la seconde (Galilée, Copernic et leurs théories
astronomiques). D’autre part, l’Amérique est découverte et les navigateurs ramènent différents produits en
Europe. Le 18è siècle, appelé « siècle des Lumières » fut une grande époque de fermentation intellectuelle,
scientifique et philosophique. La grande gloire du 18è siècle est d’avoir proclamé la souveraineté du
peuple et d’avoir ouvert la voie aux droits de l’Homme et du Citoyen. Le 19è siècle est marqué par la
mutation industrielle et commerciale de la société. Enfin, au 20è siècle, d’innombrables progrès
scientifiques et médicaux bouleversèrent la société.
LA CULTURE FAIT L’HOMME
L’homme, quel qu’il soit, n’est pas un singe ni un animal primitif car il possède un culture. Cette
culture est emprunte de nombreuses entités symboliques, de coutumes élaborées et de règles de vie bien
déterminées, faisant du comportement humain un comportement acquis. C’est en fait la capacité de
conceptualisation rendue possible grâce à la culture qui distingue l’homme de l’animal. En effet, l’homme
voit au-delà du réel, accordant une place prépondérante au symbolique. Cette appréhension d’un monde
immatériel passe par l’élaboration de croyances, elles-mêmes à l’origine de la métaphysique et de la
condition humaine.
CONCLUSION
En conclusion, le langage et les technologies sont autant les manifestations que les bases de la
culture, et même si celle-ci se détache petit à petit de la nature, elle doit veiller à ne pas l’oublier.

LA SOCIETE EST-ELLE UNE SOMME D’INDIVIDUS ?
« L’homme est né bon et la société le corrompt ». J.J Rousseau
L’INDIVIDU ET LA SOCIETE
Dans la société humaine, chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs. La diversité doit être
protégée dans ses aspects biologiques, culturels et spirituels. La société a une dimension communautaire ;
elle n’est pas une simple somme d’individus. Individu et société sont liés comme les cellules d’un
organisme. En s’associant, ils donnent naissance à une communauté qui a des caractères propres.
En Asie, surtout en Chine et au Japon, le groupe et la nation priment sur l’individu. C’est le
contraire dans nos sociétés occidentales.
Ce qui est bon pour l’individu n’est pas forcément bon pour la société ; C’est ainsi par exemple que
si l’individu souhaite vivre plus longtemps, l’allongement de la vie a des conséquences économiques : coût
des soins. C’est ainsi que les progrès technologiques profitent à la société mais augmentent le chômage en
remplaçant l’homme par la machine. Le thème de l’opposition entre l’intérêt de l’individu et celui de la
société est un sujet de réflexion pour les scientifiques et les philosophes.
LES DOCTRINES SOCIOLOGIQUES
Le mot sociologie naît au 19è siècle au moment de la révolution industrielle. Mais nombreux en
sont les précurseurs.
Socrate fit de l’homme l’objet de la philosophie. Il se détourna des spéculations théologiques et affirma sa
foi en la raison.
A. de Tocqueville (19è siècle) décrivit après un séjour aux Etats-Unis la transformation de l’homme par la
démocratie.
Selon Karl Marx, économiste et philosophe allemand du début du 19è siècle, les processus économiques
sont à l’origine de l’existence de classes sociales antagonistes. Ce ne serait que par le dépassement de
l’aliénation économique et politique que pourra se réaliser la libération concrète de l’homme.
DYNAMIQUES PLANETAIRES
En ce qui concerne l’immigration, il convient de distinguer l’assimilation (les groupes ethniques perdent
petit à petit leurs traditions, leur identité…) et l’intégration (l’immigré se conforme aux règles du pays tout
en gardant ses particularités).
Les facteurs du changement de la situation socio-économique mondiale sont très nombreux et très
complexes. Ils sont communs à tous les pays occidentaux. La convergence vers l’homogénéité, c’est-à-dire
vers un modèle unique s’exprime à travers de nombreux aspects : société de consommation, médias et
techniques font évoluer un modèle unique. Tout est de plus en plus lié dans un monde rétréci. Les langues,
les cultures et les croyances s’uniformiseront-ils si aisément ? Mondialisation ne signifie pas
nécessairement uniformisation. On peut en effet y voir l’émergence d’une solidarité nouvelle, la disparition
des racismes et des intolérances. La science est en quelque sorte le symbole des cette unification du fait
de son envergure universelle (« La science n’a pas de patrie », Louis Pasteur).
CONCLUSION
Finalement, notons que même si l’espèce humaine n’a jamais autant joui d’une telle abondance de
richesses, de connaissances et de puissance économique, il persiste des millions d’hommes qui vivent au
niveau le plus bas, victimes de misères, de famines, de maladies et d’analphabétisme.

LE LANGAGE
(LANGAGE : Système de signes permettant l’expression et la communication de la pensée)
LES FONCTIONS DU LANGAGE
Le langage complexe qu’entretiennent les hommes est incontestablement un des traits
caractéristiques de l’humanité. Est-ce au langage que l’homme doit sa capacité de raisonner ? Même si les
buts premiers du langage sont l’expression et la communication, ses facettes sont multiples. Le langage
dont nous avons hérité et que nous utilisons est le fruit d’une évolution soumise à des influences
historiques (guerres, invasions …) et culturelles. Au fil du temps, les mots furent brassés, d’où une
transformation de la langue et des modifications du langage.
Les fonctions du langage humain sont de communiquer et d’écouter l’autre. Nous communiquons
entre nous soit oralement, soit par écrit, en respectant des conventions d’écriture et certains concepts qui
font partie intégrante d’une civilisation. D’ailleurs, si chacun s’exprimait à sa propre manière, sans
respecter certaines dispositions, il ne serait vraisemblablement pas compris. D’autre part, la connotation
d’un mot peut varier d’une culture à une autre et donner lieu à différentes réactions et interprétations.
C’est la pratique de l’échange qui fait progresser la pensée. D’où une écoute de l’autre qui caractérise
l’homme civilisé, d’une société policée et humainement harmonieuse.
LES LANGUES ET L’HISTOIRE
L’histoire de la langue française est faite d’influences dues au statut de carrefour géographique de
la France. Ainsi, la langue française est issue du latin parlé, transformé en roman, sur un substrat celtique
et enrichie par un superstrat germanique. Ce brassage rend assez bien compte de la multiculture qui est à
l’origine d’un pays ou d’une région. Par ailleurs, on peut noter la grande influence du latin dans le
vocabulaire médical, tendance qui est en train d’être renversée au profit de l’Anglais qui fait aujourd’hui
office de langue internationale.
S’EXPRIMER
La fonction expressive du langage est ce qui en fait sa richesse. Lorsque nous parlons à autrui,
nous pouvons avoir d’autres motivations que la simple communication d’un message clair et rationnel.
Nous pouvons être en proie à des perturbations d’ordre affectif, agités par des pulsions, des passions qui
témoignent de l’activité dualiste de notre cerveau. Lorsque nos affects l’emportent sur notre intellect, la
fonction la plus importante du langage devient la fonction expressive qui se manifeste de différentes
manières. L’intonation, l’accentuation plus ou moins fortes permettent de modaliser un message, de le
rendre menaçant ou agressif sans changer un mot alors que l’énoncé lui-même est neutre. Selon le jeu de
l’interrogation ou de l’exclamation, de la hauteur ou de la sécheresse de la voix, le tout accompagné
d’éléments extra-linguistiques tels que la gestuelle ou la mimique, une phrase peut être sans relief,
informative ou bien devenir un énoncé terrible, coercif. L’impératif, le conditionnel et le subjonctif sont de
véritables « tiroirs psychoaffectifs » puisqu’ils permettent d’exprimer l’indignation, la défense, l’hypothèse …
A la limite, si la fonction de communication a pour but la clarté du message et son arrivée à bon port, si le
critère paraît en être la vérité, la fonction expressive, elle, peut tout au contraire viser au camouflage, au
leurre, par des figures de rhétorique. Il s’agit alors d’avoir un pouvoir sur l’autre, y compris par la violence
langagière (insultes …), aussi bien que par l’humour. En effet, je parle pour communiquer mais ce rapport
entre moi le locuteur et autrui l’interlocuteur est rarement neutre, incolore dans la mesure où nos
personnalités s’affrontent.
Ainsi, la fonction expressive joue dès lors un rôle de différenciation, de démarcation et devient une
fonction très importante dans l’affirmation du soi. Il est donc sage de conclure qu’il serait bien réducteur de
s’en tenir à la simpliste vision du langage, instrument de communication.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%