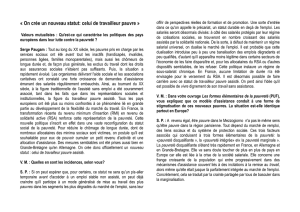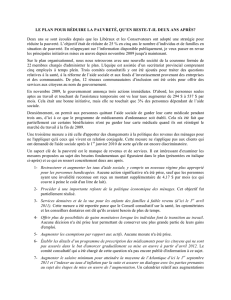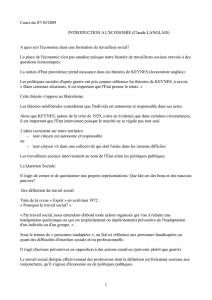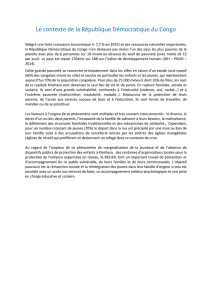Pauvreté, exclusion et sciences sociales - Hal-SHS

1
AISLF (Groupe de travail "Inégalités, identités et liens sociaux")
Universidade Regional do Noroeste do Estado doRio Grande do Sul
CEOS - Investigações Sociológicas - Universidade Nova de Lisboa
Colloque Politiques Publiques, Pauvreté et Exclusion sociale
Ijuí, Rio Grande do Sul, Brésil, 26-27-28-29 novembre 2003.
Michel MESSU
Pauvreté, exclusion… et sciences sociales

2
Le propos de cette communication est de montrer que, de nos jours, les sciences
sociales participent au premier chef de la définition des « concepts » et des politiques
publiques qui y ont recours et en découlent parfois. Conséquemment, c’est la validité
théorique, conceptuelle et explicative d’un certain nombre de phénomènes sociaux qui se
trouvera interrogée et remise en cause.
Pour ce faire, je voudrais rappeler combien les conceptions de la pauvreté que nous
pouvons rencontrer dans les travaux de sociologie ou que nous avons pu rencontrer dans
l’histoire des idées sociales et politiques sont foncièrement dépendantes de ce que j’appellerai
ici un idéal social normatif. Ensuite, je tenterai d’établir comment les sciences sociales ou
plus exactement les institutions qui produisent des sciences sociales contribuent directement à
la formulation de cet idéal social normatif. Enfin, je m’interrogerai donc sur la validité
sociologique des notions de pauvreté et d’exclusion sociale et, peut-être surtout, ce qu’elles
permettent de ne pas penser des transformations de nos sociétés.
Conclu : la pauvreté n’existe pas, seuls existent des pauvres.
1- Pauvreté, exclusion et idéal social normatif.
Si le « pauvre » a pu jouer, historiquement parlant —tant dans la tradition judaïque
que chrétienne, ou encore dans la tradition républicaine laïque—, le rôle de médiateur
symbolique entre les hommes, voire entre les hommes et Dieu, c’est bien parce qu’on a pu lui
conférer, par l’opération d’attribution performative de statut, la charge de réaliser, au-delà de
l’aumône ou de la prestation sociale d’assistance que le reste de la collectivité lui fournit, la
cohésion communautaire ou, en termes plus précis, l’effectuation de l’idéal social normatif.
Autrement dit, si c’est par le truchement du pauvre que se réalise —ou du moins que
s’accomplit pour une part— le renforcement de la collectivité, particulièrement du désir de
« vivre ensemble », c’est cette fonction de médiation qui, sur le plan social, prime plus que la
personne même du « pauvre ». On comprend mieux pourquoi, dans son analyse, Simmel
pouvait faire remarquer qu’en tant que personne et sujet social, le « pauvre » peut n’avoir
aucune importance aux yeux de ceux qui contribuent nonobstant à sa survie personnelle. Dans
la relation d’aumône ou de prestation d’assistance sociale proprement dite, l’individu
« pauvre » peut disparaître en tant que tel, dit Simmel, au profit de l’égoïsme subjectif du

3
donateur —comme c’est le cas dans le Nouveau testament—, ou au profit de la communauté
sociale —comme dans le cas de l’assistance sociale des États modernes. En effet, comme le
rappelle l’auteur de Der Arme, lorsque Jésus dit à l’homme riche : « donne tes biens aux
pauvres », c’est bien le salut de l’âme de l’homme riche qu’il a en vue et non le sort, hic et
nunc, des « pauvres ». De même, dans le cadre de l’assistance sociale légale, il n’est pas
demandé au contributeur de s’intéresser au sort du récipiendaire, mais seulement de ne pas se
soustraire à l’impératif social et à la loi, c’est-à-dire de maintenir sa contribution légale en
s’en remettant cette fois à un fidéicommis —l’État, le plus souvent ; des institutions privées,
fondations, associations…, parfois.
Ainsi, par l’entremise du « pauvre » se trouve assuré la satisfaction des intérêts bien
compris de tous ces acteurs. En premier lieu, l’intérêt du « pauvre » quant à sa survie,
puisqu’il reçoit effectivement. Intérêt fugace en tant que tel qui peut donc disparaître comme
fin de l’action —du don comme de la prestation d’assistance. L’intérêt du donateur, ensuite,
qui en échange de son don reçoit gratifications divines ou gratifications morales, selon le cas.
Ne serait-ce que par absence de sanctions réprobatrices et de déchéance métaphysique ou
sociale, selon le cas toujours. Enfin, l’intérêt de la collectivité qui résulte en quelque sorte de
la satisfaction des deux autres. Quant à l’intérêt de Dieu, on peut par hypothèse l’admettre,
mais nous ne saurions nous prononcer plus avant en la matière, si ce n’est en filant la
métaphore durkheimienne qui avait promu la société équivalent sociologique de Dieu.
2- Pauvreté, exclusion et sciences sociales
De ce que nous avons vu jusqu’ici, on peut avancer que, quelle que soit la société
dans laquelle on le considère, le « pauvre » reste avant tout une figure idéologique, au sens où
seule son image a besoin d’exister pour susciter action et réaction sociales. Certes, cette
dernière est incarnée par des individus, mais c’est sa représentation sous les traits du
« pauvre » qui importe, avec, doit-on ajouter, la représentation du « social » sur lequel il se
détache. La figure du « pauvre » aide en effet à penser l’ordre social et les relations
qu’entretiennent entre eux ceux qui le matérialisent. De ce point de vue, la « pauvreté » est
une notion aussi opératoire que le « travail », la « folie », le « genre » (gender), ou tout autre
clef d’entrée, pour se représenter la société. En effet, et on le sait depuis toujours, la question
que pose l’existence de toute société est celle du processus par lequel les individus qui la

4
constituent établissent les « liens » qui la structureront —y compris ceux, parfois seulement
apparents, d’exclusion. La société des individus que nous a livré Nobert Élias en est bien
l’expression conceptuelle la plus achevée
1
. C’est pourquoi les représentations que les uns se
font des autres participent de ce —ou ces— processus.
Cela dit, et comme nous l’avons également vu, cette représentation du « pauvre »
engage nombre d’enjeux idéologiques et politiques —via la production de discours, parfois à
prétention scientifique, comme ceux du Mouvement ATD-Quart monde, et la mobilisation
politique pour faire pression sur les pouvoirs publics. On peut même dire qu’elle réfléchit
encore une des dimensions de l’activité des chercheurs en sciences sociales. Mieux, et en
dernière analyse, on est en droit d’affirmer que c’est seulement dans ce cadre que les
productions « scientifiques » d’indicateurs de « pauvreté » arrivent à prendre tout leur sens.
De fait, les chercheurs en sciences sociales dans leur ensemble, lorsqu’ils tentent de
décrire la « pauvreté » ou d’en fournir une définition opératoire, ne font que retrouver, pour
l’essentiel, les présupposés idéologiques qui habitent les définitions et représentations de ce
qu’on peut appeler le sens commun demi-savant et partisan des protagonistes du combat
contre la « pauvreté ». Que ce soit à travers la construction des indicateurs de « pauvreté » ou
à travers les descriptions ou témoignages qui émaillent les discours militants, émerge un
véritable common knowledge, et aussi une même vision de la société et de ses principes
fondamentaux de structuration. Élargissons d’ailleurs le propos et affirmons que tout discours
savant —scientifique, religieux ou autre— rejoint le discours de sens commun dans sa vision
de la totalité sociale dans laquelle prend place la « pauvreté ». C’est aussi pour cette raison
que le « pauvre » des sociétés d’ordres ou de castes se présentera, et surtout sera appréhendé,
sous d’autres traits que le « pauvre » des sociétés démocratiques et d’abondance. Et c’est
encore pour cette raison que le discours savant qui en donnera raison sera, dans un cas plutôt
religieux, dans l’autre plutôt scientifique.
La production des indicateurs de « pauvreté » à laquelle se livrent les chercheurs en
sciences sociales —quelle qu’en soit d’ailleurs leur validité du point de vue interne à leur
construction : rigueur de la démarche, sûreté des choix, pouvoir discriminant, etc.—, comme
la mesure —toujours recommencée— du nombre des « pauvres » à laquelle ils se livrent
également, ne sauraient être neutres, comme l’on dit, au regard de cette vision de la société
envisagée ci-dessus.
1
Nobert ÉLIAS, 1991 pour la trad. franç., La société des individus, Paris, Fayard.

5
L’approche monétaire qui est la plus utilisée dans cette production d’indicateurs,
généralement qualifiés de « seuil de pauvreté », tient compte au plus haut point d’une
caractéristique des sociétés modernes : l’importance du caractère abstrait et impersonnel de
l’argent. Ce dernier, comme l’a souligné Simmel dans sa philosophie des Geldes, autorise la
rupture des liens de subordination inter-personnelle qui présidaient à l’échange de biens en
nature. Autrement dit, et quand bien même cet argent lui ferait défaut, le « pauvre » est évalué
à la même aune que le « riche », et surtout, en dehors de tout lien de subordination. De ce
point de vue, le « pauvre » que nous envisageons ici est bien spécifié, c’est celui de la société
démocratique ou société des individus évoquée ci-avant, et qui plus est, des individus saisis à
travers un caractère des plus communs, des plus impersonnels et des plus abstraits : le
quantum d’argent qui les situe dans une distribution sociale —et le plus souvent nationale.
Que l’on prenne un « seuil » absolu comme celui définit par l’UNAF (Union
nationale des associations familiales) —et évalué, en 1998, à 5000 F. par unité de
consommation et par mois— voire celui représenté par les minima sociaux ou toute
combinatoire de ces derniers, ou encore un « seuil » relatif comme celui issu de la méthode
dite du panier de biens et de services —plutôt utilisé aux États Unis parce qu’il tient compte
des disparités géographiques—, dans tous les cas le « pauvre » est appréhendé abstraitement
et impersonnellement
2
.
Ces « seuils » vont d’ailleurs recevoir des significations analytiques bien différentes.
Certains vont prendre le sens de minima vitaux. Ils tentent ainsi de définir un niveau de revenu
en deça duquel la « vie » deviendrait, si ce n’est impossible, du moins extrêment difficile.
C’est bien ce niveau de revenu disponible que retenait, dès 1974, Lionel Stoléru pour définir
ce qu’il appelait le « seuil de pauvreté absolue »
3
. Existerait donc un niveau de revenu au-
dessous duquel ne pourraient être satisfaits les besoins vitaux minimaux des individus, ces
derniers étant de ce fait à considérer comme pauvre « absolument ». En 1988, Serge Milano
prétendra chiffrer ce seuil « absolu » à hauteur de 1655 francs par mois et par personne
4
.
Cette « ligne de pauvreté » partagerait donc radicalement les pauvres des non-pauvres. Outre
les inconvénients bien connus de tels seuils —habituellement qualifiés d’« effets de seuil »—,
la définition desdits besoins vitaux et leur appréciation soulèvent d’emblée de grosses
2
Voir Danièle DEBORDEAUX, 1988, “Les recherches sur les lignes de pauvreté”, Recherches et Prévisions-
CNAF, n° 14/15, décembre 1988/mars 1989.
3
Lionel STOLERU, 1974, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Paris, Flammarion.
4
Serge MILANO, 1988, La pauvreté absolue, Paris, Hachette.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%