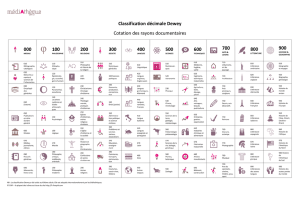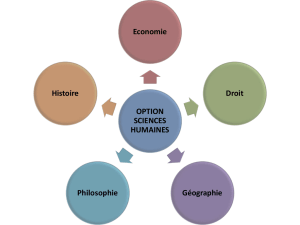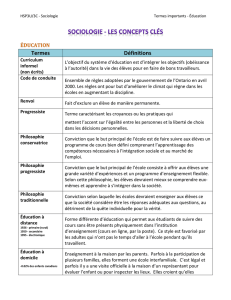Dominique Avon

D. Avon (Université du Maine, France)
LE FAIT RELIGIEUX ET L’INSTANCE CRITIQUE DE L’HISTOIRE
EN CLIMAT LIBÉRAL
La voix publique n’est pas uniforme, la production historienne influe, pour une
part, sur son contenu. Or, les lieux d’expression de l’enseignant-chercheur en histoire
ne sont plus bornés à l’enceinte de l’université, aux maisons d’édition et à une certaine
presse spécialisée. De nouveaux débouchés s’offrent à lui, comme expert responsable
d’audit, dans des entreprises ou organisations internationales, dans les médias audio-
visuels et, ponctuellement, dans le monde judiciaire
1
. La modification de ce rôle culturel
et social provoque un risque de réduction de son espace de liberté, donc de critique.
Sauf exception, justement discutée par les historiens, l’Etat n’impose aucun discours,
les étudiants ne sont plus prédisposés à la révolte comme à la fin des années soixante
du siècle dernier, le marché n’est que de faible pression puisque, en moyenne, nos
publications correspondent à des tirages qui varient entre 1.000 et 5.000 exemplaires.
Un tel cadre devrait prédisposer à des débats d’interprétation sereins sur tel ou tel sujet.
Mais l’on constate plutôt un balancement entre atonie sur des pans entiers de notre
histoire et polémique sur des sujets récurrents. Parmi ces derniers, les débats relatifs
au fascisme ou au communisme ont en partie épuisé les arguments des spécialistes,
l’attention se porte davantage sur la Grande Guerre, les phénomènes de colonisation /
décolonisation, la lecture du développement du capitalisme et désormais tout ce qui
tourne autour du « religieux ». L’option pratique ici défendue est de revendiquer
l’autonomie de la discipline, tout en sachant que le prix à payer est la parcellisation du
savoir, le refus de la prétention à la globalité.
Lorsque l’historien ou le philosophe se penche sur la discipline historique, le
résultat est souvent présenté comme le produit de la rencontre entre la réalité passée et
le chercheur inscrit dans un présent. Il semble aller de soi qu’il écrit d’abord pour lui-
même. De ce fait, l’attention à la société dans laquelle nous vivons, aux étudiants avec
lesquels nous travaillons, aux lecteurs susceptibles d’être accrochés par nos lignes, est
bien souvent négligée. Or, de plus en plus, des voix se font entendre pour exprimer des
réactions diverses, voire contradictoires, sur tel ou tel point de l’enseignement, sur les
présupposés qui pétrissent les manuels du secondaire notamment
2
: ici l’on s’interroge
sur la manière dont l’islam est abordé
3
; là, au contraire, c’est la représentation du
christianisme qui est en question
4
. Ce phénomène illustre l’éclatement pluriel des
sociétés de l’Ouest européen qui, sous des modalités variables et avec de vives
tensions, reconnaît à toute personne la liberté d’accepter un legs sous réserve
d’inventaire lui permettant de combiner des appartenances multiples. Dans le cadre
hexagonal, pour schématiser, il n’y a plus (seulement !) un affrontement entre deux
partenaires, ceux de la France laïque et ceux de la France catholique, comme au début
du XXe siècle où deux catégories de manuels se faisaient face
5
, mais une multiplicité
d’appartenances identitaires (territoriale, générationnelle, sexuelle, nationale…), parmi
1
Olivier DUMOULIN, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, « Bibliothèque Histoire »,
2003, 343 p.
2
Enquête : « Religions à l’École », Science & Vie, n°1003, octobre 2003.
3
Pour une première étude sur un corpus limité, voir Marlène NASR, Les Arabes et l’Islam vus par les manuels scolaires
français (1986 et 1997), Paris / Beyrouth, Karthala / Center for Arab Unity Studies, 2001, 376 p.
4
Projet mené depuis 2004 par des collaborateurs de la revue Histoire du Christianisme Magazine, Jean-Yves Riou (dir.).
5
Christian AMALVI, « L'histoire pour tous : la vulgarisation historique en France d'Augustin Thierry à Ernest
Lavisse 1814-1914. » Thèse soutenue en 1994, sous la direction de Charles-Olivier Carbonell. 3 volumes de texte (1012
pages) et un volume d'annexes.

lesquelles l’identité religieuse n’est pas la moindre. Le cadre général reprend sous
d’autres formes le débat américain entre version positive « melting pot » ou négative
« salad bowl »
6
. Les termes -tel « métissage »- sont ici exaltés et là au contraire
dénigrés. Les expressions politiquement correctes, telle celle de « société pluri-
ethnique », ne résolvent rien dans la mesure où les définitions de l’ethnie restent
problématiques. Devant le caractère hybride de la société, il y a ceux qui sont malades
de certaines différences, et il y a ceux qui disent que la France –plus que l’Europe
d’ailleurs- est malade de ses différences.
Les sociologues et les philosophes qui travaillent sur ces enjeux très
contemporains
7
, plus que la réhabilitation d’un principe de « tolérance » qui accepte –et
soumet- l’altérité absolue de celui où celle qui est différent
8
, sont en quête d’un accord
minimum commun. Michael Walzer, qualifié d’animateur du courant « communautarien
modéré » aux Etats-Unis, écrit ainsi : « Le critère central est donc le suivant : quoi que
nous fassions par ailleurs pour faire coexister harmonieusement les différents groupes,
nous devons défendre la liberté individuelle et permettre aux membres de tous ces
groupes de participer à la vie politique démocratique. »
9
Plus largement, le défi consiste
bel et bien à se retrouver, notamment dans le cadre des sciences humaines, sur un
langage acceptable par tous les spécialistes et accessible au plus grand nombre.
La combinaison de références religieuses, culturelles et idéologiques se
retrouve, sous des termes et des intensités variables, chez des militants catholiques,
protestants, juifs ou musulmans, en réaction à l’état actuel de la société. Au risque
d’enterrer un peu vite la force de la tradition et la demande d’autorité de la part des
fidèles, les spécialistes du fait religieux constatent une dérégulation du « croire »,
expliquent que la religiosité contemporaine prend des formes individualisées –« choix »
et « construction de soi » que peuvent traduire les figures du « pèlerin » et du
« converti »
10
-, mais produit également de nouvelles formes de sociabilité dans un
marché de biens spirituels pluriel
11
, jusque dans ce que le langage courant appelle
« sectes »
12
. La grande majorité de ces observateurs s’accordent cependant pour
signaler une revalorisation socioculturelle du religieux, qu’ils analysent comme
l’expression d’une triple réaction : face à « la fluidité des non-lieux », à « la dissolution
du temps », « à l’individualisme extrême »
13
, ce qui conduit certains à définir la France
comme un « pays laïc de culture catholique »
14
, alors que dans le même temps d’autres
la voit victime d’une exculturation du catholicisme, après avoir connu une perte de
l’emprise institutionnelle
15
. Le combat, en tous les cas, ne se situe plus au niveau du
cadre de l’action de la part des autorités de tutelle pour les croyants. Au milieu des
années 1990, l’évêque d’Angoulême, Mgr Dagens, a exprimé un positionnement sans
détours : « Nous acceptons sans hésiter de nous situer, comme catholiques, dans le
contexte culturel et institutionnel d’aujourd’hui, marqué notamment par l’émergence de
6
Denis LACORNE, La Crise de l’identité américaine. Du melting-pot au multiculturalisme, Paris, Gallimard, « Tel », 2003
(1997), 448 p.
7
Michel WIEVIORKA, La Violence, Balland, « Voix & regards », 2004, p. 40-46.
8
Yves-Charles ZARKA, Franck LESSAY, John ROGERS (dir.), Les Fondements philosophiques de la tolérance, t. 1 Études,
t. 2 Textes et Documents, t. 3 Pierre BAYLE, Supplément du Commentaire philosophique, Paris, P.U.F., « Fondements de la
politique », 2002, 324 p., 454 p. et 264 p.
9
Michael WALZER, Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard, 1998, qui fait suite à La critique sociale au XXe siècle.
Solitude et solidarité, Paris, Métailié, 1996, 275 p.
10
Danièle HERVIEU-LÉGER, Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion, 1999, 290 p.
11
Danièle HERVIEU-LÉGER, La religion en miettes ou la question des sectes, Paris, Calmann-Lévy, 2001, 219 p.
12
Jean-Pierre CHANTIN, Des « Sectes » dans la France contemporaine 1905-2000. Contestations ou innovations religieuses ?,
Toulouse, Privat, « Hommes et Communautés », 2004, 157 p.
13
Jean-Paul WILLAIME, Sociologie des religions, Paris, P.U.F., « Que sais-je ? », 1995, p. 108.
14
Jean-Paul WILLAIME, « Laïcité et religion en France », dans G. DAVIE et D. HERVIEU-LÉGER (dir.), Les identités
religieuses en Europe, Paris, La Découverte, 1996, p. 153-171.
15
Danièle HERVIEU-LÉGER, Catholicisme, la fin d’un monde, Paris, Bayard, 2004, p. 20, p. 36, p. 91-93.

l’individualisme et par le principe de la laïcité. Nous refusons toute nostalgie pour des
époques passées où le principe d’autorité semblait s’imposer de façon indiscutable.
Nous ne rêvons pas à un impossible retour à ce que l’on appelait la chrétienté. C’est
dans le contexte de la société actuelle que nous entendons mettre en œuvre la force de
proposition et d’interpellation de l’Évangile, sans oublier que l’Évangile est susceptible
de contester l’ordre du monde et de la société, quand cet ordre tend à devenir
inhumain. »
16
À quelques années de distance, les responsables musulmans de
mosquées ou d’associations ont, à l’initiative du ministère de l’Intérieur et des Cultes,
été invités à signer une charte qui, bien qu’ayant suscité une controverse sur la notion
de liberté de conscience
17
, n’en fixe pas moins pour l’islam de France la règle
générale : les religions s’inscrivent dans un cadre déterminé par l’État.
Le cadre laïque compris comme possibilité de discrétion rend admissible l’option pour
des histoires désaxées à destination d’un public varié. Il n’est plus possible, si jamais ça
l’a été, de poser comme a priori un « entre nous » qui ferait que nous nous comprenons
à demi-mot parce que nous sommes d’un même côté contre d’autres en face. On y
perd en confort immédiat, on y gagne sans aucun doute en clarté et en exigence de
pensée. Est-ce succomber au mythe d’une histoire « valable pour tous » ? Le sens de
la formule des maîtres de l’école dite positive portait moins sur la partie formelle et
interprétative du discours historien que sur la sécurité des sources. Sans accorder un
caractère absolu à telle ou telle représentation de l’histoire, il paraît possible de se
retrouver sur un niveau de crédibilité suffisant pour servir de base commune aux débats
d’interprétation, ce que Marrou appelait « la zone correcte d’application de la raison
historique »
18
. Napoléon Bonaparte a existé, pour reprendre les termes d’une
expérience historienne célèbre, passons donc aux problématiques sérieuses. Il ne s’agit
pas de moduler le discours en fonction du public, ni de le réduire à un dénominateur
inodore et incolore. Il s’agit de partir d’un ensemble de propositions qui ne dépendent
pas d’un horizon de provenance unique, par exemple confessionnel, lorsque la
recherche s’inscrit dans le champ de l’histoire religieuse.
En d’autres termes, nous partageons quelque pré-compréhension, un ethos
culturel commun, une forme de langage du corps social, un peu plus fine que le
sentiment de commune appartenance à l’humanité ou illustration de celle-ci. Puisque
l’entre-nous s’est élargi au-delà de l’itinéraire Athènes-Jérusalem-Rome-Paris, il devrait
être possible d’aboutir à un stade où les débats peuvent porter sur des questions de
compétence (contresens, référence fausse…), mais pas d’appartenance. D’où
l’exclusion de la question de la « vérité » et du « sens », qui sont des problématiques à
défendre à l’extérieur du champ de l’histoire, pour mieux tenir la distance critique. Il faut
certes prendre au sérieux le reproche du jésuite Paul Valadier, qui a choisi d’opter pour
la confrontation
19
au nom d’une vérité qui ne se négocierait pas, à l’encontre de la
prétention de l’enseignant à approcher le fait religieux de manière laïque : « Même si
son souci premier consiste en effet à faire découvrir les finesses et les beautés des
techniques littéraires ou picturales, vient un moment où il doit bien quitter le point de
vue de la ‘grenouille froide’ et expliquer pourquoi au total il aime ou juge déficiente
l’œuvre étudiée. D’ailleurs les élèves attendent une telle prise de position. Serait-ce de
bonne pédagogie que de prétendre mettre devant des faits sans dire comment on se
situe soi-même, et si on le fait, comment ne pas s’engager, avancer ses raisons,
expliquer pourquoi cela fait sens ou pourquoi on se dit insatisfait et critique ? La peur
d’un dogmatisme (toujours possible) ne doit pas faire tomber dans le piège, bien réel,
16
Claude DAGENS, Proposer la foi dans la société actuelle. Lettre aux catholiques de France, Paris, Cerf, 1996, p. 20.
17
Voir Leïla BABÈS et Michel RENARD, “ Quelle liberté de conscience ? ”, Libération, 26 juin 2000.
18
Henri-Irénée MARROU, De la connaissance historique, Paris, Seuil, « Points », 1954, p. 134.
19
Paul VALADIER, Nietzsche et la critique du christianisme, Paris, Cerf, 1974, p. 585.

d’un positivisme plat et insipide. »
20
Le choix clairement adopté dans les lignes qui
suivent est inverse, parce que le public a, selon moi, moins besoin de maîtres que
d’esprits critiques et parce qu’en matière de recherche et d’enseignement, il m’apparaît
possible de parler avec enthousiasme d’enjeux intellectuels, sans prendre position, par
exemple, pour Thomas d’Aquin contre Avicenne.
20
Entretien avec Paul Valadier dans « Peut-on enseigner les religions d’une manière laïque ? », Le Monde des Religions,
janvier-février 2004, p. 26.

Plaidoyer pour la « grenouille froide »
La question se pose de savoir si, en contrepoint du contexte qui a prévalu au
berceau de l’école des Annales, nous ne serions pas victime d’un retour un force d’une
pensée libérale qui estime que, le temps aidant, la société se modernisera peu à peu
via son élite, et donc présuppose, outre une philosophie de l’histoire, la conviction d’une
vocation européano-américaine à une mission universelle de cette civilisation opposant
de manière renouvelée les lumières de la raison à l’obscurantisme des passions. Après
la crise de l’idée de progrès marquée par le retour aux terroirs, aux cultures, aux
coutumes, aux traditions orales, au quotidien de l’homme du peuple, reviendrait en
force cette conviction que, poussée par la liberté rebaptisée freedom, notre monde irait
mécaniquement vers plus de justice.
En tant qu’historien, je ne cherche ni à changer ni à conserver ce monde, je ne
tire pas de leçon du passé, mais, dans le champ des idées qui m’occupe, je travaille à
la relativisation permanente du discours, au dépouillement des affirmations
dogmatiques et des cosmologies de toutes sortes. Philosophie de la conscience
d’inspiration néo-kantienne ? Peut-être, la formule m’a frappé : « Notre siècle est le
siècle propre de la critique, à laquelle tout doit se soumettre. La religion par sa sainteté,
et la législation par sa majesté, veulent ordinairement s’y soustraire. Mais alors elles
excitent encore contre elles un juste soupçon, et ne peuvent prétendre à ce respect
sincère que la raison accorde seulement à ce qui a pu soutenir son libre et public
examen. »
21
Avec Kant, la critique bénéficiant de l’effort philologique de Le Clerc et
surtout de Bayle, est devenue le nœud de l’expérience rationnelle, philosophique,
jusqu’à s’identifier, pour un courant du moins, à la philosophie elle-même. Enrichi par là,
je conçois l’histoire religieuse comme un espace agnostique, qui ne rejette, ne nie, ni
n’affirme le divin.
Il va de soi que la fonction critique n’est pas le tout de la philosophie, encore
moins de l’histoire et, même en leur fonction critique, l’une comme l’autre restent
influençables. En outre, l’exercice critique n’implique pas la condamnation au silence.
Le débat comme l’herméneutique restent ouverts. Bergson a montré que même après
les critiques de Kant et le positivisme de Comte, une connaissance métaphysique
restait possible, du moins ne devait pas être rejetée à priori. Sur ce point, je m’inscris
dans la voie indiquée par Henri-Irénée Marrou parlant d’epokhé, soit la « suspension
des préoccupations existentielles les plus urgentes »
22
. Que nous soyons tentés
d’intervenir personnellement est une chose, tout particulièrement lorsque nous
approchons de l’histoire la plus contemporaine, que nous succombions à cette tentation
en est une autre. Écrivons l’ambition épistémologique d’un trait : il est possible de
présenter les chants chrétiens de Manzoni et, dans un même mouvement, la raillerie de
la sensibilité religieuse par Carducci sans prendre position pour celui-ci ou pour celui-là.
Le discours historien ne se limite certes pas à l’explication, au sens de l’établissement
des connexions causales et d’une hiérarchisation des faits, mais il est possible, dans la
phase interprétative et pour autant qu’elle se distingue de la précédente, d’en rester à
un « sens » problématique sans y introduire des « valeurs ». De ce point de vue, la
discipline, est a-morale, elle ne vise pas à être leçon.
Afin d’expliciter cette position, prenons l’une des questions les plus caricaturales
en histoire religieuse : Si Dieu est, de quel côté se place-t-il ? Pendant la Civil War, au
Nord comme au Sud des Etats-Unis des pasteurs évangéliques ont appelé à la « sainte
21
Emmanuel KANT, Critique de la raison pratique, Paris, P.U.F., 1965, 192 p.
22
Henri-Irénée MARROU, De la connaissance…, op. cit., p. 237.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%