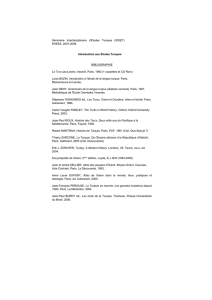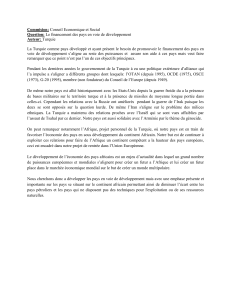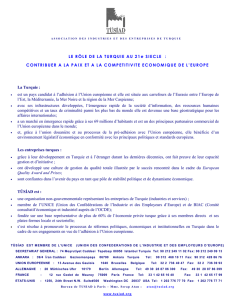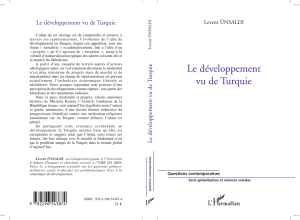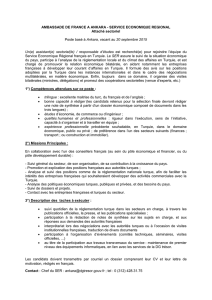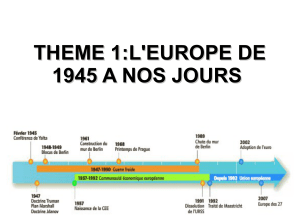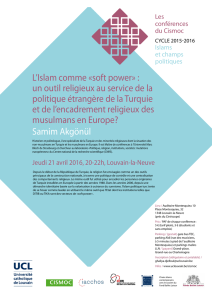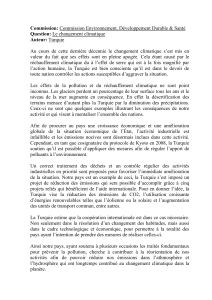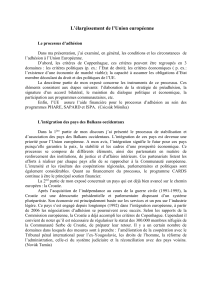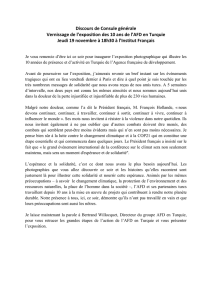La Turquie entre trois mondes Table ronde organisée par Marcel

FIG 2012 – La Turquie entre trois mondes 1
La Turquie entre trois mondes
Table ronde organisée par Marcel BAZIN, professeur émérite, université Reims
Champagne-Ardenne,
avec Stéphane DE TAPIA, directeur de recherches, CNRS,
Ahmet INSEL, professeur, université de la Sorbonne
et université Galasataray, Turquie,
A. SCHAÏNOS, et animée par Patrice DE BEER,
ancien correspondant du Monde à Washington
La vidéo est disponible sur le site des Actes du FIG.
Notions, mots-clés
Turquie
Union européenne
pays émergent
migrations
Inscription dans les programmes
1re bac pro
4e
Tles L, E, S
La Turquie est membre du G20, c’est une démocratie et également une puissance
émergente. Pourtant, il existe des journalistes encore emprisonnés en Turquie. Le
gouvernement est au pouvoir depuis dix ans et il maintient des habitudes anciennes.
D’autre part, les questions chypriote et arménienne sont toujours en suspens.
La Turquie est-elle située en Europe ? En Europe politique ou géographique ?
La Turquie est la 16e puissance économique du monde, avec 75 millions d’habitants.

FIG 2012 – La Turquie entre trois mondes 2
Ahmet INSEL dresse un tableau général de la Turquie, puissance
émergente. Selon lui, c’est bien une puissance émergente dans sa
dimension économique, qui émerge dans les années 2000.
En 1963, la signature du traité d’Ankara avec la CEE permet à la Turquie de réaliser
qu’elle a un potentiel.
La vitesse d’émergence de la Turquie contemporaine correspond-elle à un
rattrapage ou à une dynamique nouvelle qui va durer ? Il est encore trop tôt pour le
dire aujourd’hui car le PIB/hab. est encore inférieur à celui des pays européens.
L’économie turque est dynamique. La démographie prévoit 90 à 95 millions
d’habitants à l’horizon de 2050 : dans la région, elle représente un poids important
qui place la Turquie en 2e position des pays les plus peuplés, après la Russie, dans
l’environnement européen.
Mais cette économie dynamique s’essouffle en 2012, avec une croissance de
« seulement » 3 % par an, perçu comme un ralentissement de la croissance.
La différence entre la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Turquie : la société
turque est très confiante en son avenir, positive, optimiste (pour 60 à 70 % de la
population).
Le pouvoir de la droite libérale (économiquement) et autoritariste (politiquement) est
porteur d’espoir.
La fermeture des portes européennes entraîne un dépit et une réponse à l’appel du
Moyen-Orient. La Turquie est un pays qui se veut, et se revendique, un pays du Sud,
mais qui, en même temps, se trouve au cœur des institutions du Nord (Otan, OCDE,
Conseil de Sécurité de l’Onu, candidat à l’UE) : c’est un modèle, plus que le Brésil.
Des faiblesses structurelles sont à noter :
une économie qui épargne peu, la Turquie a donc besoin de financements
extérieurs pour ses investissements ;
une faible participation des femmes au travail (27 % seulement).
Ainsi que deux failles politiquement importantes :
le problème ethnique kurde qui ne trouve pas de solution et qui peut aller
jusqu’à une guerre civile ;
le problème religieux avec les sunnites.
Le nationalisme turc est politiquement porté par le parti au pouvoir : pouvoir
autoritariste, hérité du kémalisme, voulant régenter le pouvoir par le haut.

FIG 2012 – La Turquie entre trois mondes 3
Intervention de Stéphane DE TAPIA
La Turquie est au cœur d’un monde turcophone, avec un arc de cercle sur l’Asie
centrale.
L’islam est très vivant présent dans cet État laïc. En effet, la laïcité turque est fondée
sur un modèle ancien, avec un contrôle de la religion par l’État, qui ne ressemble pas
au modèle français.
La migration turque s’étend sur l’ensemble des terrains irrigués par les réseaux
originaires de Turquie : une partie des Juifs séfarades ; une population arménienne
en grande partie disparue (quelques dizaines de milliers dans une partie d’Istanbul) ;
plus récemment, les Kurdes, éparpillés en Asie centrale, qui se comportent comme
une véritable diaspora.
Le champ migratoire turc s’est construit à partir des années 1950.
Le monde turc : langue du groupe altaïque, originaire de Sibérie et de Mongolie
centrale. C’est un cas majeur d’extension linguistique, comme l’a montré Louis
BAZIN (père de Marcel BAZIN). Il y a des Turcs dans le monde entier.
La sphère culturelle turque empiète largement sur le monde russe : l’éclatement de
l’URSS l’a montré, avec la constitution de nombreuses républiques turcophones,
comme l’Azerbaïdjan par exemple.
Il y a une myriade d’environ 25 à 40 peuples turcophones, qui regroupent près de
75 millions de turcophones (autant que la population turque).
L’agence TICA (Turkish International Corporation Agency) a été créée pour coopérer
avec le monde turc et turcophone, également TUCSOÏ, ainsi que les mouvements de
panturquisme et panislamisme.
Tartares et Ouzbeks sont dans une grande proximité culturelle avec les Turcs.
Mais il existe des revers car ces Turcs d’Asie centrale attendaient que la Turquie soit
en relation avec l’Europe et les États-Unis et sur ce point, ils sont déçus.
Intervention de A. SCHAÏNOS
Les négociations entre la Turquie et l’UE ont été initiées en 1959 ; les relations
franco-turques, tendues sous la gouvernance française de Nicolas Sarkozy, se sont
normalisées avec Fraçois Hollande.
La Turquie est-elle une menace démographique pour l’UE ? En Turquie, on
s’interroge : pourquoi rejoindre une UE en crise ?
Avec l’ouverture des négociations, il y a eu un sentiment d’humiliation de la part de
l’UE, notamment avec les diplomates de l’UE venant inspecter le vote en Turquie.

FIG 2012 – La Turquie entre trois mondes 4
La demande d’adhésion de la Turquie à l’UE a eu lieu juste après celle de la Grèce
(qui a pour sa part adhéré à la CEE en 1981).
En 1963, les accords d’Ankara permettaient d’envisager l’adhésion à l’UE, mais
depuis, la Turquie est restée en attente.
Depuis quelques années, le problème est moins visible et semble s’arranger,
d’autant que l’UE connaît une situation économique difficile. Pour la Turquie, il y a
désormais d’autres priorités vers l’Est et le Moyen-Orient, bien qu’elle n’aspire pas
non plus à se couper de l’UE.
Ouvrir l’UE à la Turquie, c’est aussi ouvrir les frontières de l’UE à l’Iran, à la Syrie…
et ainsi à d’autres problèmes géopolitiques. Mais ce serait aussi une ouverture sur
l’avenir, avec une possibilité d’équilibrer les forces UE/États-Unis.
L’UE a besoin des forces économiques de la Turquie, de sa main-d’œuvre, de sa
jeunesse et de son taux de consommation fort.
Les réticences à l’UE sont surtout le produit de l’histoire, d’une mémoire commune.
Intervention de Marcel BAZIN
Il existe deux Turquie, voire plus.
Aujourd’hui, le pays se construit sur un modèle unitaire car il existe une diversité et
une disparité de la Turquie.
Diversité en trois clivages :
Turquie maritime/intérieure
Turquie ville/campagne
Turquie Ouest/Est
L’espace de la mer Noire s’ouvre également.
En Turquie, les régions naturelles s’opposent aux régions maritimes
méditerranéennes et à l’intérieur, qui est plus âpre, steppique.
Cette diversité géographique dote le pays d’une richesse paysagère qui entraîne une
richesse des productions et des cultures locales.
Une autre disparité, plutôt négative celle-ci, concerne notamment la répartition de la
richesse, avec un écart de 1 à 10 entre riches et pauvres. Le triangle métropolitain
Istanbul/Ankara/Izmir constitue le bassin le plus riche ; il présente sur ce point une
homogénéité avec l’UE.
Boom industriel sur l’Ouest du pays (en opposition avec l’Est rural).
Urbanisation très forte vers l’ouest, sorte d’européanité qui se diffuse.

FIG 2012 – La Turquie entre trois mondes 5
Intervention de A. SCHAÏNOS : La laïcité en Turquie
La laïcité est très élitiste en Turquie, depuis 1920. En effet, historiquement instaurée
à cette date sous Mustafa Kémal, la laïcité ne concernait alors que les citadins, qui
ne représentaient à cette époque que 20 % de la population.
Aujourd’hui, la laïcité est encore superficielle, car le pouvoir politique a pu changer
les citadins. À partir de 1950, l’exode rural fut très fort et entraîna des changements
dans les structures citadines. Le phénomène s’accélère vers 1980, avec un
deuxième exode rural impulsé sous l’action du FMI et de la Banque mondiale qui
réforment le secteur agricole, puis un troisième, vers 2000, avec un nouveau
programme du FMI en 1999 (3 millions de personnes ont quitté l’agriculture
entre 2003 et 2008). Ayant perdu leur culture campagnarde, ces populations se sont
trouvées « égarées » dans les villes et ont constitué des fiefs électoraux pour le parti
politique de leur religion, véhiculant leurs valeurs.
Actuellement, on passe d’une laïcité superficielle à une laïcité typique de la Turquie.
Intervention de Marcel BAZIN : La question kurde
Marcel Bazin présente une carte de 1950 jusque 1965 avec la langue maternelle et
la deuxième langue la mieux comprise : en 1950, juste avant l’exode rural avec les
bastions d’origine des grands groupes linguistiques, on remarque une grande
homogénéité de l’aire turcophone et une aire considérable sur 13 départements).
Le kurde est une langue du dialecte iranien.
Dans les années 1930, des déplacements forcés de Kurdes ont eu lieu en vue de les
assimiler dans des villages turcs ; cette loi fut annulée en 1947, ce qui a permis leur
retour dans leurs villages d’origine. Ils sont ensuite repartis vers l’ouest et les
grandes villes pour trouver du travail : la ville actuelle la plus peuplée de Kurdes est
Istanbul, suivie de Téhéran.
Le GAP, grand programme de développement économique régional du sud kurde
(base hydraulique avec 20 grands barrages), a entraîné une situation très complexe
et difficile pour les habitants de la région.
Le fait kurde a maintenant émergé, la langue kurde n’est plus interdite : journal,
édition, partis politiques.
Mais une complexité sur le fait kurde persiste, avec une faiblesse pour la stabilité
turque et une complexité dans les relations avec les voisins.
 6
6
1
/
6
100%