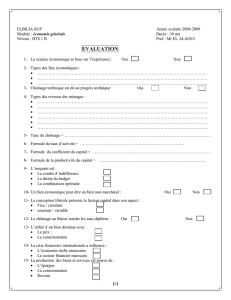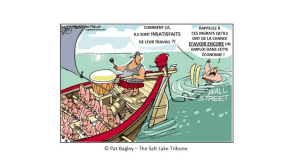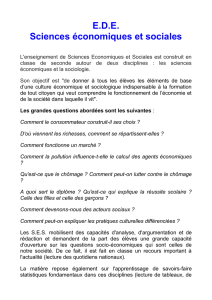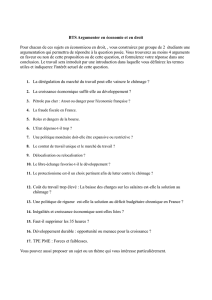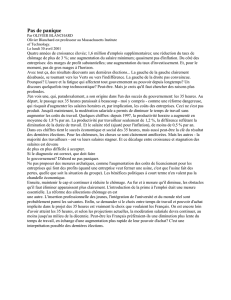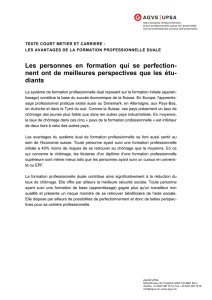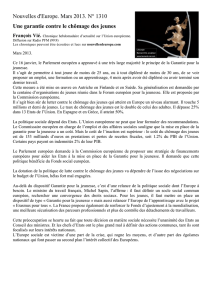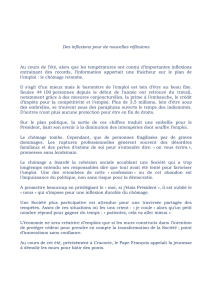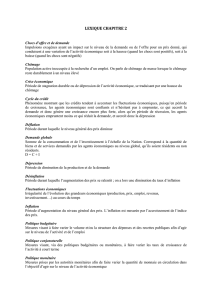Quelle signification donner aujourd`hui à la notion de plein

1
Quelle signification donner à la notion de plein-emploi ?
----------------
Se poser ainsi cette question laisse entendre qu’une notion, même définie théoriquement
et juridiquement, pourrait avoir plusieurs significations ou une signification évolutive, voire
ne pas ou ne plus en avoir. C’est aussi envisager que la signification réelle pourrait être
différente voire contraire à la finalité induite par la définition.
De fait, la notion en question étant constituée elle-même de deux notions sa
signification sera fonction du sens donné à plein d’un côté et emploi de l’autre. Par ailleurs, le
plein emploi a une portée économique mais aussi sociale qui peuvent ne pas être en
cohérence. Enfin, comme toujours en économie, cette notion prendra une « couleur »
différente selon l’école théorique qui s’y réfère.
Pour tenter d’y voir plus clair on visitera cette notion dans un premier temps, autour de
la double acception de la notion de « plein », vue du côté de l’entreprise et du côté des salariés
et dans un deuxième temps, en relation avec la transformation de la notion « d’emploi » dans
les sociétés contemporaines.
I- Employer à plein ou employer pleinement
A- Cohérence théorique
Le plein emploi, c’est d’une part, la pleine utilisation des capacités de production, en
fonction de l’état des techniques et des débouchés des entreprises, et, d’autre part,
l’absorption de l’ensemble des demandes d’emplois sur le marché du travail. Faire en sorte
que ces deux impératifs entrent en cohérence est évidemment indispensable mais non
spontané. On peut même considérer, en simplifiant un peu, que le débat théorique se situe au
niveau des conditions de cette mise en cohérence. Pour les libéraux, le deuxième objectif doit
s’adapter au premier, pour les keynésiens le premier doit évoluer pour répondre au second,
quant aux marxistes,la nature même du système interdit qu’il puisse y avoir cohérence.
Les libéraux d’abord. L’entreprise achète le travail en fonction de ses besoins et de ses
capacités financières. En cas de sous emploi (chômage), l’équilibre se rétablira par la
fluctuation des salaires, à condition évidemment qu’aucune aide au chômage et aucune
réglementation ne viennent pervertir ce marché. La baisse des salaires stimulera l’embauche
par les chefs d’entreprise et découragera l’offre de travail. La cohérence est donc affaire
d’équilibre marchand.
Les keynésiens ensuite. Ils contestent cet équilibre spontané du marché et envisagent
donc ce qu’on appelle un équilibre de sous emploi. Pour autant, il n’est pas question de ne pas
tenir compte des besoins de l’entreprise et d’embaucher au-delà de ceux-ci Il convient donc
pour répondre au deuxième impératif d’augmenter les besoins des entreprises en capacités
humaines de production. Pour cela, l’accroissement de la demande de biens et services, par
effet de multiplication et d’accélération, permettra de rétablir l’équilibre, en particulier
lorsque le sous-emploi correspond à une situation de récession, donc de sous utilisation des
capacités de production. Il y a donc là aussi cohérence entre les deux impératifs mais dans un
équilibre dynamique, la croissance apparaissant comme facteur de plein emploi.
Les marxistes enfin. Les contradictions mêmes du capitalisme impliquent une situation
de chômage chronique (armée de réserve) aggravé par la paupérisation qu’elle induit,
conduisant à des crises de surproduction de plus en plus graves. Toute situation apparente de
plein emploi n’est que l’élimination d’une partie de la population qui se paupérise et se
marginalise.

2
La douloureuse faillite de la vision libérale dans les années trente, mais aussi
l’impuissance des politiques keynésiennes à enrayer la montée du chômage à la fin des années
soixante-dix, enfin la persistance et l’aggravation de celui-ci, depuis le retour des thèses
libérales, obligent à s’interroger sur la pertinence de ces deux grandes théories qui
monopolisent le débat contemporain. Si la vision marxiste semble en apparence se vérifier, les
conditions sociales et idéologiques sont fort éloignées d’une éventuelle perspective
révolutionnaire et donc ne permet pas de fournir des solutions opérationnelles dans la
situation actuelle.
B Une réalité disjointe
Les limites des deux théories par rapport à la situation présente :
- La thèse libérale d’abord :
- Si la fluctuation du salaire peut évidemment avoir un effet sur l’emploi, elle se
heurte rapidement à des limites de nature différente :
- Quel que soit le très bas niveau des salaires, une entreprise n’embauchera que dans
les limites de ses besoins
- Le salaire ne peut descendre au-dessous d’un niveau permettant des conditions de
vie minimum. Or même le SMIC, tant fustigé par certains, est déjà plutôt au-
dessous de ce niveau dans la société actuelle, surtout si en même temps sont
supprimées les charges sociales permettant la solidarité collective pour les services
essentiels.
- La thèse keynésienne ensuite :
La relance par la demande peut répondre à une situation de récession, mais une fois
la croissance repartie, si le sous-emploi se maintient ou réapparaît, se pose
l’opportunité de la course infinie à la croissance qui risque d’aboutir à du gaspillage, à
l’inflation, à la perte de compétitivité internationale. Par ailleurs, la croissance n’est
pas une garantie absolue de hausse de l’emploi, entre autres du fait des gains de
productivité.
Au-delà de ces critiques théoriques, il convient de rappeler que le sous-emploi, et donc
le plein-emploi, n’est pas seulement affaire d’équilibre ou de dynamisme économique, ce qui
remet en question le concept même de marché du travail. En réalité, il s’agit d’un marché
pour les entreprises, qui viennent acheter la marchandise travail en fonction de leurs besoins
et du prix de celle-ci, mais pas pour les salariés. Si ceux-ci ont bien un besoin, ce n’est pas de
vendre une marchandise mais d’obtenir les moyens d’existence (d’où le fait qu’on parle de
demande d’emploi). Ils n’ont ni la possibilité de se retirer ni de choisir de vendre une autre
marchandise en fonction de l’état du marché. Les fluctuations des salaires auront donc un
effet sur ces conditions d’existence mais pas vraiment sur leur présence sur le marché du
travail. Pour se placer à un niveau macroéconomique ou macrosocial, les variations de l’offre
de travail obéissent à des motivations non strictement économiques et sans rapport direct avec
l’état du marché. L’arrivée du Baby-boom et le retour des femmes au moment justement où le
marché est en train de se dégrader est la preuve éclatante de cet état de fait.
Il n’est pas question de s’attarder ici sur les conditions et motivations de l’arrivée
massive des femmes sur le marché du travail salarié, mais de constater qu’alors que le travail
des femmes avait toujours été considéré jusqu’alors comme élément de compensation de
l’insuffisance de la main d’œuvre masculine (période de guerre par exemple), depuis la 2ème
guerre mondiale la situation est totalement différente et interdit la régulation « spontanée » du
marché. De 45 à 70, il y a pénurie de MO et pourtant c’est la période où le taux d’activité
féminine descend au plus bas ; depuis 75, il y a chômage massif et durable et le taux d’activité

3
des femmes ne cesse de croître. On peut même avancer que le chômage et la baisse du
pouvoir d’achat de certains ménages poussent à l’emploi des femmes pour assurer au mieux
les conditions minimum d’existence du ménage.
Bref, au-delà du problème, spécifique et néanmoins majeur aujourd’hui, du travail des
femmes, l’offre de travail est déterminée d’abord par des facteurs démographiques et socio-
culturels (y compris en termes de statut et de lien social) bien davantage que par l’état du
marché ou le niveau des salaires. Au fond, rappeler que le travail n’est pas seulement une
marchandise est assez banal, mais indispensable pour comprendre les échecs des politiques
actuelles et éviter les mesures aux effets pervers voire dangereux.
Par ailleurs, la demande de travail est aussi fonction de l’évolution des techniques de
production et plus particulièrement des gains de productivité qui structurellement et
durablement réduisent les besoins relatifs de MO. L’adaptation à cette évolution ne peut
évidemment se résoudre à la simple élimination (« dégraissage ») du surplus de MO. Par
ailleurs, même une redistribution équitable de ces gains de productivité en direction des
salariés n’aurait aucun effet direct sur ceux que cette modernisation a éliminé de l’activité
productrice.
La situation contemporaine cumule les phénomènes démographiques, socio-culturels et
technologiques dont l’ampleur et la rapidité ne font qu’aggraver la situation. On comprend
mieux pourquoi les différentes politiques mises en œuvres depuis quelques années n’ont pas
réussi à combattre efficacement le sous-emploi. Mais il est aussi souhaitable de prendre en
compte les effets pervers ou dangereux d’une politique qui viserait obstinément le plein-
emploi en terme essentiellement comptable, faisant l’économie du contenu social et financier
de la notion d’emploi. L’examen critique des politiques contemporaines nous permettra de
lancer cette réflexion.
II- Plein emploi ou pleine activité.
A Des politiques économiques impuissantes…
De 1945 à 1975, le plein emploi est réalisé quasiment à 100%. L’effort de
reconstruction, de modernisation de l’appareil de production, le baby boom, la mise en route
de la société de consommation stimulent exceptionnellement la demande de MO, face à une
offre de travail déprimée par des classes creuses et la baisse de l’activité féminine, compensée
par une forte immigration. Le plein emploi est donc d’abord une donnée de fait plus que le
résultat de la politique keynésienne, en vigueur à l’époque, sinon que la régulation par les
politiques budgétaires et monétaires dans le cadre d’une économie en partie administrée
(planification, nationalisations, système de protection sociale) maintient une croissance
continue hors de tout phénomène cyclique.
Le passage rapide à des politiques d’inspiration libérale dès les premiers signes
inquiétants de chômage, ne permet pas vraiment de savoir si le maintien des pratiques
keynésiennes aurait permis d’enrayer cette montée du chômage né de la conjugaison du
ralentissement normal des stimulants à la production et de l’explosion de la population active
(plus de 5M d’accroissement entre 70 et 90 en France, contre moins de 2M de 50 à 70).
Face à la stagflation de l’époque, les libéraux, fidèles à leurs principes fondamentaux,
donnent la priorité à la lutte contre l’inflation et s’attachent à libéraliser progressivement
l’économie (déréglementation, marchés financiers, privatisations), à favoriser l’épargne et à
rendre le marché du travail plus flexible. Cet « assainissement » ne peut pas ne pas déprimer
l’emploi dans un premier temps, mais doit permettre de rétablir « l’ordre naturel » dans lequel
les mécanismes du marché joueront pleinement leur rôle régulateur, y compris bien sûr au
niveau de l’emploi.

4
Vingt à trente ans après, les résultats sont tangibles en termes d’assainissement :
inflation jugulée, fort désengagement de l’Etat, déréglementation, rôle majeur des marchés
financiers. Les effets sur l’emploi sont moins probants et surtout plus contrastés.
Tout d’abord, il faut rappeler que si le néolibéralisme actuel intègre les préoccupations
vis-à-vis de l’emploi c’est, malgré tout, dans les limites d’une stricte maîtrise de l’inflation.
Ainsi, inspiré par M Friedman et sa thèse du taux de chômage naturel, un indicateur (NAIRU)
prétend mesurer le niveau de chômage au-dessous duquel l’équilibre serait rompu et
déclencherait l’inflation. Aussi, dans ces conditions, le plein emploi (d’équilibre) ne
correspond pas à un plein emploi social (chômage zéro). Le « taux de plein emploi » est
généralement serait considéré comme atteint avec un taux de chômage entre 4 et 5% (soit
plus de 1M de chômeurs en France et 6M aux EU).
Si les EU semblent avoir atteint ce taux de chômage prétendument naturel, les pays
Européens dans leur ensemble le dépassent encore du double ou du triple, y compris
l’Allemagne qui était imprudemment montrée en exemple naguère par ceux pour qui l’herbe
est toujours plus verte de l’autre côté de la barrière. Cette différence ne tient pas à ce que la
libéralisation de l’économie serait moins « avancée » ici que là. Y compris la France, qui
adhéra un peu plus tardivement à cette nouvelle orientation, a montré un zèle singulier dans sa
lutte anti-inflation, la rigueur salariale et le désengagement de l’Etat. Le contraste s’explique
bien davantage par la différence de conception de la notion d’emploi elle-même, conjuguée à
une forte productivité, en particulier en France et en Allemagne. Cette distinction à la fois
juridique et culturelle permet de faire apparaître les effets, pervers ou non, de la recherche
systématique du plein emploi sur la notion même d’emploi.
B… ou destructurantes.
Ou l’emploi n’est envisagé que sous son aspect marchand et toute activité rémunérée y
correspond, c’est la conception américaine du « job ». Ou l’emploi est envisagé sous un
aspect social et juridique et il devra répondre à certains critères en termes de durée, de
rémunération, de garantie de stabilité, mais aussi de qualification, de statut identitaire, voire
d’utilité sociale. C’est la conception européenne, française entre autres, qui résiste à une trop
grande flexibilité marchande, mais favorise le chômage en situation de « trop plein ».
Notons à ce propos que cette dernière acception explique la confusion dans l’usage des
mots offre et demande sur le marché du travail, mais aussi la difficulté d’avoir un langage
commun en ce domaine. En fait, il y a deux demandeurs et pas d’offreurs : un demandeur de
marchandise (force de travail) pour l’entreprise et un demandeur de statut social pour le
salarié. Or, sauf hasard de la conjoncture et encadrement légal du marché du travail, aucun ne
peut répondre vraiment à la demande de l’autre, puisqu’elles ne sont pas du tout de même
nature. A la recherche d’un statut, le salarié ne pourra, ou ne devrait, offrir sa force de travail
qu’autant qu’il y trouve un statut digne (sans rapport avec les lois du marché). L’entreprise ne
produit pas de statut social et d’ailleurs ne pourra pas répondre pleinement à cette demande
quelle que soit la pression de la demande, contrairement à l’expression saugrenue de création
d’emplois (ce serait d’ailleurs le seul marché où l’offreur serait celui qui paie aussi la
marchandise qu’il offre).
Cependant, devant la persistance du chômage et le poids du discours libéral, la solution
au sur-chômage européen apparaît être aujourd’hui dans l’abandon de cette dernière
conception au profit de la première. Après une période d’illusion où la salarisation était vue
comme l’accession à un statut juridiquement garanti, on reviendrait à une conception plus
orthodoxe du capitalisme d’origine où le salarié n’est rien d’autre qu’un offreur de force de
travail au gré des besoins du marché, ce que d’aucuns appelaient le prolétaire.

5
On n’insistera pas sur l’exemple américain largement décrit avec admiration ou
indignation, selon les sensibilités, fondé sur une très grande flexibilité doublée d’une non
moins grande précarité. Simplement insistera-t-on sur la profonde modification de sens du
concept de plein emploi que cela implique et l’illusion qu’elle entretient chez ceux pour qui le
plein emploi serait le retour à une situation de garantie d’emploi et de rémunération.
Si l’Europe, et la France particulièrement, résiste, du moins dans les déclarations, à cette
évolution, bien des signes laissent entrevoir une mutation souterraine. Le fort accroissement et
la persistance des emplois dits atypiques (interim, temps partiels, CDD …) laissent prévoir
que ceux-ci finissent par devenir typiques. La sollicitude particulière vis-à-vis des jeunes,
accompagnée de la mise en place d’emplois à statut distinct du code du travail habituel,
accoutume les futurs salariés à une conception déréglementée et précaire du travail. Les lois
de réduction de la durée du travail, dont l’effet sur le chômage est faible de l’aveu même de
leurs initiateurs, s’inscrivent aussi dans la flexibilisation de l’emploi, accompagnée de baisse
des charges. Hors de cette réduction de la durée visible et légale, il faut aussi noter une
réduction « sauvage », entre autres par le retardement de l’entrée dans la vie active, qui
s’inscrit dans une vision libérale de la sortie du marché d’une partie de l’offre, sans
contrepartie financière. A quoi il faut ajouter la dispense de recherche d’emploi des chômeurs
les plus âgés, ce qui les fait disparaître des chiffres du chômage.
On est donc bien devant une transformation radicale de la notion d’emploi. L’objectif
de plein emploi, dans ces conditions, n’a plus la même pertinence sociale et peut même
apparaître non seulement illusoire mais dangereux, en ce qu’il favoriserait une dégradation
des conditions de travail et d’existence d’une partie importante du salariat.
En effet, une telle évolution poserait non seulement le problème de la stabilité d’emploi
et du niveau de rémunération mais aussi du maintien d’un système de solidarité collective
fondée sur une relative stabilité de l’emploi et un niveau suffisant de la rémunération.
Conclusion
Que l’évolution technologique soit à l’origine d’une redéfinition de l’emploi (encore
que cela demanderait à être étudié plus sérieusement) implique-t-il qu’on doive abandonner
toute perspective de plein emploi ou accepter de le concevoir comme la pleine activité ?
Indépendamment des aspects purement financiers, le choix entre un taux de chômage
incompressible et une précarisation de l’emploi (voire les deux à la fois) soulève le problème,
à la fois individuel et collectif, du rôle du travail comme identification sociale de chacun et
comme instrument de lien social, donc de cohésion sociale. Il serait donc aussi dangereux, par
fatalisme déguisé en pragmatisme, d’abandonner toute idée de plein emploi que de le
concevoir sous son aspect édulcoré de pleine activité. Cependant la solution n’est pas limitée
à la seule régulation du marché du travail, mais implique une réflexion sur la notion de travail
elle-même (distinction plus floue, ou souple, entre activité et inactivité par exemple) et le
partage des richesses. Mais cette réflexion n’est même plus seulement économique, elle est
aussi politique, philosophique et éthique. Il serait dommage (dommageable) de l’occulter par
l’illusion du plein emploi pur et simple.
1
/
5
100%