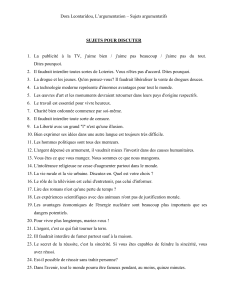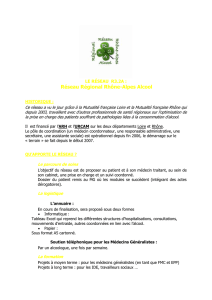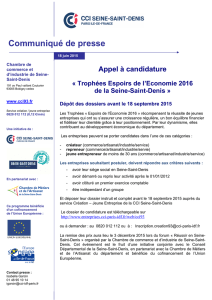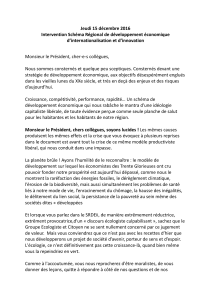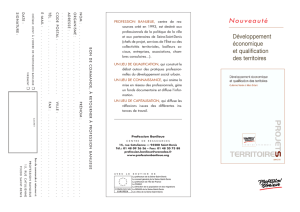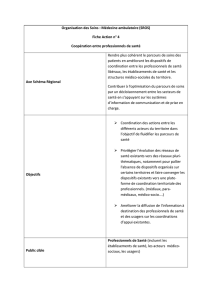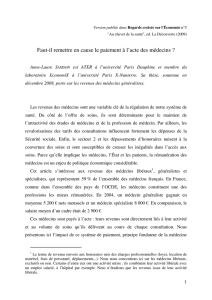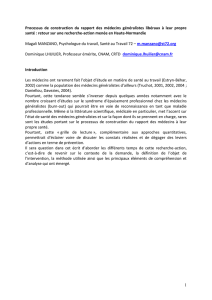Perspectives, solutions au manque de généralistes en Seine

-Perspectives, solutions au manque de généralistes en Seine-Saint-Denis
Au vu de tout ce qui a été dit, il apparaît indispensable de trouver rapidement des solutions
pour améliorer le problème de la démographie médicale en Seine-Saint-Denis.
De nombreuses propositions ont été faites par différents acteurs de la politique de santé en
France (ministère de la santé, rapport Berland (34), loi HPST, CPAM, URLM, syndicats.) Il
existe des solutions s’articulant sur plusieurs axes pour améliorer l’état de la médecine
générale.
- inciter les étudiants à s’orienter vers le DES de Médecine Générale
- faire en sorte que les internes exercent effectivement la Médecine Générale
- favoriser l’installation des médecins généralistes dans les zones déficitaires
- cas particulier de la Seine-Saint-Denis
Le préalable à toutes ces mesures est de définir précisément les besoins de santé, en termes
d’accessibilité aux soins, sur l’ensemble du territoire.
Ces besoins de santé doivent être issus d’une étude précise de l’état de santé d’une population
(en prenant en compte les contextes démographiques, socio-économiques, géographiques …)
ainsi que de l’élaboration d’objectifs de santé.
La prise de conscience relativement récente des problèmes de démographie médicale en
France a mis en évidence que les outils de pilotage de la démographie médicale ont été très
longtemps négligés. Il apparait désormais primordial d’anticiper les évolutions et les
déséquilibres futurs de la démographie médicale en mettant en place des structures
coordonnées pour
- identifier et rassembler des données permettant de nuancer les données démographiques,
(information sur le temps de travail, activité …)
- organiser un dispositif d’observation de la démographie des professions de santé au niveau
régional, autour d’un observatoire national.
-partager les produits de l’observation démographique
- mettre en place un dispositif capable d’évaluer l’influence des mesures proposées.

La création des ARS par la loi HPST de juillet 2009 (35) portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires va dans ce sens. Les ARS ont été créées afin
d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins et
d’accroître l’efficacité du système. Elles sont le pilier de la réforme du système de santé.
Elle concentre les pouvoirs dévolus à sept services de l’état et de l’assurance maladie
(DDASS, DRASS, URCAM, le service maladie de la CRAM, une partie du DRSM, MRS,
GRSP, ARH) (36)
1-Améliorer la formation initiale

Pour remédier au manque de médecins généralistes en particulier libéraux, il apparait
indispensable de prendre des mesures au niveau de l’organisation des études de médecine.
Tout d’abord, mettre en place une augmentation progressive et raisonnée du numérus
clausus, défini selon des plans pluriannuels afin d’éviter les effets « yoyo » habituels.
On pourrait également envisager de diversifier les profils de recrutement des étudiants en
médecine en orientant la première année de médecine de manière à éviter un mode de
sélection basé sur des épreuves n’ayant aucun rapport avec la médecine.
En ce qui concerne l’ENC, la répartition des postes doit être corrélée aux besoins
géographiques régionaux. Il faudrait obtenir une adéquation la plus stricte possible entre le
nombre de postes proposés et le nombre d’étudiants participant aux choix.
Il faut surtout s’appliquer dès le début du cursus médical à faire connaitre la médecine
générale aux étudiants en médecine.
Actuellement, l’ensemble de la formation médicale, que ce soit les cours théoriques ou les
stages pratiques est axé autour de la médecine hospitalière. En revalorisant la médecine
générale, en l’intégrant pleinement à la formation théorique, celle-ci provoquerait
probablement plus d’engouement.
Il faudrait dès le deuxième cycle éclairer les étudiants sur les grands champs disciplinaires et
les différents modes d’exercice, les sensibiliser à la démographie médicale, tant pour leur
donner des projets que pour leur donner les outils qui leur permettront de raisonner sur une
future installation.
Il faudrait également introduire des cours d’initiation au domaine comptable et juridique
de manière à dédramatiser le problème de l’entreprise libérale.
Ces enseignements se mettent en place en troisième cycle depuis quelques années grâce au
dynamisme des départements de médecine générale et sont un grand progrès.
Il faut surtout continuer à mettre en place le stage de médecine en deuxième cycle et ceci
pour tous les étudiants. En effet, bien que reconnu indispensable par tous les acteurs du
monde de la santé, son application est encore très restreinte, en partie en raison du manque de
moyen et de lieux de stage.

Il faudrait pour cela, de même que pour les stages de troisième cycle pour les internes,
promouvoir et revaloriser le statut de maitre de stage d’une part, et trouver de nouveaux
terrains de stage d’autre part.
Il apparait par exemple très intéressant de développer des structures ambulatoires de
formation pouvant accueillir des étudiants de deuxième et troisième cycle avec un
encadrement étroitement lié à la filière universitaire de médecine générale . Ces structures
type SUMGA(Services Universitaires de Médecine Générale Ambulatoires ) ou désormais
maisons de santé pluridisciplinaires ( MSP ) pourraient accueillir les étudiants en zones
déficitaires pour leur faire connaitre l’exercice de la médecine en zones difficiles ou rurales,
en organisant l’enseignement en fonction de leur emploi du temps ( par exemple grâce à la
visioconférence ) et en prenant en charge leurs frais de déplacement et éventuellement de
logement .
En ce qui concerne les stages d’internes, il faudrait privilégier les stages au sein des
hôpitaux périphériques ou locaux , en y mettant les moyens nécessaires pour leur permettre
d’obtenir l’agrément de terrain de stage, s’assurer que ces stages soient validant pour la
maquette de médecine générale et les rendre attractifs pour les étudiants (réouverture des
internats, logements de fonction, indemnités de déplacements) .
Il a été également proposé de développer le financement des postes d’internes
indépendamment des budgets des hôpitaux en développant le concept d’ « interne escargot »
ou « interne sac-à-dos » (budget alloué à un interne pour le financement de son cursus,
indépendamment des stages effectués).
Enfin, il est très important de poursuivre la mise en place de la Filière Universitaire de
Médecine Générale .Créée en janvier 2008, celle-ci grandit peu à peu sur le terrain. Elle est
le fruit d’une lutte permanente menée tant au niveau national qu’au niveau local. Des postes
de Professeurs Universitaires de Médecine Générale, de Maitres de Conférence de Médecine
Générale et de chefs de clinique de Médecine Générale se créent progressivement. Il est
important également de développer la recherche en médecine Générale.
Cela permettra un meilleur enseignement, une meilleure crédibilité et une meilleure
attractivité de la médecine générale.

2- Favoriser les installations
Il faut ensuite s’intéresser aux mesures pouvant favoriser l’installation des jeunes médecins en
médecine générale libérale.
Pour favoriser l’installation des médecins en zones sous médicalisées, des mesures
coercitives ont été envisagées.
Les mesures de l’avenant 20 signé en 2005 ouvraient la voie à des mesures coercitives de
déconventionnement sélectif dans certaines zones surmédicalisées.
Les réactions à cette mise en péril de la liberté d’installation ont été très fortes de la part des
médecins. Ceux ci ne croient pas à l’efficacité des mesures contraignantes à l’installation. Les
exemples dans d’autres pays tels que l’Allemagne ou le Québec montrent les effets inefficaces
de ce type de mesure.
Pour l’instant, les mesures coercitives ont été écartées au profit des mesures incitatives.
Il existe de nombreuses mesures incitatives à l’installation en zones sous-médicalisées. (37)
Des zones déficitaires ont été définies par les MRS par plusieurs critères :
- Le territoire de référence (communes, communautés de communes, bassins de vie ou
cantons) ne doit pas être inférieur à 1 500 habitants.
- La densité médicale doit être inférieure de 30% à la moyenne nationale, soit environ moins
de 0,7 médecin généraliste pour 1 000 habitants.
- L’activité médicale des médecins de la zone doit être supérieure de 30 à 50 % par rapport à
la moyenne nationale.
Ces critères peuvent être élargis, et prendre en compte :
- La part de la population de plus de 75 ans, supérieure d’au moins de 10% par rapport à la
moyenne régionale.
- Le délai d’accès au médecin généraliste supérieur à 20 minutes.
- Des fragilités territoriales spécifiques : zones de revitalisation rurale, zones urbaines
sensibles…
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%