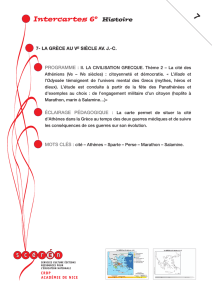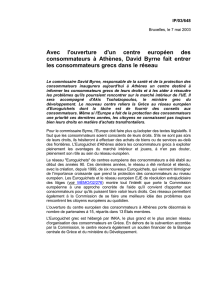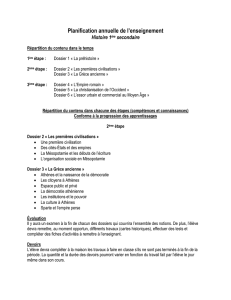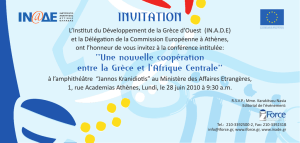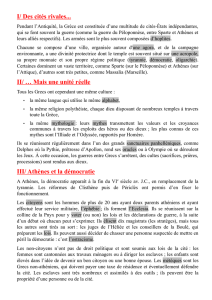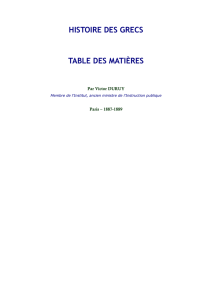HISTOIRE DES GRECS

HISTOIRE DES GRECS
Par Victor DURUY
Membre de l’Institut, ancien ministre de l’Instruction publique
Paris – 1887-1889
TOME TROISIÈME

SIXIÈME PÉRIODE — SUPRÉMATIE DE SPARTE, PUIS
DE THÈBES (404-339) – DÉCADENCE DE LA GRÈCE
Chapitre XXVIII — Depuis la prise d’Athènes jusqu’au traité
d’Antalcidas (404-387)
I. Les Dix Mille (402-403)
Ce n’est pas au moment où les doctrines sont trouvées, que leurs résultats
politiques et sociaux se produisent. Il faut des siècles aux idées pour faire leur
chemin et déraciner les croyances qu’elles combattent. La philosophie devait tuer
un jour le paganisme et modifier, en s’infiltrant dans les lois, les bases de la
société ; mais, aux temps qui nous occupent, elle n’était qu’une curiosité pour les
esprits d’élite. Dans l’histoire politique de la Grèce, la tragédie que nous venons
de raconter resta un fait isolé ; les peuples n’en furent pas détournés de leur
route, et Xénophon, qui trace leur histoire, ne croit même pas devoir mêler le
nom de Socrate aux événements qu’il raconte.
Mais tous pouvaient voir que les démagogues et les factions avaient fait perdre
aux Athéniens le magnifique empire que Périclès et la sagesse politique leur
avaient donné ; qu’Athènes n’était pas tombée seule et que la Grèce entière
s’était abaissée. Le barbare était maintenant l’ami, et le patriotisme, la première
des vertus sociales parce qu’elle contient toutes les autres, avait fait place à des
ambitions mesquines qui pousseront les Grecs à chercher de l’or dans de
lointaines aventures.
Quand une longue guerre se termine subitement, des forces militaires
considérables se trouvent sans emploi. Une foule d’hommes qui ont grandi dans
les camps et qui ne connaissent pas d’autre existence que les armes se sentent
incapables de commencer une vie nouvelle, de changer les habitudes du soldat
contre celles du citoyen. Flue l’entreprise la plus hasardeuse se présente, ils y
courront. Lorsque, après Ægos-Potamos, la paix fit rentrer les armes et les
galères dans les arsenaux, les mercenaires de Sparte et d’Athènes, les bannis,
toujours nombreux en Grèce, se trouvèrent inoccupés, et l’on vit qu’un des plus
affligeants résultats de cette lutte avait été de produire une force flottante, une
armée sans patrie, qui ne demandait que la guerre, parce qu’elle en avait besoin
pour vivre. Cette armée se donna au plus offrant, au jeune Cyrus.
Depuis que les Perses avaient réussi à mettre la Grèce en feu, ils étaient restés
simples spectateurs des événements, n’y prenant part qu’autant qu’il était besoin
pour alimenter l’incendie. Incapables de renouveler la grande lutte livrée au
commencement du siècle, ils n’avaient plus qu’une ressource, affaiblir la Grèce
en y entretenant la discorde. Les désastres de Marathon, de Salamine, de Platée,
de Mycale, de l’Eurymédon, accumulés en quelques années, et le traité honteux
qui les avait suivis, avaient porté un coup fatal au prestige divin qui entourait
jadis le monarque de l’Asie. Aux grands princes aussi avaient succédé les princes
incapables. L’Orient est terrible pour ses révolutions de palais et la prompte
décadence de ses dynasties. On avait vu Artaban, capitaine des gardes,
assassiner Xerxès (465) ; Artaxerxés Longue Main s’emparer du trône au
préjudice de son frère aîné, qu’il tua, puis s’abandonner à l’influence de sa mère

et de sa femme ; Xerxès II périr égorgé, après deux mois de règne (425), par son
frère Sogdien ; celui-ci tomber au bout de sept mois sous les coups de son autre
frère ; enfin Darius II le Bâtard, rester toute sa vie sous la tutelle de sa femme
Parysatis et de trois eunuques. Ses deux fils, Artaxerxés Mnémon et Cyrus le
Jeune, allaient continuer la tradition homicide de la cour de Suse.
Encouragées par ces désordres, les provinces s’agitaient. L’Égypte fut en révolte
continuelle dans ce siècle. Certains peuples, jamais bien soumis, secouaient tout
à fait le joug. En d’autres pays, c’étaient les satrapes qui visaient à
l’indépendance.
Tissapherne, qui administrait le sud-ouest de l’Asie Mineure, avait du moins bien
servi le monarque par son habileté à tenir la balance égale entre Sparte et
Athènes. En 407, Cyrus l’avait remplacé dans une partie de ses provinces et y
avait apporté une autre politique, parce qu’il avait d’autres desseins. A la mort
de Darius II, arrivée peu de temps après la bataille d’Ægos-Potamos (404),
Parysatis aurait voulu faire monter Cyrus au trône, par la raison qu’étant né
après l’avènement de son père, il était fils de roi, tandis qu’Artaxerxés, né
auparavant, n’était que fils de prince. Cyrus courut, à ce moment, risque de la
vie ; sauvé par l’intercession de sa mère, il fut renvoyé dans son gouvernement
et y rentra avec des projets de vengeance. Il employa prés de trois années à
amasser des trésors et une armée pour renverser son frère. Dès qu’il vit la lutte
finie en Grèce, il appela à lui tous les aventuriers, leur faisant dire : au piéton, il
sera alloué un cheval ; au cavalier, un attelage ; au propriétaire d’un champ, des
villages ; au maître de villages, des cités, et la solde sera mesurée au boisseau.
Il donna dix mille dariques à un banni de Sparte, Cléarque, pour lui acheter des
soldats en Thrace ; le Thessalien Aristippe, le Béotien Proxène, Sophénète de
Stymphale, Socrate d’Achaïe, d’autres encore, reçurent semblable commission.
Sparte même lui envoya sept cents hoplites, et mit à sa disposition une flotte de
vingt-cinq galères, qui croisait dans la mer Égée, en feignant de croire que Cyrus
ne se servirait des soldats et des navires que contre les tribus pillardes du littoral
cilicien : duplicité peu héroïque imaginée par de lourdes intelligences qui
croyaient pouvoir servir l’usurpateur sans offenser celui que l’usurpation
menaçait. Cyrus réunit ainsi treize mille Grecs, dont prés de la moitié étaient
Arcadiens et Achéens ; il avait de son côté cent mille barbares.
Il ne dévoila pas d’abord ses desseins, même à ses généraux ; il prétexta une
guerre contre Tissapherne qui lui retenait une partie de son gouvernement, puis
une expédition contre les Pisidiens qui infestaient ses frontières. Il partit de
Sardes au printemps de 401 et se dirigea vers le Sud-est à travers la Phrygie, la
Lycaonie et la Cilicie. Le satrape héréditaire de cette province, Syennésis, se
déclara en sa faveur, tout en envoyant un de ses fils auprès du roi, pour
protester de la fidélité qu’il lui gardait dans le cœur. On ne faisait que
soupçonner encore le but de Cyrus. Mais les soupçons prirent plus de consistance
quand il sortit de Tarse, où il avait fait reposer son armée vingt jours. Ces bruits
causèrent une émeute parmi les mercenaires qu’effrayait l’idée, non de
combattre le roi de Perse, niais de s’enfoncer dans les profondeurs de l’Asie.
Cléarque, assailli de pierres, fut en danger ; on l’accusait de tromper les Grecs.
Cyrus éleva leur solde à une darique et demie par mois, et annonça cette fois
qu’il allait combattre le gouverneur de Syrie. A Thapsaque, il déclara enfin qu’il
marchait sur Babylone. De nouveaux murmures furent apaisés par une nouvelle
largesse.

L’auteur de l’Anabase se complaît à marquer ainsi chaque étape par une surprise.
Il se peut que la foule s’y soit laissée prendre ; mais il se trouvait à Sardes trop
de Grecs avisés pour croire que le prince avait réuni une si formidable armée
dans le seul dessein de mettre quelques montagnards à la raison. Notre auteur
devait être de ces Grecs-là : on verra plus loin qu’il avait des motifs pour parler
comme il le fait.
Nulle part, ni dans les passes du Taurus, ni aux Portes Syriennes, Cyrus n’avait
rencontré de résistance. L’Euphrate pouvait être une barrière, surtout si une
armée campait sur son bord oriental : il ne s’y trouva pas un soldat, et les eaux
étaient si basses, que les troupes purent passer le grand fleuve à gué. De
Thapsaque, elles tournèrent à droite vers le sud, en longeant la rive gauche,
sans être gênées par d’autres obstacles que ceux du désert. En cette saison
cependant (septembre), elles durent avoir beaucoup à souffrir ; mais, au bout du
chemin, général et soldats voyaient une grande proie à saisir, et cette espérance
faisait braver un soleil tropical. Quand on fut à 15 ou 16 lieues de Babylone, dans
la plaine de Cunaxa, on aperçut pour la première fois l’ennemi1.
On allait établir le camp, lorsque l’on vit accourir, bride abattue, sur un cheval
couvert de sueur, un des confidents de Cyrus. Il crie en langue barbare et en
grec, à tous ceux qu’il rencontre, que le roi est tout proche avec une armée
innombrable2. Aussitôt Cyrus saute à bas de son char, revêt sa cuirasse, monte à
cheval, et ordonne que chacun s’arme et prenne son rang. Les Grecs se forment
à la hâte : Cléarque à l’aile droite, près de l’Euphrate, et appuyé de mille
cavaliers paphlagoniens ; au centre, Proxène et les autres généraux ; Mnémon à
l’aile gauche, avec Ariée et l’armée barbare. Cyrus se place au milieu de sa ligne,
suivi de six cents cavaliers montés sur des chevaux bardés de fer, eux-mêmes
revêtus de grandes cuirasses, de cuissards et de casques. Le prince voulut
combattre tête nue.
On était au milieu du jour, et l’ennemi ne paraissait pas encore; mais quand le
soleil commença à décliner, on aperçut une poussière semblable à un nuage
blanc, qui prit une couleur plus sombre et couvrit la plaine. Lorsqu’ils furent plus
près, on vit briller l’airain, on distingua les rangs hérissés de piques. En avant, à
une assez grande distance, étaient des chars armés de faux, dont les unes,
attachées à l’essieu, s’étendaient obliquement à droite et à gauche ; les autres,
placées sous le siège du conducteur, s’inclinaient vers la terre de manière à
couper tout ce qu’elles rencontraient. Le projet était de se précipiter sur les
bataillons grecs et de les rompre avec ces chars. Un des quatre généraux de
l’armée royale était Tissapherne, dont les avis tenant Artaxerxés au courant des
projets de son compétiteur lui avaient donné le temps de faire d’immenses
préparatifs de défense.
Il n’y avait plus que trois ou quatre stades3 entre le front des deux armées,
lorsque les Grecs entonnèrent le pæan et invoquèrent à grand cris Arès
Ényalios ; puis ils s’ébranlèrent et prirent le pas de course, en frappant les
boucliers avec les piques pour effrayer les chevaux ennemis ; ils se précipitaient
avec l’impétuosité des vagues en courroux. Avant même d’être à la portée du
trait, la cavalerie barbare tourna bride ; les Grecs la poursuivirent, mais en se
1 De Sardes à Cunaxa le colonel Chesney compte 1464 milles anglais, qui font 2350 kilomètres
(Euphrates and Tigris, p. 208).
2 Xénophon porte à 900.000 soldats le chiffre de l’armée royale ; Ctésias et Plutarque à 400.000.
Je n’ai pas besoin de dire que la plus grande partie de ce qui suit est tirée de Xénophon.
3 Le stade vaut 185 mètres.

criant les uns aux autres de ne pas rompre les rangs. Quant aux chars,
abandonnés bien vite de leurs conducteurs, les uns étaient emportés à travers
les troupes ennemies, les autres vers la ligne des Grecs, qui s’ouvrit et les laissa
passer. Il n’y eut qu’un soldat qui, frappé d’étonnement comme on le serait dans
l’hippodrome, ne se rangea pas et fut renversé par un de ces chars, sans
toutefois avoir d’autre mal. Un seul Grec aussi fut blessé d’une flèche.
Cyrus fut rempli de joie à la vue de ce succès des Grecs, et déjà ceux qui
l’entouraient l’adoraient comme leur roi. Cependant il n’y avait qu’une aile qui fût
dispersée, et l’armée royale était si nombreuse que son centre dépassait encore
l’aile gauche de Cyrus. Aussi le prince garda sa position et tint serrés autour de
lui ses sis cents chevaux, en observant tous les mouvements du roi. Artaxerxés,
qui s’était placé au centre avec six mille cavaliers, fit un mouvement pour
entourer les Grecs. Cyrus, craignant qu’il ne les prit à dos et ne les taillât en
pièces, courut à lui avec ses cavaliers, replia tout ce qui était devant le roi, et
tua, dit-on, de sa main, leur général. Mais ses cavaliers se dispersèrent à la
poursuite des fuyards, et il n’y avait plus que peu de monde auprès de lui,
lorsqu’il reconnut le roi : Je vois l’homme, s’écria-t-il. Il se précipita sur lui, le
frappa à la poitrine, et le blessa à travers sa cuirasse. Au même instant il fut
atteint lui-même au-dessous de l’œil, d’un javelot lancé avec force par un soldat
inconnu. Il tomba mort, et sur son corps périrent huit de ses principaux amis.
Ainsi finit Cyrus. Tous ceux qui l’ont intimement connu s’accordent à dire que
c’est le Perse, depuis l’ancien Cyrus, qui s’est montré le plus digne de l’empire, et
qu’il possédait toutes les vertus d’un grand roi... (septembre 401).
Sa mort changea l’issue de la bataille. Ses troupes, sans chef et sans raison de
combattre davantage, se dispersèrent, et le roi pénétra dans leur camp, où le
harem du vaincu tomba en ses mains. Il s’y trouvait deux Grecques que leurs
parents avaient offertes au prince lorsqu’il résidait à Sardes : usage habituel à
ces populations asiatiques, qui trafiquaient de tout, même de la beauté de leurs
filles, dotées par eux, dans cette intention, d’une éducation brillante. Une d’elles,
originaire de Milet, s’échappa ; la belle Milto de Phocée, moins ou plus heureuse,
devint une des femmes du grand roi et, comme la Monime de Mithridate, mais
sans avoir sa fin tragique, régna sur son maître.
Pendant que Cyrus mourait, les Grecs victorieux continuaient leur marche en
avant. Lorsqu’ils apprirent que l’ennemi pillait leurs bagages, ils revinrent sur
leurs pas. D’abord les Perses allèrent hardiment à leur rencontre ; mais en les
voyant se mettre en ligne, entonner le pæan et charger avec fureur, ils
s’enfuirent plus vite encore que la première fois. Au coucher du soleil, les Grecs
revinrent à leurs tentes, surpris de n’avoir pas de nouvelles de Cyrus et
n’imaginant pas qu’il eût péri. Ils ne le surent que le lendemain matin, et
apprirent en même temps qu’Ariée, avec les auxiliaires barbares, avaient fui à
une journée de marche en arrière ; de sorte que cette petite troupe de Grecs, qui
avait à peine perdu un ou deux soldats, demeurait maîtresse du champ de
bataille entre deux armées, l’une alliée, l’autre ennemie, fuyant en sens
contraires ! Alors commença cette retraite fameuse, à travers des pays pour la
plupart inconnus des Perses eux-mêmes et malgré les déserts, les montagnes,
les fleuves, les neiges, la disette et les peuplades sauvages. Elle fut appelée la
retraite des Dix Mille, parce que tel était à peu près le nombre des soldats.
D’abord les Grecs se rapprochèrent d’Ariée, et les deux armées se jurèrent une
alliance inviolable. Le roi les fit sommer de déposer leurs armes ; comme ils
répondirent fièrement que ce n’était pas aux vainqueurs à désarmer, il changea
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
1
/
292
100%