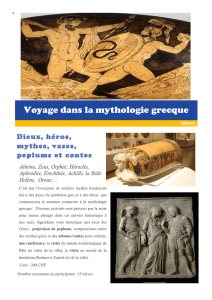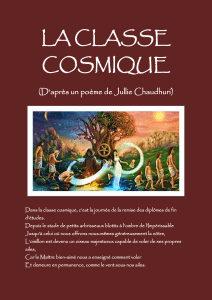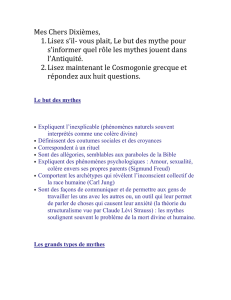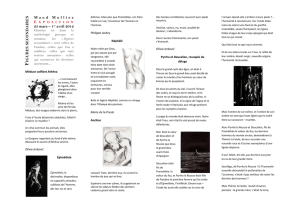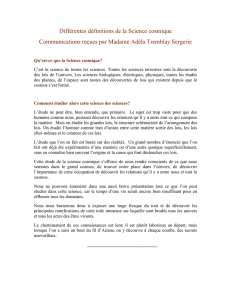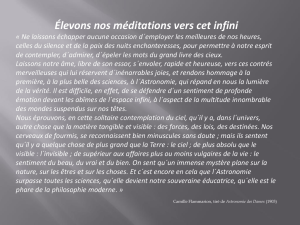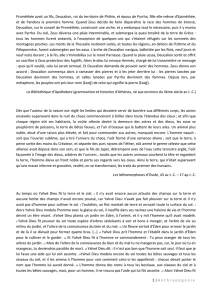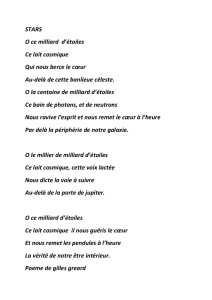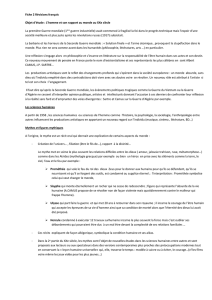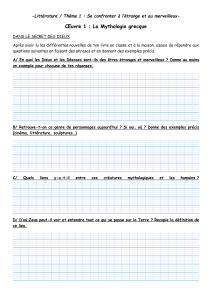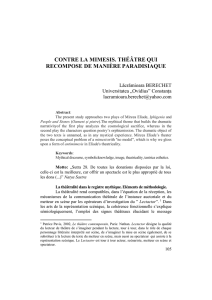Le blasphème et la fin du monde

ISABELLE BIANQUIS-GASSER
Le blasphème
et la fin du monde
Ce texte n' a
d'autre ambition
que de rappeler quelques
motifs inscrits
dans la mythologie indo -
européenne nous décrivant
les aventures dramatiques
qui se sont succédées au
cours de la phase
de création de l'Homme sur
la terre. Et à partir
de ces motifs de reprendre
en partie les analyses
de Jean Haudry.
I
l est des blasphèmes qui tuent ceux qui
les profèrent, en particulier l'outrage
par la révolte ou la désobéissance aux
dieux. C'est ainsi que le premier blasphème
de l'humanité a causé tout simplement sa
perte. En effet la plupart des mythes indo-
européens racontant l'apparition de l'homme
dans la création du monde, nous apprennent
que l'homme a vécu deux naissances
successives.
L'âge d'or
La première est une naissance divine. La
vie de l'homme est alors caractérisée par le
Maxime Loiseau Séries TV Pictures.
F- ? ïî!*!j!..'- -
bonheur et l'harmonie. Dans les métamor-
phoses Ovide décrit ce temps heureux au
printemps éternel. (Métamorphoses, 1, v. 76
et suiv.)
«L'âge d'or fut semé, le premier qui sans
répression, sans lois, pratiquait de lui-même
la bonne foi et la vertu.... point de casques,
point d'épées; sans avoir besoin de soldats,
les nations passaient au sein de la paix une vie
de doux loisirs. La terre aussi, libre de rede-
vances, sans être violée par le hoyau, ni bles-
sée par la charrue, donnait tout d'elle même
... Le printemps était éternel et les paisibles
zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines
les fleurs nées sans semence. »(1>.
Isabelle Bianquis-Gasser
Institut d'Ethnologie- Laboratoire de
Sociologie de la Culture Européenne
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 1994
57

La chute
Mais le scénario est invariablement le
même... Les hommes n'ont pas su jouir cor-
rectement de ces bienfaits et ce thème de
l'âge d'or décrit par nombre de poètes
depuis Hésiode se termine toujours par la
faute des hommes.
Ovide fait succéder l'âge d'argent à
l'âge d'or. Dans ce temps sont apparues les
quatre saisons, obligeant les hommes à
souffrir des chaleurs torrides et du froid gla-
cial, et à entrer pour la première fois dans
des maisons.
Puis vint l'âge du bronze pire encore
durant lequel commencèrent les combats.
Enfin l'âge du fer quand l'homme «ne se
contenta plus de demander à la terre fécon-
de les moissons et les aliments qu'elle lui
devait, mais il pénétra jusque dans ses
entrailles ; On vit de rapines ; l'hôte ne se fie
plus à l'hôte, ni le beau-père au gendre,
même entre frères, la concorde devient rare ;
l'époux médite la perte de l'épouse; l'épou-
se, celle de l'époux;... La piété est vaincue,
foulée aux pieds ; loin de cette terre trempée
de sang se retire, la dernière, après tous les
immortels, la vierge Astrée».(1)
Alors les dieux se fâchent, annulent cet
âge d'or et provoquent généralement par le
déluge un anéantissement général, épar-
gnant en fin de compte un homme ou un
couple qui sera à l'origine de la seconde
naissance des hommes.
Une très belle illustration de la fin de
cette première époque et du début de la
seconde nous est livrée par le mythe de
Pyrrha et Deucalion.
Le déluge a recouvert la terre de mer.
Une seule montagne a été épargnée et garde
sa cime élevée jusqu'au ciel, il s'agit du
Parnasse.
C'est au pied du Mont Parnasse que va
accoster le seul couple survivant de cette
catastrophe. Survivant car vertueux et sou-
cieux de justice. Il s'agit de Deucalion et de
sa compagne Pyrrha.
Mais voyant le vide et le silence qui
régnent autour d'eux, Deucalion et Pyrrha
fondent en larmes. Ils cherchent alors à
implorer la divinité se tournant dans la direc-
tion du sanctuaire de la déesse Thémis.
La déesse est touchée par leur prière
dans laquelle ils demandent comment ils
pourront réparer la perte de leur race, et rend
l'oracle suivant : «Eloignez vous du temple,
voilez vous la tête, détachez la ceinture de
vos vêtement et jetez derrière votre dos les
os de votre grand mère».
Deucalion trouve le premier le sens de
l'oracle, comprenant que la terre symbolise
la grand mère, les pierres symbolisent les os
de la terre. Le couple décide de suivre cette
interprétation : «Ils s'éloignent, se voilent la
tête, dénouent leur tunique et comme ils en
ont reçu l'ordre lancent des pierres derrière
leurs pas. Ces pierres perdent leur dureté et
leur apparence rigide, elles s'amollissent
peu à peu et en s'amollissant, prennent une
nouvelle forme. Puis elles s'allongent, leur
nature s'adoucit et on peut reconnaître
jusqu'à un certain point, quoique vague
encore la figure humaine telle qu'elle com-
mence à sortir du marbre, à peine ébauchée
et toute pareille aux statues imparfaites. La
partie de ces pierres où quelques sucs
liquides se mêlent à la terre devient de la
chair, ce qui est solide et ne peut fléchir se
change en os, ce qui était veine de la pierre
subsiste sous le même nom. Dans un bref
espace de temps comme l'avaient voulu les
dieux, les pierres lancées par les mains mas-
culines devinrent des hommes, et le sexe
féminin dut une nouvelle vie à celles qu'une
femme avait jetées. Voilà pourquoi nous
sommes une race dure, à l'épreuve de la
fatigue».
Ce thème rapporté ainsi par Ovide se
retrouve sous des formes différentes de
façon plus générale dans tout le monde
indo-européen. Que ce soit la forme du
poème d'Athranasis, le plus complet des
poèmes sumériens qui raconte comment les
hommes à un moment se rendent insuppor-
tables aux dieux. Surgit alors un héros, le
plus sage, qui sauvera l'humanité en parti-
culier du déluge. Ou encore sous la forme
de la légende d'Ymir dans la mythologie
Scandinave. Là il est question de l'âge d'or
durant lequel le divertissement par excel-
lence est le jeu de hasard. Mais ce temps ne
peut durer, intervient alors un événement
dramatique, en relation directe avec un par-
jure. Toute une série de récits différents
annoncent ce moment de rupture, suivi d'un
cataclysme, disparition de la terre sous la
mer, ou encore embrasement universel:
l'apocalypse.
Jean Haudry a ramené à quatre les catas-
trophes du monde :
- un hiver auquel, seuls, un héros et les
siens survit,
- l'obscurité qui se manifeste par la dispa-
rition des astres (soleil, lune, étoiles),
- l'inondation ou déluge,
- l'incendie universel.
Passé ce cataclysme, un ordre nouveau
est rétabli; mais ce n'est plus le même.
L'action répressive des dieux va obliger les
hommes à travailler, à peiner.
Ce temps de Zeus, celui que nous vivons
est le pendant du temps de Cronos premier
temps idyllique dont nous parle Platon.
Le monde sort d'un paradis perdu, il ne
le retrouvera plus pour certains mythes,
pour d'autres un jour viendra où les hom-
mes connaîtront à nouveau un âge d'or.
Deux doctrines sont à la base de ces
cycles cosmiques. Il existe une orientation
traditionnelle dans les cultures primitives
pour laquelle le temps cyclique se régénère
périodiquement à l'infini et une orientation
moderne pour laquelle le temps fini est frag-
ment entre deux infinis atemporels. Dans le
premier cas l'âge d'or est répétable une infi-
nité de fois, dans le second cas il n'y a eu
qu'un âge d'or.
Chez les Iraniens, les Juifs ou les chré-
tiens l'histoire n'est pas répétable, elle est
limitée. Dans cette conception linéaire du
temps, il y a une fin unique suivie d'une
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 1994
58

création nouvelle. Par exemple dans la reli-
gion chrétienne, la prophétie de la Rédemp-
tion est quelque chose de tout à fait diffé-
rent du temps des origines. Il y aura un salut
de l'humanité mais l'homme doit s'y pré-
parer afin de faire partie des saints de ce
dernier temps. Dans ce cas le comportement
actuel de l'homme est décisif pour son salut
futur.
Finalement la question est la suivante :
pourquoi les hommes pourtant nantis par les
dieux aux origines n'ont pas été capables de
préserver leur vie au Paradis.
Les travaux de Mircéa Eliade et de Jean
Haudry permettent de mieux cerner les dif-
férents niveaux d'interprétation de ces
mythes.
Le mythe a une fonction précise, celle
d'expliquer la création du monde et de four-
nir des éléments de réponse et de compré-
hension de la condition des hommes.
L'homme sur la terre vit dans une situa-
tion tout à fait précaire et toute sa vie il
oscille entre l'ordre et le désordre. Du-
alisme fondamental car à tout instant l'équi-
libre peut être rompu, le désordre majeur
trouvant son expression dans le cataclysme
cosmique.
Les mythes de création puis d'anéantis-
sement du monde rendent compte de l'exis-
tence du mal c'est-à-dire de l'imperfection
de la création.
Un Dieu fatigué
Mircéa Eliade trouve dans des mythes
populaires d'Europe Sud orientale, l'image
d'un dieu fatigué après la création et qui va
laisser s'achever l'oeuvre par un auxiliaire,
le diable par exemple, pendant que lui se
retire au ciel.
Dans le folklore roumain ce dieu lointain
joue un rôle capital «l'éloignement de Dieu
trouve sa justification immédiate dans la
dépravation de l'humanité. Dieu se retire au
ciel car les humains ont choisi le mal et le
péché. »<3)
La fatigue de Dieu présente dans le chris-
tianisme populaire a fourni une réponse à
l'apparition du mal, désolidarisant le créateur
de toutes les imperfections du monde des
hommes. «Un des aspects de Dieu, mis en
évidence surtout dans les légendes balka-
niques, était son caractère de deus otiosus, qui
expliquait les contradictions et les souf-
frances de la vie humaine.«l3)
Le thème de la création achevé par un
autre que le Créateur a été longuement
détaillé par Eliade en particulier dans 1' ana-
lyse des mythes qu'il a rassemblé sous le
thème du plongeon cosmogonique. Dans la
mythologie populaire de l'Europe Sud
Orientale, le Créateur envoie presque tou-
jours une tierce personne plonger au fond
de la mer pour aller chercher de la terre afin
de façonner le monde. Pourtant dit Eliade
«très probablement la forme originelle du
mythe présentait le créateur plongeant lui
même au fond des eaux, sous la forme d'un
animal pour en ramener la matière néces-
saire à la création de la terre». Sous-enten-
dant que la pensée archaïque a développé
une croyance sur la bi-unité divine c'est-à-
dire une divinité qui incluerait le bon et le
mauvais.
La fin du monde et la nuit
Mais à côté d'une origine mythique, ce
dualisme dont il est question, et qui est à la
source de la chute de l'homme trouve bien
entendu son expression dans l'organisation
de la nature et de la solidarité manifeste
entre rythme cosmique et vie humaine. Les
polarités que l'on peut observer dans le cos-
mos et la vie (opposition entre le jour et la
nuit, entre l'hiver et l'été, entre l'homme et
la femme, la naissance et la mort) ont pro-
bablement servies de modèles à l'élabora-
tion des mythes.
Si l'on reprend par exemple le thème de
Deucalion et de Pyrrha, J. Haudry a démon-
tré de quelle manière ces deux personnages
dans le monde indo-européen, incarnaient par
leur nom et leur fonction (Deucalion = Le
Blanc et Pyrrha = La Rouge) les deux cou-
leurs de base qui sont les deux cieux : le blanc
(ciel diurne équivalent du jour cosmique) et
le rouge (ciel crépusculaire, équivalent à
l'aurore et au crépuscule cosmiques), dont
l'union a engendré le monde. La troisième
couleur, le noir représentant la nuit cosmique.
Jean Haudry à la lumière des cosmolo-
gies védiques et des cosmologies des grecs
et des germains, a remarqué l'existence de
trois mondes ou encore la notion de monde
médian mais dans ces systèmes, il n'est pas
question des trois couleurs. Aussi a-t-il sup-
posé une cosmologie plus ancienne encore
selon laquelle la terre serait située au centre
du monde, entourée de trois cieux, un ciel
noir qui serait le ciel nocturne, un ciel blanc,
le ciel diurne et un ciel rouge représentant
le crépuscule (coupure entre le noir et le
blanc que l'on retrouve par exemple dans
l'épisode de Cronos dans la mythologie
grecque).
Dans la Théogonie d'Hésiode ou le
mythe de l'âge d'or tel que nous l'avons vu
décrit par Ovide, l'aurore cosmique repré-
sente l'âge d'or, le jour cosmique l'âge
d'argent, la nouvelle nuit cosmique, l'âge
de fer, celui que nous vivons.
Il existe une homologie entre le jour et
l'année. Dans la conception indo-européen-
ne du monde chacun de ces cycles est orga-
nisé selon un processus identique.
«C'est sûrement en raison de cette
homologie, qui est une donnée première
qu'à son tour le cycle cosmique a été conçu
lui aussi sur ce modèle, comme la succes-
sion d'une nuit (le chaos), d'une aurore
(l'âge d'or), d'un jour, et d'un crépuscule
qui a son terme (l'âge sombre) aboutit à une
nouvelle nuit. Secondairement ce cycle cos-
mique a été mis en parallèle avec la struc-
ture de la société, qui elle même reflète le
modèle des trois couleurs cosmiques. »(4)
On comprend alors mieux les récits de
déluge par exemple qui se situe à la char-
nière de deux temps. En effet il y a des
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 1994
59

épreuves (par l'eau ou par le feu) qui per-
mettent à des héros de traverser la mort et
d'atteindre une vie nouvelle. Mais en raison
de l'homologie existant entre le cycle cos-
mique et le cycle annuel, atteindre une vie
nouvelle est à mettre en parallèle avec le fait
d'entrer dans la belle saison. Les épreuves
du déluge ou du feu permettent à l'homme
de rejoindre la lumière de la belle saison,
symbole elle même de l'immortalité.
La fin de l'âge d'or ne peut trouver son
origine que dans la colère des dieux et cette
colère ne peut être provoquée que par le
blasphème ; le mythe éclaire alors sous une
forme narrative un événement qui ne peut
trouver autrement de justification, la nuit
succède immanquablement au jour...
Le mal et la mort ne peuvent pas être nés
avec le monde, ils sont là par accident. Et
c'est une transgression qui engendre le mo-
ment fatal de la rupture avec le monde divin.
Mais le drame n'est pas définitif, la
cause n'est pas perdue à jamais. Et les
hommes face à la définition du temps se
situent dans une perspective optimiste. La
conception cyclique indique qu'après la
destruction se fera une reconstruction à
l'image du premier âge d'or. Ici l'eschato-
logie emprunte aux mythes de création ses
modèles. Le temps à venir sera le même que
le temps premier.
Par contre dans la conception historique,
du drame cosmique surgira le Royaume de
Dieu.
«Puis je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle ; car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la mer n'était plus ».
(Apocalypse v. 21.1)
Ainsi, partout l'homme, pour supporter
l'histoire ressent un besoin profond de
domestication de l'avenir. Dans le passé,
les hommes des sociétés traditionnelles ont
accepté le malheur parce que les événe-
ments historiques étaient considérés
comme l'expression d'une succession
d'archétypes. Au cours de l'histoire, des
mouvements ont suscité la résurgence de
projets de société ou de projets «folklo-
riques» s'inscrivant dans un retour à l'âge
d'or. Aujourd'hui dans nos sociétés occi-
dentales, devant la disparition de réfé-
rences à ces archétypes, face à l'atténua-
tion du sentiment religieux, la futurologie
semble avoir pris le relais.
Bibliographie
Eliade (Mircéa), «De Zalmoxis à
Gengis-Khan» Paris, Payot,» 1970,252
pages.
Haudry ( Jean), «La religion cosmique
des Indo-Européens» Paris, Arche, Les
Belles Lettres, 1987, 329 pages.
Ovide, «Les métamorphoses», Paris,
Gallimard, Folio, 1992, 620 pages.
Léger (Louis), «La mythologie Slave,»
Paris, Ernest Leroux,1901, 248 pages.
Ravignant (R), Kielce(A), «Cosmo-
gonies - Les grands mythes de création
du monde», Le Mail, 1988,160 pages.
Notes
1.
Astrée : déesse de la Justice
2. Eliade ( M): De Zalmoxis à Gengis-Khan
page 93
3. Eliade (M): De Zalmoxis à Gengis-Khan
page 129
4. Haudry (Jean), La religion cosmique des Indo-
Européens, page 285
Revue des Sciences Sociales de la France de l'Est, 1994
60
1
/
4
100%