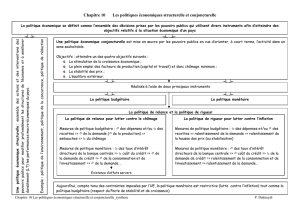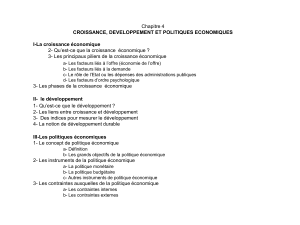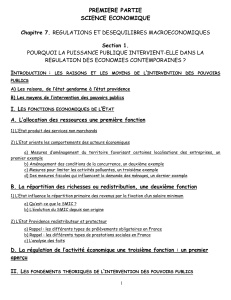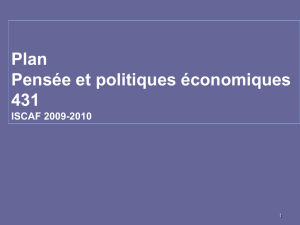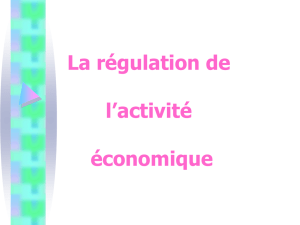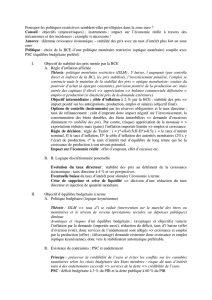section ii : vers une nouvelle conception de la poilitique budgetaire

POLITIQUE BUDGETAIRE
(Dissertations sur la politique budgétaire)
Champs théorique
Champs empiriques / pratiques
SECTION I : UN OUTIL DE POLITIQUE ECONOMIQUE CONTESTE
I définitions et concepts de base
déficits budgétaire
Situation où les dépenses du budget de l’état sont supérieures au recettes de l’état.
2000 : loi de Finance :
D = 1692 MMF
R = 1473,7 MMF
Solde = déficit de l’etat = -215,3 MMF
Pour les Keynésiens = moyens de relance de l’économie
déficit public
Notion plus large car au solde des dépenses et recettes de l’état, on va rajouter le solde des
dépenses et recettes des collectivités locales et des organismes de sécurité sociales.
Les organismes de sécu sociales et collec pub dégagent des excédents faibles.
Maastricht : critères= déficit public
dette publique
ensemble des emprunts effectués par l’état.
Titre émis par l’état (long terme = obligation ; cours moyen terme= bons du trésor)
Déficit budgétaire = recettes courantes – dépenses courantes – charges d’intérêts < 0
Solde primaire = recettes courantes – dépenses courantes
Charge d’intérêt = taux d’intérêt x stock de la dette publique
La France l’année dernière a dégagé un excédent de solde primaire en 2000.
Le projet de loi de Finance
Est déposé au parlement mais non encore adopté
La loi de finance initiale
Adoptée par le parlement à l’automne et donne le déficit prévu
Loi de Finance rectificative
En cours d’exercice, lors de changement de gouvernement par ex, changement de politique
adoptée par le parlement.
loi d’exécution

donne le déficit réalisé
loi de règlement
déficit primaire réalisé
La France supporte lourdement les dettes passées.
II – Quelques chiffres
Voir dossier tableaux p.20,21 & 22
95
96
97
98
99
00
01
Déficit public
-5
-4,1
-3
-2,9
-1,8
-1,5
-1,1/-1,3
Dette publique
(Maastricht=60)
RATIO :
Dette/PIB
52,7
57,1
59,2
59,3
58,6
58
57,4/57,5
RATIO : Dette/PIB : Si l’augmentation des taux d’intérêts réel est supérieur à l’augmentation
de la croissance économique
Les déficits publics
La réduction des déficits publics se poursuit (156,8 milliards de F en 99) car les recettes
augmentent plus rapidement que les dépenses.
Comment ?
Recettes : augmentation de la CSG, TVA (95), ISF, IS
Dépenses :maintenu dépenses en Francs constants (hauuse des dépense au m^le rythme que
l’inflation).
- le déficit publique
le redressement budgétaire s’est accentué depuis le milieu des 90’s,
- les administrations publiques sont excédentaires en 99
- compte des administrations de sécurité sociale sont également excédentaires
III – LE MUMTIPLICATEUR BUDGETAIRE ET LES POLITIQUES DE RELANCE
PAR LA DEMANDE
L’efficacité des politiques budgétaires repose sur un argument théorique : le multiplicateur.
1. Le principe du multiplicateur Keynésiens
- Les dépenses de l’Etat
i. Achats de B&S aux entreprises : Dépenses Publiques
ii. Dépense de transfert (aide + services aux entreprises, transferts
sociaux et ménages)
iii. Dépenses de fonctionnement
iv. Dépenses liées à la charge d’intérêt
Dépenses Publiques = Levier important pour agir sur la croissance économique & sur
l’emploi (risque d’effets pervers sur l’inflation et équilibre commerce extérieur)
= instrument de régulation conjoncturelle

- le multiplicateur budgétaire
A tout moment on a :
Y + M = C + I + G + X
Y = prod
M = importation
C= Conso des ménages
I = investissement
G =dépenses pub
X = exportation
sous l’hypothese de sous emploi des facteurs de production
utes choses étant égales par ailleurs,
k = 1 / m + s
s = tendance à épargner
Si K>1 = multiplicateur budgétaire
L’augmentation des dépenses de l’Etat entraîne une augmentation grâce au multiplicateur plus
que proportionnel de la production.
Aug des dep. pub aug Invest aug pvoir achat aug conso aug prod
Risque de fuite pourtant si les ménages épargne ou consomment à l’étranger
- le multiplicateur fiscal et des dépenses de transfert
2. Le financement du déficit
Par la fiscalité (th d’Haavelmo)
o Impôt ponctuel (sécheresse…),
o Accroissement de la fiscalité dans son ensemble
affaiblie très sensiblement l’effet multiplicateur des
dépenses publiques (th d’Haavelmo)
Par emprunts (obligations) effet d’éviction
o L’état fait appel à une épargne existante dans l’économie
Financement non inflationniste
o Effet d’éviction = augmentation des titres publiques pour
attirer l’épargne l’état va augmenter les taux d’intérêts par
rapport à des titres privé comparable en terme de risque etc…
Donc si augmentations des taux baisse de la valeur des
obligations, et donc de l’investissement privé effet négatif
sur la sphère privé
o Part état dans émission obligataire = +90% !

Les entreprises ne subissent pas l’effet d’éviction car :
1. capacité d’autofinancement >120%
2. accès à des financements divers et variés nationaux et internationaux
3. inélasticité de l’investissement au taux d’intérêt
Par la création monétaire (plus possible…)
Emission de bonds du trésor financé par la création monétaire du système bancaire. C’était le
trésor qui répondait à des avances de la Banque de France.
PROBLEME : Financement inflationniste qui venait rapidement annuler les effets positifs
depuis le 1er janvier 1994, ce mode de financement est interdit (art 104 du traité de
Maastricht)
3. les limites
o Les contestations théoriques
o Le théorème d’équivalence ricardienne
Il est équivalent de financer le déficit budgétaire par l’emprunt ou par
l’impôt
A été repris par Barrot et les nouveaux classiques dans le cadre des
anticipations rationnelles : Une politique de relance par la politique
budgétaire ne produit aucun effet, elle est neutre car les agents
économiques anticipent une augmentation des impôts et donc vont
utiliser les revenus supplémentaires pour accroître l’épargne et non pas
pour accroître la consommation ou l’investissement comme le prévoit
la théorie keynésienne
o L’approche classique de la politique budgétaire
Approche en opposition totale avec la théorie keynésienne et avec les
politiques budgétaires menées après la 2de guerre mondiale
Une baisse du déficit budgétaire qui va entraîner une augmentation de
la croissance économique
1. Plan théorique :
o Effet taux d’intérêt
Une baisse des déficits publics = baisses des taux
d’intérêts (effet d’éviction inversé) = baisse du coût
du crédit = effet de richesse donc augmentation
de C & I
o Effet anticipations
La baisse des déficits publics va entraîner une baisse
des révisions des agents = il anticipe une diminution
des impôts donc entraîne une augmentation de C
&I (modèle ricardien de crédibilité budgétaire)
2. Plan empirique
o 3 pays ont utilisés :
Danemark : 82-86
Irlande : 87-89
Suède : 85-87
o Politique contraignante pour la population mais qui a
permis de na pas pénaliser la croissance
Théorie controversé car une action individuelle d’un petit pays ne pas
avoir du tout le même impact mené à une plus grande échelle

o Les limites intrinsèques
o Effet boule de neige ( plus le déficit augmente, plus la dette augmente, plus la
charge de la dette augmente accroissement le déficit augmente etc…)
4. Les vérifications empiriques
New deal ( Roosvelt 30’s)
Tax cut (Kennedy 60’s)
Plan Chirac (75)
Relance Mauroy (81-82)
Japon (90’s :plans de relance)
Europe (Delors : relance européenne concertée en 93)
CONCLUSION :
Le budget de l’Etat, à de tout temps, constitué un instrument d’influence économique.
Il a permis un réglage fin de l’économie pendant les trente glorieuses.
Il a fait de vives contestations théoriques dans les années 60 en opposant les monétaristes et
les keynésiens (politique budgétaire Vs politique monétaire.
Dans les années 90 de vives contestations au sujet de l’utilisation du budget de l’Etat afin de
relancer l’activité au vu des conséquences sociales
SECTION II : VERS UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA POILITIQUE
BUDGETAIRE ?
Les contraintes actuelles voies du renouveau de la politique
I – LES POLITIQUES BUD AUJ : UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA POL BUD
- La crise des finances publiques limite la marge de manœuvre
- Politique sous contrainte ; assainissement
1 . L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES
Réduction des déficits
o « Effets boules de neige »
Stabilisé la dette publique
o Ratio Dette publique / PIB
2 sources d’augmentations
existence d’un déficit primaire
comparaison entre le taux d’intérêt moyen sur la dette et le taux
de croissance de l’économie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%