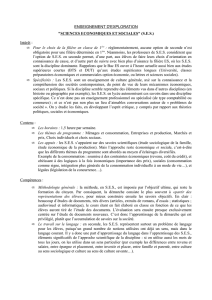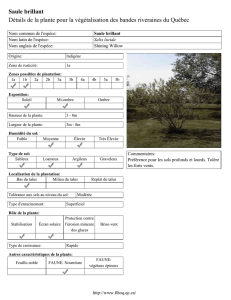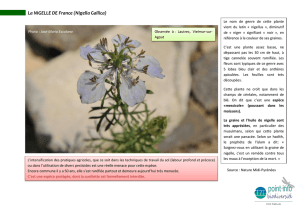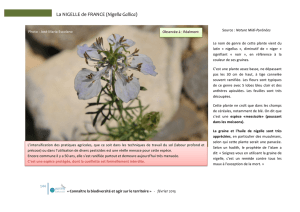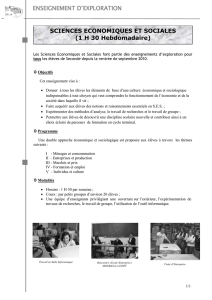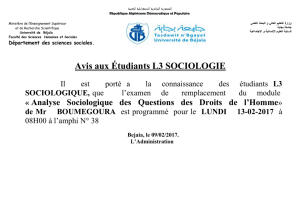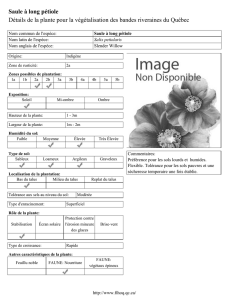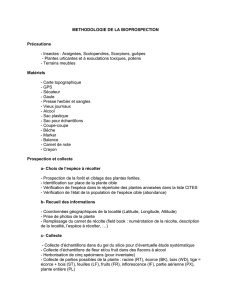INVENTAIRE TAXONOMIQUE VEGETAL DANS QUELQUES

Annales FLSH N° 17 Spécial JUOR (2013)
1
INVENTAIRE TAXONOMIQUE VEGETAL DANS QUELQUES
LANGUES CONGOLAISES (RDC) : CAS DES BOA, BODO,
OLOMBO, ZANDE ET BINZA-SUD
Par
René BOSISE Bongoli et
LOFEMBA Boningoli B.
1
The present article is a vegetal and taxonomic inventory in
some Congolese languages (DR Congo) above cited. The problem
discussed in this study is not similar to that of ecological analepn or
botanical one, but it deals essentially with the cosmic vision which
all those peoples represent to their vegetal world. It is shown that
each African community has got is own environmental or vegetal
conception.
Here, we examine the different usefer, practices performed by
those peoples, namely: social usages, therapeutic usages(medical
usage), mystic usages (fetishes)
The scientific part of this study treats the taxonomic field,
onomastic or even ethnolinguistic nince it discusses the names of
plants in their natural area.
Set us note that the different parts of plants (leaves ,flowers
,fruits ,) express different or multiple phenomena(flood, dry season,
harvest hunting) that we guess thank to thore plants.
INTRODUCTION
Certes, lorsqu’on aborde les domaines de la linguistique, l’on ne
peut se prétendre les appréhender globalement, car la linguistique se
trouve à la croisée de plusieurs disciplines et la langue se trouve au
carrefour de toutes les préoccupations de la vie des hommes en
société. En effet, une vérité inéluctable atteste que de nos jours, toutes
les cogitations scientifiques se penchent essentiellement sur la
problématique environnementale. Cette étude en est une preuve étant
donné qu’elle ne se borne pas seulement à la taxonomie végétale dans
quelques langues Congolaises mais tente d’en dégager le sens, l’utilité
mais aussi la conservation de la nature ou de ces espèces végétales.
Pour ce faire, BOSISE Bongoli affirme sans trop de tergiversation que
la langue est un fait culturel. Elle est même la résultante de la culture
d’un peuple. Les langues congolaises constituent le reflet des cultures
et s’identifient aussi à l’environnement Congolais où elles sont
parlées.
1
Professeur Associé et Assistant de 2ème Mandat à l’Université de Kisangani

Annales FLSH N° 17 Spécial JUOR (2013)
2
La présente étude traite de la taxonomie que nous appréhendons
comme étant une classification d’éléments, de suite d’éléments et des
classes destinées à former des listes qui rendent compte, par leurs
règles de combinaisons, des phrases d’une langue. C’est en fait la
nomenclature ordonnée, généralement formée des noms, des noms
composés, etc. (Bosise Bongoli, 2010, p. 28.)
Les communautés dont il est question ici ont leur vision
cosmologique végétale. Il s’agit de Bớa, Bodo, Olombo, Bínza et
Zándé. En effet, les taxonomies populaires participent fort à
l’appréhension de la vision du monde telle que représentée par chaque
communauté linguistique donnée ; ce qui nous permettra de pénétrer
ou de découvrir comment les cinq communautés en étude parviennent
à désigner tel ou tel autre phénomène social. Il ne s’agit pas ici d’une
analyse comparative des noms des plantes dans les cinq langues sous
étude, mais d’un inventaire taxonomique sur un domaine précis de la
linguistique. C’est pourquoi nous prélevons les noms des plantes en
donnant leurs sens et utilité selon les différents milieux d’usage, et
cela, d’après la vision du monde environnemental de ces peuples.
I. Aperçu environnemental de l’étude
La problématique soulevée dans la présente étude bien qu’étant
dendronymico-taxonomique d’une part ; elle est aussi
environnementale qu’écologique d’autre part.
En effet, sa portée scientifique ne consiste pas simplement à
répertorier, recenser ou classifier les plantes mais elle tente aussi de
montrer la vision que tous les peuples sous étude font du monde
végétal, c’est-à-dire elle essaye de scruter la sphère végétale des
différents milieux tout en montrant la perception cosmologique de ces
derniers. Leurs usages par le biais de ses feuilles, plantes, planches,
sèves, graines, racines, écorces, bois qui, au-delà du fait qu’ils sont
essentiellement d’ordre médicinal, ils sont aussi économiques. Il suffit
de fréquenter les différents ports de l’ex ONATRA (Office National
de Transport) pour se rendre compte de quantité de bois pour la
commercialisation.
Elle ne se penche pas non plus à nommer simplement les plantes ;
elle est écologique dans la mesure où elle aborde les conditions de
vie, de l’existence des différents peuples étudiés dans leurs différents
rapports avec l’environnement plus particulièrement sa « protection ».
Abordant le volet économique de l’étude ; il y a lieu de signifier qu’en
R.D.Congo plus de 90% de la population urbaine consomme du bois
pour l’énergie. Cependant, sa production et sa commercialisation

Annales FLSH N° 17 Spécial JUOR (2013)
3
assurent un revenu à un grand nombre de personnes tant en milieu
rural qu’urbain bien que le bois énergie constitue la principale cause
de « déforestation » et de la « dégradation » de nos forêts.
Le présent article sur la taxonomie végétale dans ces différents
milieux permet dans la mesure du possible de sensibiliser les
communautés locales d’une part, mais aussi les décideurs politiques,
plus précisément le Ministère de l’Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme (MECNT), le Ministère de l’Energie ainsi que
d’autres acteurs intéressés à la problématique végétale sur les espèces
en voie de disparition. Bref, l’importance que revêt notre flore en
terme de quantité de bois commercialisé et des enjeux socio-
économiques et environnementaux.
II. Aperçu linguistique
Nous voudrions ici brosser succinctement la localisation
géolinguistique des cinq langues sous étude taxonomique avant de
nous lancer dans l’étude ethno-onomastique, plus particulièrement
dendronymique.
a. La langue bóa
La langue bantu parlée en République Démocratique du Congo.,
dans la Province Orientale, District de Bas-Uélé, Territoires de Buta
et Bambesa ; généralement entourée de Zándé au Nord ; de kingelema
et kimanga au Sud, de Barambo et Kɛrɛ à l’Est et, enfin, de Kibenza,
à l’Ouest. Kadima K. et alii, cités par Bokula M. (2005, p. 16) la
classe dans la Zone C (311).
b. La langue bodo
La langue bantu parlée en République Démocratique du Congo,
dans la Province Orientale, District de Haut-Uélé, dans le Territoire
de Wamba ; classée par Kadima K. et alii, cité par Bokula M. (2005,
p. 18) dans la Zone D (404).
c. La langue bínza (Sud)
Langue bantu parlée dans la Province de Maniema, Territoire de
Kasongo, en République Démocratique du Congo. Elle est classée par
Kadima K. et alii, cité par Bokula M., (2005, p. 18) dans la Zone D
(432).

Annales FLSH N° 17 Spécial JUOR (2013)
4
d. La langue olombo
Langue bantu parlée en Province Orientale, District de la Tshopo,
Territoire d’Isangi, en République Démocratique du Congo, classée
par Kadima K. et alii, cité par Bokula M. (2005, p. 17) dans la Zone C
(324).
e. La langue Zándé
C’est une langue qui se distancie des autres du fait qu’elle
n’appartient pas au groupe bantu, mais non bantu. C’est une langue
oubanguienne avec le code (138) d’après l’Atlas Linguistique du
Zaïre de Kadima K. et alii, cité par Bokula M. (2005, p. 24). Son
influence ou expansion s’étend sur les Districts de Haut et Bas-Uélé et
déborde les frontières nationales ; elle est parlée aussi au Sud-Soudan
et en République Centrafricaine. On peut la localiser d’une manière
particulière au Territoire de Póko, District de Bas-Uélé, en
République Démocratique du Congo.
I. La taxonomie végétale
Nul n’ignore que le milieu culturel des communautés exerce un
rôle important dans la structuration du lexique ou la taxonomie d’une
langue, laquelle reflète le centre d’impulsion dans tous les domaines
de la vie sociétale (technologie, organisation sociale, croyances, arts,
cosmogonie …). Ainsi, nous avons fait la recension des lexèmes
spécifiques désignant les plantes et leurs utilités dans quelques
langues congolaises. En effet, la taxonomie se veut, comme nous
l’avions souligné ci haut, le domaine des lois de la classification des
espèces végétales. A ce sujet, Jacqueline Thomas et Paulette Roulan
(2001, p. 30) précisent que les études taxonomiques aboutissent à la
conception qu’un peuple se fait du monde (végétal) pour mieux
appréhender son univers cosmique. Nous en donnons le sens et
l’utilité de ces espèces végétales.
a. La taxonomie bóa
1. Asúkúlí söpö : ce qui nettoie le ventre
- Asúkúlí (nettoyer)
- söpö (ventre)
Sens sociologique
Cette plante bóa est utile dans ce milieu, car lorsqu’un enfant
souffre des maux de ventre, l’on s’en sert. On l’utilise aussi
pour pratiquer le purge et cela soulage.

Annales FLSH N° 17 Spécial JUOR (2013)
5
2. Ezázá mbué : la plante qui provoque la pluie lorsqu’on la coupe.
- Ezázá : (couper)
- mbué : (pluie)
Sens sociologique
Les peuples bóa, lorsqu’ils cultivent leurs champs pendant la
saison sèche, ils coupent expressément cette plante pour qu’il
pleuve, d’où son utilité.
3. Mátetele : espèce de plante qui se trouve toujours derrière la
maison.
Sens sociologique
Cette de plante sert à soigner les enfants faisant des
convulsions.
4. Mápeté : piéger (peté)
• sens sociologique : c’est une espèce de plante très utile
servant des pièges, très flexible et sèche difficilement.
5. Etuí (vient du verbe tube qui signifie porter) : espèce de plante
dont l’écorce sert d’habit ou de tissu traditionnel chez les
hommes bóa.
6. máßangóßangó : le sang
“ ßángo ßángo :(couleur rouge comme le sang)
sens sociologique : c’est une plante dont la sève ressemble au
sang (humain) et souvent utilisée par les paysans pour soigner
les personnes anémiques.
7. mápípi : noir ou sombre
sens sociologique : c’est l’espèce d’un bananier dont les fruits
deviennent noirs à la maturité. Ce sont des bananes de bonne
qualité mais rares.
8. ekopí (vient du verbe kopée) : ravir
sens sociologique : c’est une plante qui sert souvent de clôture
très infranchissable, car elle a une sorte d’épines semblables aux
griffes de léopard. Ces feuilles séchées constituent l’engrais
chimiques de haute qualité.
9. adiámalembá (du verbe di/doue qui signifie provenir)
“malémbá“ : fétiche, sorcellerie
sens sociologique : c’est une plante dont les tubercules (patate
douce) ont plusieurs couleurs que les gens considèrent comme
provenant des sources mystérieuses. Cette patate douce est très
préférée parce qu’elle est trop succulente.
10. málépingílípingi (verbe pingé) : grandir
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%