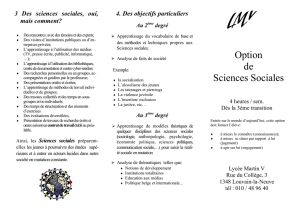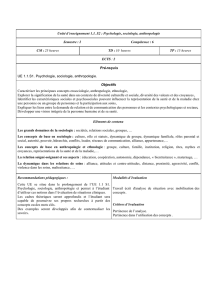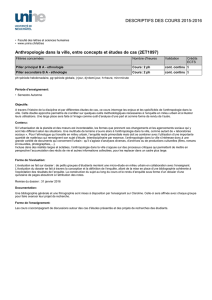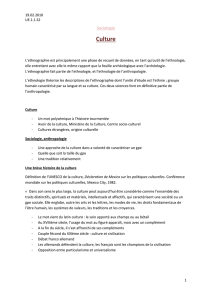Pratiquer l`anthropologie de l`enfance en sciences de l`éducation

40 ans des sciences de l’éducation, A. Vergnioux (dir.), Caen, PUC, , p. -
PRATIQUER L’ANTHROPOLOGIE DE L’ENFANCE
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION :
UNE AIDE À LA RÉFLEXION
Résumé : Pour traiter de la posture de l’anthropologue qui inscrit sa recherche en science
de l’éducation, je m’appuierai pour une part sur mon expérience personnelle. J’ai reçu une
formation universitaire d’anthropologie sociale et ethnologie et, au sein de ce cursus disci-
plinaire, j’ai choisi de travailler sur l’enfance, parcours qui m’a conduite à être aujourd’hui
enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation. Je tâcherai de poser quelques éléments
qui présentent la position de l’anthropologie en sciences de l’éducation. Mais avant même
cette présentation, c’est la position de l’objet enfance en anthropologie qui permettra de situer
la problématique dans laquelle se trouvent les chercheurs qui, dans cette discipline, choisis-
sent cet objet de recherche. Il s’agit en eet, d’une part, de distinguer la position de l’enfance
dans ma discipline de formation et celle de l’anthropologie en sciences de l’éducation, d’autre
part, d’examiner le cas particulier des anthropologues de l’enfance, chercheurs en sciences
de l’éducation et de poser des questions transposables à d’autres disciplines accueillies par
les sciences de l’éducation.
Mots clés : enfance, anthropologie, sociologie de l’enfance, décentrement, codisciplinarité.
L’inégal prestige des objets d’une discipline : un sujet tabou
L’enfant : « petit sujet » de l’anthropologie
Les questions d’enfance et d’éducation étaient, et demeurent en grande partie
aujourd’hui, non seulement des sujets peu nobles en anthropologie, mais encore
dévolus par tradition aux femmes. L’anthropologue américaine Margaret Mead avait
déjà dénoncé cette hiérarchie des objets de recherche. Elle écrivait en , à propos
de son ex-époux lui aussi anthropologue, Réo Fortune : « Réo décida qu’il s’occupe-
rait de la culture, et me laisserait la langue, les enfants, les techniques » 1.
1. Mead , .

J D
Dans un article déjà ancien et fameux pour les chercheurs du champ, les anthropo-
logues africanistes Suzanne Lallemand et Guy Le Moal présentaient eux aussi l’enfant
comme « petit sujet » dans leur discipline 2. Dans un article plus récent 3, la première
esquissait une histoire de l’anthropologie de l’enfance et notait l’intérêt plus grand
de ses confrères pour cet objet dans la première partie du XXe siècle qu’aujourd’hui.
Selon son analyse, actuellement, l’anthropologie de l’enfance balance entre une ten-
dance extérieure à son champ propre (la psychologie du développement et de l’ap-
prentissage) et des tendances plus conformes à ses orientations spéciques (l’analyse
des représentations symboliques de l’enfance, des rituels auxquels celle-ci donne lieu ;
l’examen des pratiques de soins de la prime éducation ainsi que les modalités d’in-
sertion familiale et sociale du jeune individu).
Un récent numéro de la revue d’ethnologie Terrain intitulé « Enfant et appren-
tissage » 4 corrobore ses propos en exposant des articles relevant des deux registres.
Parmi ceux-ci, celui de l’anthropologue américaine Lawrence A. Hirschfeld s’inti-
tule « Pourquoi les anthropologues n’aiment-ils pas les enfants ? » 5. Selon l’auteure, la
regrettable réticence des chercheurs de sa discipline à donner une place plus impor-
tante aux enfants résulte de ce qu’elle nomme deux erreurs : d’une part, une vision de
l’enculturation qui surestime le rôle joué par les adultes dans les apprentissages cultu-
rels des enfants et minimise celui de ces derniers dans la reproduction de la culture.
D’autre part, une méconnaissance de l’importance de la culture des enfants, en par-
ticulier dans son façonnage de celle des adultes. Ces lacunes pèsent sur l’analyse que
nous faisons des phénomènes de transmission et de transformation des cultures,
pourtant centrales dans la discipline.
Ces diérents éléments montrent bien la position marginale et peu prestigieuse
de l’anthropologie de l’enfance aux yeux de la discipline, malgré les défenseurs du
champ. En fait, l’enfance est davantage étudiée indirectement à travers une anthro-
pologie attentive aux manières d’éduquer la jeune génération. Les recherches inter-
rogent l’action de l’adulte sur l’enfant pour le faire sortir de son état d’enfance et
l’amener à l’âge adulte. Elles n’interrogent pas l’expérience des enfants et peu leurs
relations entre eux.
Les objets de l’anthropologie qui intéressent les sciences de l’éducation
Si la recherche en anthropologie n’est pas la même quand elle est menée dans sa
discipline ou bien en sciences de l’éducation, c’est déjà parce qu’elle suppose une
sélection des objets qui intéressent celles-ci. Or c’est aujourd’hui l’anthropologie de
l’éducation qui semble le champ de cette discipline le plus développé en sciences de
l’éducation.
2. Lallemand & Le Moal .
3. Lallemand .
4. Terrain .
5. Hirschfeld .

P ’ ’…
Le champ a surtout traité des populations de territoires exotiques, dans le but
de découvrir des modes d’éducation coutumière diérents des nôtres 6, mais aussi,
dans les anciennes colonies, an d’adapter la pédagogie occidentale au contexte local.
L’œuvre de Pierre Erny est sans doute la plus révélatrice de cette double volonté. Son
parcours montre comment, dans les années et suivantes, on pouvait conjuguer
les disciplines. Lors d’une communication orale en septembre 7, il présentait
sa carrière de la manière suivante. De formation philosophique, il a été instituteur
dans une école de campagne dans l’actuel Burkina Faso à la n de l’époque colo-
niale () et plus tard au Rwanda, puis de retour en France il a reçu une forma-
tion en psychologie et ethnologie à l’université de Strasbourg. Dès qu’il a commencé
à enseigner dans cette université, il a cherché à mettre les données ethnologiques à
la disposition des pédagogues, des enseignants et des psychologues. Il a participé à
la mise en place du programme des sciences de l’éducation dans son université. Il a
ensuite enseigné dans des universités africaines, puis de retour en France il a ensei-
gné la psychologie sociale puis l’ethnologie, toujours à Strasbourg. Il était donc en
même temps du côté de la pédagogie et de l’ethnologie. Dans ses cours à l’univer-
sité africaine, il était dans une problématique ethnopédagogique qui voulait adap-
ter la pédagogie occidentale aux contextes culturels locaux grâce aux connaissances
ethnologiques. Dans ses ouvrages, il a davantage développé l’ethnologie de l’édu-
cation à partir d’une présentation du statut de l’enfant africain et de son éducation
traditionnelle. Bien que l’ethnopédagogie ait été sa motivation de départ, il l’a na-
lement peu développée.
Ses travaux comportent donc une approche transdisciplinaire, alliant l’ethno-
logie de l’enfant et de l’éducation en Afrique (ce qu’il a appelé la païdologie, l’an-
thropologie appliquée à l’enfant
8
), l’approche sociologique et historique de l’école
africaine comme institution, et l’approche psychologique de l’enfant et de l’adoles-
cent. Il déplore qu’aujourd’hui, en ethnologie, il soit devenu un tabou de s’ouvrir à
la pédagogie.
Son parcours amène à rééchir sur les conséquences sur la recherche des fron-
tières disciplinaires, telles qu’elles sont construites aujourd’hui institutionnellement,
notamment à l’échelle d’un chercheur. Quelles en sont les conséquences sur sa manière
de penser ses problématiques ?
Sur ce point, inscrire sa recherche en sciences de l’éducation suppose une réexion
transdisciplinaire, quelle que soit la manière dont celle-ci se mette en œuvre, car la
construction de cette « discipline pluridisciplinaire » suppose que toute question gagne
à être abordée conjointement par plusieurs disciplines, chacune apportant ses ques-
tions, ses concepts et ses méthodologies.
6. Rabain .
7. Erny .
8. Erny .

J D
L’anthropologie développe d’ailleurs, sur les thématiques éducatives, des recher-
ches interdisciplinaires avec la psychologie notamment, par exemple pour étudier
les ethnothéories parentales qui analysent les attentes et exigences des parents envers
leurs enfants, en fonction des capacités qu’ils leur prêtent à un âge donné. Pour
répondre aux interrogations de nos sociétés face aux dicultés rencontrées par
l’école, aux États-Unis et en Europe notamment, elle a adapté ses théories, issues de
l’anthropologie culturelle, an d’analyser les situations des minorités ethniques à
l’école et leur problème d’échec scolaire, ou encore pour comprendre les malenten-
dus culturels entre enseignants et élèves. Elle a donc été sollicitée pour proposer des
solutions aux dicultés pédagogiques rencontrées par les enseignants, et on a vu
par exemple en France à partir des années , dans les classes, la mise en place
par certains enseignants de la pédagogie de l’interculturalité, pour faire face à ces
dicultés.
L’anthropologie intéresse également les sciences de l’éducation pour sa métho-
dologie de l’enquête qui suppose une immersion sur le terrain et une observation
participante. Ces outils méthodologiques, repris également par des chercheurs de
disciplines voisines, notamment les sociologues, ont permis de développer une eth-
nographie de l’école attentive aux acteurs. Ils protent aussi aux professionnels déjà
en situation d’immersion qui utilisent ces techniques pour analyser leurs pratiques,
comme en témoigne un numéro de la revue Spirale coordonné par Michelle Guigue
et intitulé « Ethnographie de l’école » 9. Le numéro de la revue Ethnologie française
consacré à l’anthropologie de l’école et dirigé par Jean-Paul Filiod témoigne égale-
ment de l’apport de l’anthropologie à l’univers scolaire, qui, au-delà de méthodes
d’enquête, propose des outils conceptuels et des problématiques qui retravaillent
des questions des sciences de l’éducation.
En accueillant l’anthropologie dans sa réexion interdisciplinaire, les scien-
ces de l’éducation permettent à celle-ci une valorisation nouvelle d’objets qu’elle
considérait comme marginaux. Si jusqu’à présent les processus de développement,
d’intégration et d’apprentissage ont mobilisé les recherches autour de l’enfance, les
anthropologues ont dans leur discipline des outils conceptuels leur permettant de
développer une recherche centrée sur l’enfance. Celle-ci permet de considérer les
enfants comme un groupe social et suppose par exemple d’étudier, comme le fait
Hirschfeld, la culture enfantine 10. De manière plus globale, la démarche oblige à
saisir le point de vue des enfants sur leur expérience sociale et non, tel qu’il a été
classique de le faire, de s’enquérir du seul point de vue des adultes sur les sujets qui
les concernent. Il reste alors aux anthropologues de l’enfance à montrer aux scien-
ces de l’éducation l’intérêt d’une recherche ainsi centrée, intérêt que les chercheurs
de leur discipline éponyme ne semblent pas prêts à reconnaître.
9. Spirale .
10. Voir aussi Delalande .

P ’ ’…
Cultiver les enrichissements réciproques initiés par la rencontre
L’anthropologue qui inscrit ses recherches sur l’enfance en sciences de l’éduca-
tion voit son objet devenir légitime puisque les enfants font l’objet d’éducation. Le
chercheur s’enrichit des nouvelles questions auxquelles les sciences de l’éducation
le soumettent. Son inscription disciplinaire nouvelle lui permet d’envisager plus
concrètement la pratique de recherche pluridisciplinaire. Nous essaierons d’explo-
rer ces trois points.
Des connaissances mises à l’épreuve : le regard décentré
Pratiquer l’anthropologie de l’enfance dans sa discipline est une position relativement
confortable, tout du moins est-elle classique. Il s’agit d’utiliser les outils et théories
déjà élaborés par d’autres chercheurs pour penser son objet et développer des pro-
blématiques habituelles dans sa discipline, en utilisant les méthodologies d’enquête
testées par ses prédécesseurs. La confrontation avec des chercheurs, des profession-
nels et des étudiants des sciences de l’éducation amène à un exercice très diérent.
Formés par d’autres disciplines, habités par d’autres questions et préoccupés par
des situations professionnelles de terrain, ces acteurs perçoivent le regard de l’an-
thropologue sur l’enfance comme exotique. L’évidence des concepts de sa discipline
éponyme ne fonctionne plus et il doit en démontrer la validité pour penser des situa-
tions concrètes auxquelles il n’avait pas songé. Plus que le passage d’une anthropolo-
gie fondamentale à une anthropologie appliquée, la diculté réside dans le fait d’un
anthropologue qui s’applique à penser des questions qui ne sont pas les siennes sur
un objet de recherche qu’il croit connaître. Ce regard décentré sur l’enfance, préoc-
cupé par des questions pédagogiques notamment, met à l’épreuve ses constructions
théoriques. Ces dernières résistent-elles aux expériences des professionnels de l’en-
fance et aux autres analyses disciplinaires ?
Dans cette rencontre, il est dicile de démêler les apports de chacun pour l’autre.
Pour ma part, le regard des acteurs des sciences de l’éducation sur ma recherche (j’en-
tends les chercheurs, professionnels et étudiants) m’amène à constater que mes ana-
lyses les intéressent pour des raisons qui ne sont pas les miennes. De mon point de
vue, mes études me permettent de décliner l’idée de groupe social et culturel pour
penser une population enfantine et d’étudier des concepts classiques de ma discipline,
comme celui de culture et de transmission culturelle, d’identité sociale ou encore celui
du don et de son rôle dans les échanges, à l’échelle du groupe d’enfants auprès duquel
je travaille. Ma problématique demeure donc, ou devrais-je dire demeurait, car préci-
sément le contact avec ma discipline d’accueil enrichit mon regard, celle d’une mono-
graphie d’un groupe déni, en cherchant à voir ce qui découle de la spécicité de cette
population qui se trouve dans une relation de dépendance avec des adultes.
Pour les acteurs des sciences de l’éducation, mes analyses permettent de poser
un autre regard sur l’être à éduquer, en approfondissant ce qui se joue entre enfants,
autrement dit en sortant d’un « adultocentrisme » qui réduit les questions d’éducation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%