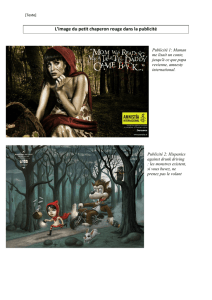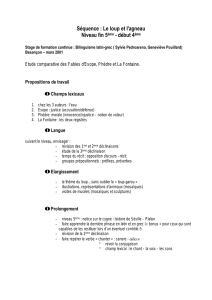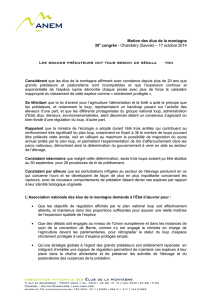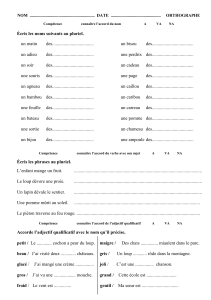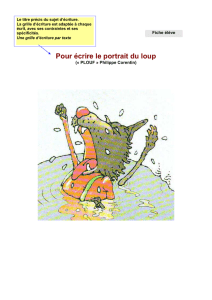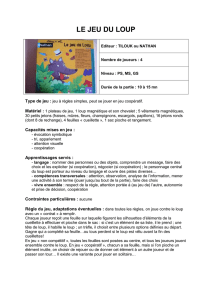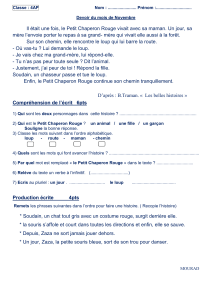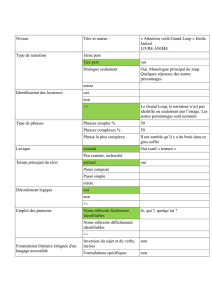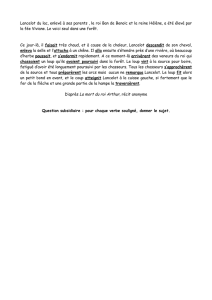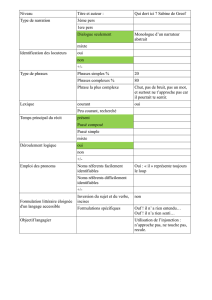Quel impact du loup

14
La voie du loup
numéro24
juillet
2 0 0 6
DOSSIER
Au long de l’arc alpin français, le loup est accusé de décimer
ses espèces proies, voire parfois de mettre en danger le devenir
même de certaines populations d’ongulés.
Qu’en est-il en réalité ? Et quels sont les maux dont n’a pas été
accusée cette « bête malfaisante » ?
Guetter les enfants au coin du bois... S’attaquer à l’homme à
l’occasion (voir notre dossier précédent)... Mettre l’élevage en
péril... Enfin, anéantir les espèces proies dont elle se nourrit !
A elle seule, cette outrance dans l’accusation devrait paraître
suspecte.
Un argument, marqué au sceau du bon sens, ne semble pas avoir
frappé ceux qui crient au loup : comment se fait-il –si le loup est
capable d’éradiquer ses espèces proies– qu’il n’ait pas disparu
d’à peu près partout dans le monde, faute de nourriture ?!
Si le loup est revenu en France, c’est précisément parce que les
populations d’ongulés sauvages sont florissantes. Et c’est parce
qu’elles persistent dans cette courbe ascendante que le prédateur
peut continuer à coloniser de nouveaux territoires (car il est établi
que c’est la nourriture disponible en hiver, autrement dit,
la présence d’herbivores sauvages sur un territoire donné, qui
détermine l’installation du loup sur de nouvelles zones).
Mais à travers le loup, c’est aussi le principe de la prédation qui
est remis en cause. Sensiblerie ? Hypocrisie ? Concurrence ?
Nous verrons dans ce dossier que la prédation est vieille
comme la vie et a toujours participé à l’évolution des milieux et
des équilibres naturels*.
L’examen attentif des plans de chasse nous montre par ailleurs
que la part du loup reste très marginale par rapport à la pression
cynégétique.
Alors, pourquoi tant de haine ? Et où est la raison dans tout cela ?
Justement, le loup navigue dans les zones sombres de notre
inconscient collectif d’où la rationalité est écartée...
Raison de plus pour remettre, encore et encore, l’ouvrage sur le
métier.
Quel impact du loup
sur les ongulés sauvages ?
* Sur ce thème, nous vous recommandons deux expositions réalisées par la ligue ROC. L’une,
”Prédation et biodiversité”, explique ce qu’est la prédation et son importance pour les écosystèmes.
L’autre, ”L’homme et les prédateurs, une relation parfois difficile”, approfondit la relation ancestrale
homme/prédateurs et invite à accepter de vivre avec ces animaux encore trop souvent mal aimés.
http://www.roc.asso.fr/protection-faune/predation-biodiversite.html
http://www.roc.asso.fr/protection-faune/homme-predateur.htm
ou : Ligue ROC, 26 rue Pascal, 75005 Paris – Tél : 01 43 36 04 72.

15
La voie du loup
24numéro
juillet
2 0 0 6
PLANS DE CHASSE RÉALISÉS
source : ONCFS
ÉVOLUTION DES PLANS DE CHASSE
Les chasseurs se plaignent que l’impact du loup sur “leur gibier”
est insupportable et met en danger certaines espèces d’ongulés...
Nous avons fait de nombreuses recherches mais, en France,
aucune étude n’existe encore pour mesurer l’impact réel du loup
sur la faune sauvage (une étude dirigée par l’ONCFS est en cours
mais ne livrera pas ses résultats avant quelques années). Nous
avions donc comme seuls éléments pour tenter une première
approche de la question, notre connaissance du terrain et de la
biologie des espèces, les études menées à l’étranger et l’évolution
des plans de chasse dans les régions concernées. Vous livrer la
totalité des chiffres de ces 30 dernières années aurait été long et
fastidieux. Nous avons donc choisi de porter à votre connaissance
un condensé des plans de chasse aux ongulés, réalisés dans les
départements alpins, en faisant un point de l’évolution par tranches
de 10 ans (1er tableau).
Ce premier tableau qui est un résumé, une seconde synthèse fait
état du nombre total d’ongulés abattus dans le cadre des plans de
chasse (le braconnage n’est pas pris en compte dans ces chiffres)
ces 30 dernières années, toujours dans les départements alpins.
Ce qui donne un total de 1 849 659 ongulés sauvages officiel-
lement abattus en 30 ans dans les régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Rhône-Alpes.
Comme vous le constaterez, l’évolution n’est pas à la baisse des
plans de chasse. D’où deux hypothèses de travail :
- soit le loup fait réellement chuter les effectifs de ses espèces
proies et il serait alors souhaitable que les chasseurs diminuent
leurs plans de chasse afin de protéger la ressource,
- soit les espèces en question continuent à bien se porter malgré
la prédation et une pression de chasse qui n’est pas anodine et
cela veut alors dire qu’il y a à manger pour tout le monde !
Nous nous sommes en outre livrés à des extrapolations rapides :
si chaque loup “prédate” un ongulé par semaine (ce qui est supé-
rieur à la réalité, mais ne lésinons pas), et si les loups étaient 100
en 2004 (ce qui est surévalué aussi, mais le chiffre est rond), ils
auraient donc “prélevé” (!) 5200 ongulés, soit 4 % du tableau total
des chasseurs !! Et même 11 % du seul tableau des chevreuils,
si on estime que c’est l’espèce dans laquelle ils “tapent” le plus...
Tout en sachant que les chasseurs sont certes beaucoup plus
nombreux... mais aussi qu’il ne faut pas tout ramener à l’espèce
humaine (c’était l’idée de mesurer/projeter la “part du loup”).
Sachant qu’un loup franco-italien mange en moyenne 2 kg de
viande par jour, ramené à une année, cela fait 730 kg de viande
et, à l’échelle d’une meute, cela donne environ 3,5 tonnes par an.
Autrement dit, les cerfs tués à la chasse en 2004 dans le seul
département des Alpes-Maritimes permettraient à une meute de
loups de se nourrir pendant 20 à 25 ans selon leur poids !!!
Les chiffres (tout au moins ce que nous en connaissons) sont
donc sur la table et le débat est ouvert.
5
TOTAUX DES PLANS DE CHASSE PAR ESPÈCES
DE 1973 À 2003 OU 2004

16
La voie du loup
numéro24
juillet
2 0 0 6
Rien pourtant, ni dans les données de l’éco-
logie scientifique, ni dans le suivi de la faune sau-
vage dans les départements concernés, ni dans
les situations observées ailleurs en Europe ne
plaide en ce sens, bien au contraire.
La prédation est vieille comme le monde...
ou presque. Elle apparaît avec le premier carni-
vore, il y a quelques dizaines de centaines de mil-
lions d’années. Et, depuis, proies et prédateurs se
rendent “coup pour coup” évoluant de concert
pour maintenir un équilibre entre les qualités de
chasseur des seconds et les aptitudes à s’échap-
per des premiers.
A l’échelle géologique des temps, loin d’être
une menace pour la biodiversité, la prédation
est au contraire un des moteurs de l’évolution,
source de diversification. Le loup et les ongu-
lés d’Europe résultent de cette évolution, et,
n’échappant pas à la règle, cohabitent (et co-évo-
luent) depuis le début de l’ère quaternaire.
Et à cette échelle plus “humaine” de quel-
ques millions d’années on constate même que
cette cohabitation se fait à bénéfice réciproque.
Certes, pas pour les proies individuellement cro-
quées (ou les prédateurs mourant de faim), mais
pour les populations et les écosystèmes dans
lesquels ils évoluent.
QUE VOUS AVEZ DE BELLES DENTS !
A grands coups d’autorégulations, positives
ou négatives, la prédation participe au maintien
des grands équilibres naturels.
Schématiquement, une augmentation des
herbivores signifie une augmentation de la res-
source alimentaire pour les carnivores.
En conséquence, ceux-ci prolifèrent et
“tapent” plus dans un “stock” d’herbivores ce qui
évite, au passage, que ces derniers “n’épuisent” la
végétation.
Les populations d’herbivores régressent
alors (par l’augmentation de la prédation). Il n’y
a plus assez à manger pour les carnivores (dont
les populations diminuent) pendant que la res-
source alimentaire des ongulés se reconstitue...
et le cycle recommence.
Les populations évoluent ainsi, suivant des
hauts et des bas autour d’un point d’équilibre.
Autre conséquence bénéfique, cette pres-
sion constante et réciproque entre proies et pré-
dateurs s’exerce d’abord sur les individus les plus
faibles (dont les malades et les blessés). Ce sont
eux qui disparaissent les premiers, ce qui bénéfi-
cie aux populations dans leur ensemble.
On notera qu’à l’inverse, la chasse privilégie
plutôt le trophée et la rareté, ce qui n’aide pas
des populations fragilisées (cas du tétras dans les
Alpes du Sud).
Ainsi donc, depuis Darwin, sait-on que la
prédation est un des mécanismes qui, moteur
de l’évolution, régulateur des populations et ges-
tionnaire des ressources, concourt au maintien
dynamique des équilibres naturels.
Ce bel équilibre peut-il être rompu ? Dans
un milieu plus ou moins déséquilibré (comme
en France où il n’y avait plus de prédateurs), le
retour du loup peut-il présenter un risque pour
les populations d’ongulés sauvages ?
- Peut-on craindre que la disparition du loup
pendant un siècle ait fait perdre leurs facultés de
“défense” aux ongulés ? Non, l’évolution ne se
fait pas à cette échelle, les chevreuils et chamois
du 21ème siècle sont aussi bien armés génétique-
ment que ceux du néolithique pour répondre à
la prédation du loup.
- Peut-on penser que l’artificialisation du
milieu handicape les ongulés sauvages ? L’évo-
lution des populations, des plans de chasse et de
leur réalisation plaide pour le contraire.
Dans les Alpes-Maritimes, où la quasi tota-
lité des chamois sont en zone de présence du
loup, la population continue d’augmenter, les
plans de chasse et leur réalisation suivent...
La prédation,
une mort naturelle
Tiouuu, alerte, tiouuu, alerte, tiouuu, alerte...
“Le loup est un carnivore cruel qui, en tant que tel, va faire main
basse sur la chair fraîche de nos bois et nos alpages. Outre son
impact sur l’élevage, le retour du loup va décimer la faune sauvage”.
Tel est, en gros, le nouveau credo de quelques esprits chagrins sur
les conséquences présupposées désastreuses du retour du loup.
Par
Christophe Bonnet,
vétérinaire et administrateur
de l’UDVN 04

17
La voie du loup
24numéro
juillet
2 0 0 6
DOSSIER
Même le mouflon, espèce à priori la plus
vulnérable, se maintient, sans réduction des
plans de chasse...
En fait, si le retour du loup se traduit par des
modifications de la répartition, du comporte-
ment et des effectifs, il semble bien, à la vue de
ces données de l’ONCFS que ceux-ci finissent
par se stabiliser en quelques années autour d’un
nouvel équilibre.
Enfin, mais est-il bien utile de le rappeler,
dans des situations un peu similaires en Italie et
en Espagne, où la présence du loup n’a jamais été
interrompue, les populations d’ongulés sauvages
se portent bien, merci pour elles.
Rien donc ne permet d’accorder le moindre
crédit aux cris d’orfraie des alarmistes.
L’ARROSEUR ARROSÉ
Par contre, en regardant ce qui se passe
depuis que l’homme est homme, on constate que
toutes les menaces qui ont pesé et pèsent encore
sur la pérennité et la diversité de la faune sau-
vage ont une origine humaine. Et que la chasse
et l’agriculture tiennent une place de choix dans
ces menaces.
Alors entendre les chasseurs et les éleveurs
hurler de concert au loup renvoie, une fois de
plus, à la question de leurs compétences et de
l’incohérence entre leur discours et leurs actes.
Intenable scientifiquement, la “remise en
cause” de la prédation ne l’est guère plus anthro-
pologiquement, quand, autre antienne des phi-
losophes de comptoir, elle est assimilée à de la
cruauté.
La cruauté est un trait de caractère humain,
et seulement humain puisqu’il nécessite la cons-
cience et la gratuité de ses actes, deux éléments
absents du monde animal sauvage.
Bien sûr, la prédation est un acte brutal,
pas forcément très agréable à regarder. Mais ne
faudrait-il pas, alors, pousser la logique jusqu’au
bout ? Ne sommes-nous pas, dans notre majorité
des carnivores, des prédateurs par procuration
laissant aux abattoirs le soin de nous cacher cette
réalité ? La mort et ses prémisses sont-ils moins
pénibles pour les animaux qui les subissent si
nous ne les voyons pas ?
Dans le cas des animaux de boucherie, la
fin est la même, et le stress qui précède l’abat-
tage ne diffère de celui d’un animal croqué par
son prédateur que par sa durée, infiniment plus
longue... Et que dire alors de certaines pratiques
comme la chasse ou la corrida par définition bien
plus proches de la cruauté que de la prédation ?
Que dire de certaines “traditions culinaires”
qui imposent des conditions d’élevage plus que
limites aux animaux qui les subissent ? Que dire
des volailles en batterie, ou de notre engouement
pour les NAC (nouveaux animaux de compa-
gnie) dont on sait que, du début à la fin, la filière
est un énorme gâchis (pour rester gentil)...
La liste est ainsi longue de nos contradic-
tions. Et bien malin sera celui qui arrivera à en
tirer une logique ou une conclusion définitive.
Par contre, une chose est sûre, la seule sensibilité
“humaine”, avec tout l’irrationnel qui la caracté-
rise, n’est pas très pertinente pour analyser un
phénomène “purement” naturel comme la pré-
dation. On peut toujours faire pleurer dans les
chaumières, ou agiter la crécelle de la peur, un
autre moteur très efficace de mobilisation, ce
n’est pas pour autant que l’on aura avancé...
Le retour du loup ne pose-t-il donc pas suffi-
samment de problèmes concrets (protection des
troupeaux domestiques) que nous ayons besoin
d’y rajouter de la sensiblerie ?
5
page précédente
Vieille comme le monde,
la prédation est un des moteurs
de l’évolution.
ci-dessus
La prédation n’a jamais
représenté une menace
pour la biodiversité.
Les activités humaines si !
Photographies de N. Buhrel

18
La voie du loup
numéro24
juillet
2 0 0 6
6 Que pouvez-vous nous dire de l’impact du loup
sur les ongulés sauvages en France ?
Eric Marboutin : Pour l’instant peu de
données sont disponibles, essentiellement
parce qu’il n’y a pas de méthodes à la fois vrai-
ment robustes et vulgarisables pour suivre les
évolutions des populations d’ongulés sauvages;
certaines enquêtes auprès de détenteurs de
droit de chasse ou informations émanant de ces
milieux laissent penser qu’en quelques endroits
de nombreux cadavres de proies sauvages (essen-
tiellement cerfs et chevreuils) soit attribuables à
la prédation du loup; il semble aussi dans ces cas
que cela puisse coïncider avec une forte con-
centration momentanée des populations de ces
espèces sur des zones plus accessibles en temps
de neige (gagnage herbager disponible, moindre
profondeur de neige, arbres à écorcer), zones sur
lesquelles le loup concentrerait alors lui aussi
son action de prédation. Sur le massif de Belle-
done, dans la zone d’Arvillard par exemple, de
nombreuses carcasses de cervidés auraient été
retrouvées localement -mais n’ayant pas toutes
fait l’objet d’une expertise par le réseau Grands
Carnivores Loup-lynx- durant les hivers passés ;
toutefois lors de comptages nocturnes au phare
des cervidés dans ces vallées du massif de Bel-
ledonne, on détecte de plus en plus de cerfs par
exemple.
Tout se passe comme si l’action de préda-
tion, concentrée momentanément dans l’espace
lors de l’hiver, présentait des effets dilués dans
un espace plus conséquent par la suite (celui de
la vraie échelle spatiale de la population de cerfs
par exemple), effets qu’au mieux on ne parvient
plus à détecter par les méthodes de suivi classi-
que (comptages nocturnes de cervidés); un cas
semblable (concentration spatiale des attaques
de loups sur cervidés) semble aussi se produire
sur la partie basse en altitude du domaine de la
meute du Thabor-Galibier (versant moyenne
vallée de Maurienne). L’impact du loup dans les
conditions écologiques actuelles de disponibilité
et de diversité des proies potentielles est proba-
blement hétérogène selon les zones, et difficile
à cerner (mortalité additive, compensatoire, les
deux ?); c’est la raison pour laquelle l’ONCFS a
initié, en collaboration avec le CNRS et le Parc
national du Mercantour ainsi que la Fédération
des chasseurs 06, l’étude « prédateur-proie » pilo-
tée par Carole Toigo et Ariane Bernard-Laurent
(avec Xavier Tardi en tant que personnel d’ap-
plication, responsable sur le terrain des captures
d’ongulés): cette étude mesurera les différentiels
de taux de survie, de fécondité...etc, entre zones
soumises à plus ou moins forte prédation par
le loup (sur cerf, chevreuil, chamois, mouflon),
ainsi que la réponse spatiale des proies (éclate-
ment des groupes ou regroupement, vigilance/
réaction de fuite plus prononcées).
6 Certains échos sont très alarmistes... Assiste-
t-on à une évolution à la baisse des plans de
chasse qui traduirait une baisse des effectifs
d’ongulés ?
E.M. : En certaines zones, les plans de
chasse ont baissé alors que les prédateurs (loup
ou lynx) potentiels n’y sont pas détectés ; en
d’autres endroits, il y a coïncidence en baisse
des plans de chasse et présence détectées des
prédateurs; en fait quasiment tous les apparie-
ments entre tendances des plans de chasse et
présence/absence des prédateurs peuvent être
rencontrés. En matière de chevreuil par exemple,
on connaît maintes zones avec plan de chasse en
baisse et pas de prédation autre que celle issue de
l’activité cynégétique, cette dernière étant même
parfois très modérée (i.e. ce n’est probablement
même pas la chasse qui explique la baisse de la
population de chevreuils); inversement, on con-
naît aussi des zones où il semble y avoir au mini-
mum une coïncidence temporelle entre appari-
tion puis installation d’une meute et baisse des
plans de chasse ; une partie du questionnement
au moins provient du problème de différentiel
d’échelle spatiale entre le rayon d’action du loup
(150 à 300 km2 pour une meute) et le rayon d’ac-
tion de la perception du problème cynégétique
et de sa gestion (échelle d’une commune le plus
souvent).
6 Quels enseignements tirez-vous des études
menées dans d’autres pays ?
E.M. : En matière d’études scientifiques
robustes, la quasi totalité des informations vient
d’écosystèmes peu comparables au nôtre : sou-
vent caractérisés par des systèmes basés sur une,
voire deux espèces proies, les relations sont plus
«directes» et plus «fortes» potentiellement entre
le prédateur et sa proie. Chez nous, on peut s’at-
tendre à un mécanisme de switching entre plus
d’espèces de proies (cerf, chevreuil, chamois,
mouflon, sanglier) au gré de l’évolution de leur
Questions
à
Eric Marboutin,
chef de projet loup/lynx
à l’ONCFS (Office national
de la chasse et de la faune
sauvage)
&
à
Benoît Lequette,
chef du service Etude et
Gestion du Patrimoine au
Parc national du Mercantour
Propos recueillis
par Florence Englebert
3
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%