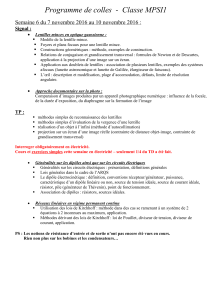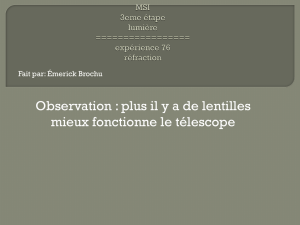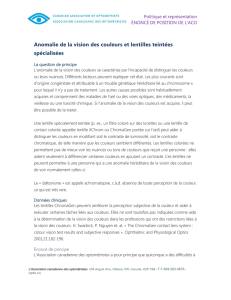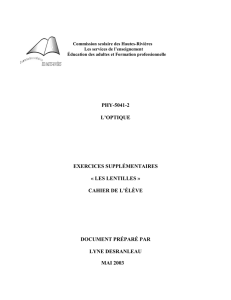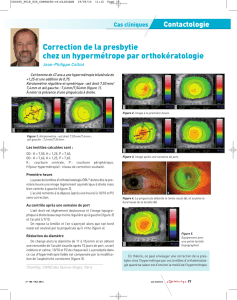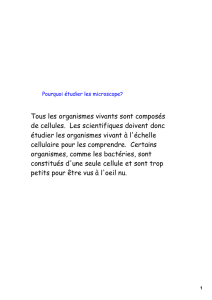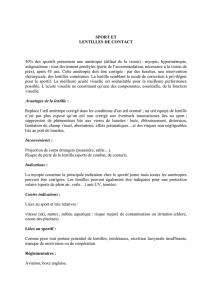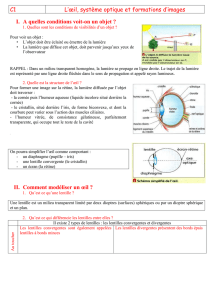L`orthokératologie évolue, les contactologues s

Les Cahiers
20
Contactologie
Comment ça marche ?
Les techniques ont évolué : autrefois très aléatoires,
elles sont devenues plus scientifiques. Elles ne
s’adressent cependant qu’à de faibles amétropies. Les
indications sont en effet limitées à 4 dioptries sphé-
riques de myopie (pour de petits myopes qui cherchent
à avoir une certaine liberté), 0,75 dioptries en astigma-
tisme inverse et 1,50 dioptrie en astigmatisme
conforme à la règle. La CRT peut donc représenter une
alternative à la chirurgie réfractive chez certains
patients.
Des effets lentille-dépendants
La zone optique centrale plate de la lentille exerce une
pression positive à la surface de la cornée. De ces
forces centrifuges appliquées aux cellules épithéliales
découlent un amincissement central de l’épithélium et
un épaississement relatif en moyenne périphérie.
Pour parvenir à l’effet réfractif souhaité, on peut, par
exemple, utiliser une lentille tétracourbe de dernière
génération. Elle dispose d’une zone optique très plate,
qui décolle du centre de la cornée et crée un anneau
circulaire de larmes autour de la zone centrale. Cette
zone optique est entourée d’un deuxième rayon
d’excentricité inverse qui rejoint la cornée, puis d’un
rayon d’alignement pour s’adapter à la périphérie nor-
male de la cornée. Enfin, un dernier dégagement péri-
phérique assure à la lentille une dynamique et une
circulation des larmes de bonne qualité.
De la même façon, un deuxième type de lentilles asso-
cie un rayon de courbure central pour une zone
optique très plate, un deuxième rayon inférieur au pre-
mier, qui permet de ménager un réservoir de larmes,
un troisième rayon qui s’aligne sur la cornée puis un
dégagement périphérique qui assure les échanges
lacrymaux. Ceci aboutit à un résultat identique à la
lentille précédente.
L’orthokératologie évolue,
les contactologues s’interrogent
Véronique Barbat
’orthokératologie, ou CRT (Corneal Refractive Therapy, ou Corneal Reshaping
Therapy) est une méthode destinée à corriger de façon réversible certains troubles
modérés de la réfraction. Elle agit par l’intermédiaire d’une déformation contrôlée de la
cornée induite par le port nocturne de lentilles rigides hautement perméables à l’oxy-
gène. Les patients sont donc libérés de leur correction dans la journée. Née dans les
années soixante, l’orthokératologie bénéficie actuellement d’un regain d’intérêt à la
suite de l’apparition des lentilles à géométrie inversée. Celles-ci accélèrent et amélio-
rent en effet les résultats tout en réduisant les risques qui étaient liés à l’utilisation de
lentilles conventionnelles.
Début 2002, la Food and Drug Administration a donné son agrément pour la pratique de
cette orthokératologie nocturne. On estime actuellement à 600000 le nombre de por-
teurs de lentilles d’orthokératologie dans le monde dont environ 300000 en Asie et
300 000 aux États-Unis et en Europe.
Lors du dernier congrès de la SFO, la réunion de la SFOALC (Société française des oph-
talmologistes adaptateurs de lentilles de contact) a permis de faire le point.
L
CDO82 24/04/06 16:09 Page 20

Les Cahiers
22
Contactologie
Le choix de la lentille dépend du profil de la cornée.
Des schémas existent, inclus dans des programmes
informatisés, qui permettent d’obtenir des lentilles
sur mesure en fonction de la topographie de la cornée
considérée et du résultat que l’on cherche à obtenir.
Le principe du traitement (aplatissement pour remo-
delage de la cornée) est donc le même que celui de la
chirurgie réfractive, à ceci près que les modifications
cornéennes induites par la CRT sont réversibles.
Bien qu’évidentes, les contre-indications méritent
d’être rappelées
Il s’agit des pathologies de la surface oculaire, des
dystrophies épithéliales et endothéliales, du kérato-
cône, des érosions récurrentes épithéliales, des syn-
dromes secs sévères et des pupilles larges (qui
seraient responsables d’un résultat inadéquat).
L’utilisation de la CRT pour traiter des enfants soulève
le problème des complications potentielles, d’ailleurs
relatées dans la littérature. Si la méthode suscite l’en-
thousiasme des patients, des fabricants et des opto-
métristes à travers le monde et en France, l’éthique la
plus élémentaire devrait donc imposer de ne pas l’uti-
liser chez l’enfant, jusqu’à en savoir plus.
La recherche des contre-indications doit aussi tenir
compte de la sélection des patients : bons ou mauvais
candidats pour la méthode.
La première expérience clinique
française a débuté en mars 2003
Pour collecter des informations fiables
à l’adresse des patients
La première étude française, menée en partie à
l’Hôtel-Dieu (Paris) dans le service du Professeur
Renard, était justifiée par l’engouement du public et de
certains professionnels, par la multiplication des
publications qui traitent d’orthokératologie, et par
l’amélioration des matériaux et de la fabrication des
lentilles. Son but était de tester la méthode afin de
sécuriser les pratiques, de recueillir des données pré-
cises et de les diffuser. Il s’agissait de tester l’efficacité
des nouvelles lentilles d’orthokératologie, de contrôler
les changements réfractifs et leur évolution dans le
temps, d’étudier les variations topographiques et l’état
de surface cornéenne et de fixer les limites de cette
orthokératologie moderne.
Quarante patients ont été enrôlés, dont la myopie
s’échelonnait de –1 à –4. Bien que le recul ait été d’un
an chez certains d’entre eux, l’orateur n’a présenté
que les résultats de l’étude à six mois.
L’excentricité : un point important pour adapter
des lentilles de CRT
Plus l’excentricité est faible, plus les chances de réus-
sir une adaptation d’orthokératologie diminuent. Si
l’on considère la réduction de la myopie, la qualité du
résultat varie aussi avec le rayon de courbure : faible
rayon de courbure et forte excentricité augmentent les
chances alors que grand rayon de courbure et faible
excentricité les réduisent.
En mai 2004 et en France, seul le laboratoire
Technolens était en mesure de proposer des lentilles
d’orthokératologie à la norme CE. Celles-ci sont fabri-
quées sur mesure pour chaque patient. Pour en effec-
tuer le calcul, il faut communiquer au laboratoire : la
réfraction, les diamètres cornéens horizontal et verti-
cal, les rayons de courbure, l’excentricité cornéenne
et, surtout, la vidéotopographie, qui, selon les pro-
grammes, calcule l’excentricité. Cela permet d’emblée
de dire au patient s’il pourra ou non bénéficier du trai-
tement, en fonction de l’excentricité et de l’état de sa
cornée.
Au cours de l’étude présentée, le premier essai, d’une
durée de 30 minutes, a comporté la pose, le contrôle
d’acuité visuelle (certains patients portent la lentille
pour conduire la nuit), l’analyse de l’image fluo et de la
topographie. Le test est positif si le centrage est satis-
faisant, s’il n’existe ni serrage, ni bulle, ni autre ano-
malie. Après cette étape, les patients revenaient le
matin après avoir dormi avec leur équipement, de
façon à vérifier l’absence d’incident nocturne, à
contrôler l’acuité avec et sans lentille, à effectuer une
topographie et un examen en biomicroscopie.
Des résultats encourageants qui ne dispensent pas
d’user de prudence
Selon cette étude, débutée en mars 2003, les patients
sont satisfaits. L’acuité visuelle sans correction
demande en général 12 heures pour se stabiliser et
36 heures pour retrouver sa valeur de départ, une fois
le port de lentilles interrompu. L’aplatissement cor-
néen est maximal dès le 8ejour de port et stable jus-
qu’à 6 mois. Sur de petites myopies, la stabilité de
l’effet réfractif pendant 48 heures permet à certains
patients de ne porter leurs lentilles qu’une nuit sur
deux (il peut s’agir d’une bonne indication pour les
sportifs).
L’évaluation de trois topographes différents au cours
de ce travail a montré que tous les appareils ne sont
pas équivalents. Pour optimiser les résultats, il
convient donc d’utiliser des topographes de dernière
génération, qui disposent d’une grande précision.
Aucun cas de néovaisseaux n’a été déploré dans cette
CDO82 24/04/06 16:09 Page 22

Les Cahiers 23
Contactologie
série. D’autres effets indésirables ont cependant été
observés : des érosions mécaniques, parfois récidi-
vantes (qui obligent à abandonner le traitement), des
kératites ponctuées superficielles, des “
épithelial stai-
ning
” (piqueté central qui disparaît après instillation
de sérum physiologique, souvent lié à une lentille un
peu trop serrée ou dont l’appui est trop proche de la
cornée), des cas d’inconfort nocturne et d’acuité ins-
table ou insuffisante (pour être efficace, la durée du
port nocturne doit être d’au moins 6 à 8 heures). La
position dans laquelle dort le patient peut aussi être
source de déplacement de la lentille et induire des
fluctuations de résultats d’un contrôle à l’autre. Il a
donc fallu questionner les personnes sur leurs habi-
tudes pour trouver la source de certains problèmes.
Les sujets qui ont de grandes pupilles sont gênés par
la présence de halos nocturnes, du fait de l’inadéqua-
tion entre la zone traitée et l’aire pupillaire.
Cette étude confirme les résultats des autres travaux
Au total selon ce travail, on peut modeler la surface
cornéenne des petits myopes de –1 à –4, en limitant
les risques, à condition de surveiller scrupuleusement
l’adaptation des lentilles d’orthokératologie. D’autres
résultats et avis sont malgré tout attendus.
Quels sont les risques ?
À partir d’une revue de la littérature (soit une douzaine
d’études publiées au cours des trois dernières années)
les complications potentielles du traitement ont été
développées au cours de la conférence. Bien que les
différents travaux disponibles ne soient pas stricte-
ment comparables, cette analyse a permis de dégager
certains points.
Quelques chiffres pour caractériser les résultats
C’est ainsi que l’acuité visuelle commence à se modi-
fier dès les dix premières minutes de port pour attein-
dre environ 7 à 8/10 sans correction, alors qu’il faut
attendre une semaine d’utilisation des lentilles pour
obtenir un résultat optimal. L’effet sur l’astigmatisme
et sur la toricité cornéenne est faible. Après le retrait
de la lentille, la stabilité de la réfraction peut varier de
6 à 24 heures. L’acuité moyenne sans correction avoi-
sine alors les 8/10. L’amincissement épithélial varie de
0,12 à 0,19 μm. Toutes les études s’accordent sur la
valeur du changement réfractif moyen de la cornée.
Les auteurs font également part de considérations
plus subjectives, comme la satisfaction des patients,
estimée à 80-90 %, qui ne semblent pas toujours cor-
rélées aux données objectives. En effet, les études
réalisées par les optométristes rapportent quelques
cas de piqueté épithélial et de microkystes, la fré-
quence particulière des anneaux pigmentés de la
moyenne périphérie cornéenne (probable dépôt de fer
situé dans la membrane basale), ou encore la possibi-
Quelques messages
• La motivation des candidats à la CRT doit être
forte et le suivi ophtalmologique très rigoureux.
• La sélection des patients tient compte de
l’excentricité cornéenne qui doit être positive.
Les meilleurs candidats possèdent des cornées
cambrées qui s’aplatissent en pente douce vers
la périphérie, un large diamètre cornéen, et une
myopie inférieure à 4 ou 5 dioptries.
• L’utilisation d’un topographe est indispensable :
il s’agit d’une adaptation sur mesure.
• L’image fluo ne doit pas montrer d’appui central
de la lentille sur la cornée : la pression doit en
effet être exercée par les larmes et non par la
lentille.
• La lentille doit toujours être bien hydratée : une
mauvaise hydratation diminue l’effet mécanique.
• La surveillance clinique sous équipement est
capitale.
• Un ajustage des lentilles après la première
adaptation est parfois nécessaire pour obtenir
un résultat et éviter des complications.
• La prise de risques est corrélée à l’allongement
du temps de port nocturne : celui-ci ne doit pas
dépasser huit à dix heures.
• Plus l’amétropie que l’on souhaite réduire est
importante plus le risque est élevé : il est lié aux
appuis ou au serrage de lentille.
• Il faut savoir s’arrêter : devant notamment un
inconfort nocturne, un serrage (si après deux
changements de paramètres, la lentille persiste
à se ventouser, il faut cesser l’adaptation), ou des
érosions cornéennes récidivantes malgré l’ajuste-
ment des paramètres.
• Attention : à l’heure actuelle certains optomé-
tristes proposent des équipements
via
Internet.
En l’absence de contrôle des pratiques, on
s’expose à des problèmes !
• Devant la persistance de nombreuses inconnues,
il convient de réserver l’orthokératologie à des
patients adultes, de ne pas équiper les enfants et
de ne pas utiliser cette technique avant une
intervention de chirurgie réfractive.
CDO82 24/04/06 16:09 Page 23

Les Cahiers
24
Contactologie
lité d’empreintes annulaires cornéennes (visibles à la
lampe à fente), de secrétions matinales, ou d’une
vision floue de loin. Le degré de contrainte lié aux
manipulations des lentilles varie selon les sujets.
La description des complications provient
de services hospitaliers
Si l’on note d’ores et déjà la fréquence des ulcères
centraux à pyocianiques, on ne peut parler là que des
complications publiées. Celles-ci n’ayant pas été rap-
portées à un nombre de porteurs, on ne connaît donc
pas la pénétrance du risque.
Le service d’ophtalmologie de Hong Kong, qui a eu à
traiter des complications chez des enfants, a diffusé la
mise en garde suivante : “
Au regard du bénéfice tem-
poraire de l’orthokératologie et de la connaissance du
risque accru d’infection associée au port nocturne de
ces lentilles, les parents et les enfants attirés par l’or-
thokératologie doivent être informés et prévenus du
risque potentiel d’une perte de vision définitive. La
communauté ophtalmologique devrait être particuliè-
rement sensibilisée aux complications associées.
”
Il faut cependant savoir qu’en Asie la vente des len-
tilles ne respecte pas toujours les règles de sécurité et
que la perméabilité à l’oxygène des matériaux et la
surveillance clinique y sont insuffisantes. On y traite
de surcroît des enfants dont la myopie peut aller jus-
qu’à –9 et l’astigmatisme jusqu’à 2 dioptries, ce qui
paraît déraisonnable, autant d’éléments susceptibles
de favoriser les accidents. Pour estimer au mieux
l’ampleur du problème, les complications doivent
aussi être rapportées au nombre de porteurs.
Le recul actuel vis-à-vis de la CRT est faible
Si l’on en croît les auteurs optométristes, il semble
que l’efficacité et la sécurité de la CRT à court terme
soient favorables. Cependant : peu de rapprochements
ont été effectués entre les complications et le type des
lentilles utilisées ; seules les faibles myopies peuvent
être traitées ; l’action sur l’astigmatisme est réduite ;
les résultats d’une même étude sont parfois contra-
dictoires.
Les ophtalmologistes se sont peu impliqués dans les
études (pourquoi ?…). Seuls sont publiés les accidents
aigus arrivés à l’hôpital. On peut donc se demander si
le suivi clinique des patients traités par des optomé-
tristes est suffisant. Des études complémentaires
réalisées par des ophtalmologistes seraient peut-être
souhaitables, afin de comparer les complications sous
équipement d’orthokératologie et sous lentilles rigi-
des de géométrie traditionnelle en port continu. Il
s’agirait de confronter la fréquence des accidents et le
type des complications. Il paraît également souhai-
table d’instaurer un contrôle des pratiques.
À suivre…
Si dans l’ensemble les résultats statistiques de la CRT
paraissent pour le moment encourageants sur l’acuité
visuelle, les études qui se sont intéressées aux modi-
fications tissulaires de la cornée sont encore rares.
Certains travaux font état de modifications histolo-
giques et histochimiques des structures cornéennes
qui pourraient bien ne pas être anodines. Ces données
peuvent en partie expliquer la réticence des ophtalmo-
logistes, qui s’interrogent notamment sur les consé-
quences à plus long terme du traitement. En attendant
les résultats d’études complémentaires, dont certai-
nes sont en cours, il serait souhaitable, selon les spé-
cialistes, de faire de l’orthokératologie un acte médical
et de réserver cette méthode à certains patients sélec-
tionnés (armée, sportifs…).
Source : d’après les communications des
Drs G. Sachs, D. Sarfati et M.-N. George, réunion
de la SFOALC, le 10 mai 2004, 110
e
congrès de la
Société française d’ophtalmologie.
Pour en savoir plus
Hiraoka T, Furuya A, Matsumoto Y et al. Quantitative evaluation of
regular and irregular corneal astigmatism in patients having over-
night orthokeratology. J Cataract Refract Surg 2004;30(7):1425-9.
Owens H, Garner LF, Craig JP, Gamble G. Posterior corneal changes
with orthokeratology. Optom Vis Sci 2004;81(6):421-6.
Walline JJ, Rah MJ, Jones LA. The Children’s Overnight
Orthokeratology Investigation (COOKI) pilot study. Optom Vis Sci
2004;81(6):407-13.
Young AL, Leung AT, Cheng LL et al. Orthokeratology lens-related
corneal ulcers in children: a case series. Ophthalmology 2004
Mar;111(3):590-5.
Cheung SW, Cho P. Subjective and objective assessments of the
effect of orthokeratology-a cross sectionnal study. Curr Eye Res
2004;28(2):121-7.
Barbat V. La contactologie à travers la presse. Les Cahiers
d’Ophtalmologie n°64 (nov 2002), n°79 (avr 2004), n°80 (Mai 2004).
Sarfati D. La nouvelle orthokératologie. RéfleXions ophtalmolo-
giques 2003;8 (69).
Poole TR, Frangouli O, Ionides AC. Microbial keratitis following
orthokeratology. Eye 2003;17(3):440-1.
Liang JB, Chou PI, Wu R, Lee YM. Corneal iron ring associated with
orthokeratology. J Cataract Refract Surg 2003;29(3):624-6.
Lau LI, Wu CC, Lee SM, Hsu WM. Pseudomonas corneal ulcer rela-
ted to overnight orthokeratology. Cornea 2003;22(3):262-4.
Rah MJ, Jackson JM, Jones LA et al. Overnight orthokeratology: pre-
liminary results of the lenses and overnight orthokeratology (LOOK)
study. Optom Vis Sci 2002;79(9):598-605.
CDO82 24/04/06 16:09 Page 24
1
/
4
100%