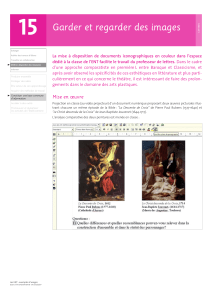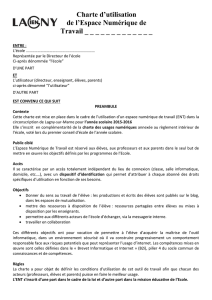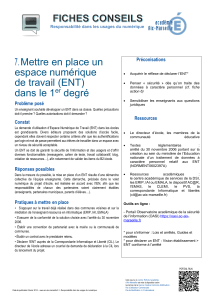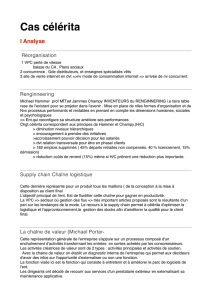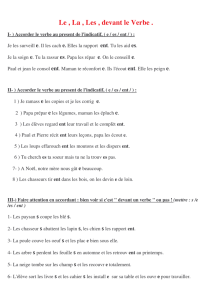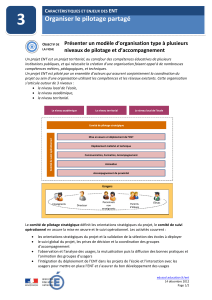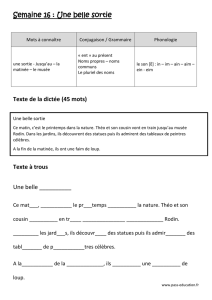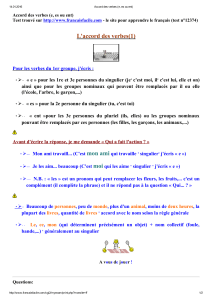une méthode chrétienne de biologie en français

intestins
reins
conduit urinaire
rate
cloaque
estomac
cerveau
moelle épinière
colonne vertébrale
poumons
coeur
ovaires
foie
oes ophage
trachée
muscle du
membre antérieur
os du membre
antérieur
Anatomie d'un reptile - le crocodile
système digestif
système respiratoire
système circulatoire
système reproducteur
système nerveux
système urinaire
C
A
R
A
C
T
É
R
I
S
T
I
Q
U
E
S
D
E
S
R
E
P
T
I
L
E
S
C
H
A
P
I
T
R
E
1
63
INTRODUCTION ET CLASSIF
Le mot «reptile» vient du latin repere qui signifie «ramper». Parmi les 16 ordres de reptiles seuls 5 ont
survécu jusqu’à nos jours. Les squamates (lézards et serpents), les tortues et les crocodiles en repré-
sentent les 4 ordres principaux. Un autre ordre comprend un seul représentant, le tuatara, appelé
aussi sphénodon, qu’on ne trouve que sur de petites îles au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Les
nombreuses espèces éteintes, tel les que les dinosaures, nous sont connues grâce aux fossiles.
La caractéristique commune aux reptiles est une peau sèche recouverte d’écailles. Quant à leur mor-
phologie, c’est la classe de vertébrés qui comprend le plus de variétés.
Classification des reptiles
GroupesExemples
Lézardsprincipalement tétrapodes, à écailles, avec des paupières,
pattes avec griffes, queue fuselée, mue en lambeaux
gecko, caméléon, iguane, orvet
sans pattes, longs et cylindriques, à écailles, sans paupiè-
res, presque sourds, mue en une seule pièce
couleuvre, vipère, cobra, boa
tétrapodes,
avec une carapace, peau rugueuse, mâchoires
sans dents, queue très courte
tortue ma rine, tortue des
Galápagos
tétrapodes, pattes avec griffes, à peau dure et écailleuse, alligator, caïman, crocodile,
gavial
tétrapodes, rares, ressemblant à des lézards, avec des tuatara
G FROID
A l’opposé des mammifères et des oiseaux, les reptiles sont considérés comme des animaux à sang
froid parce que leur température varie avec celle de leur environnement. Il en résulte que la température
de leur corps baisse pendant la nuit et qu’elle augmente le jour. (Notons qu’un animal à sang froid n’a
pas nécessairement le sang froid; la température du c orps d’un lézard peut être aussi élevée, si ce n’est
supérieure, à celle d’un mammifère.)
Parce que la température de leur corps dépend de leur environnement, les animaux à sang froid
doivent éviter les températures extrêmes, trop chaudes ou trop froides.
Les lézards se chauffent au soleil pour
augmenter leur température interne et,
quand celle-ci est trop élevée, ils se rafraî-
chissent à l’ombre.
Les reptiles sont très ré pandus dans les régions
tropicales, mais de nombreuses espèces s’adaptent
auxclimats tempérés. Là où l’hiver est rude, les reptiles
entrent en
hibernation lorsque
les joursraccourcissent et q ue
la températ ure diminue. Durant la saison froide, ils s’en fouissent
dans le sol ou se cachent dans la souche d’un arbre, à l’abri du gel, et mènent une vie ralentie. En
fait, plus basse est la température du corps de l’animal, plus lents sont ses mouvements.
Ainsi, dès le retour des beaux jours, le reptile qui a hiberné sort petit à petit de son
refuge, redevenant actif pour se nourrir et se reproduire.
SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES
La morphologie et l’anatomie des reptiles
Bien que la diversité des reptiles soit très grande quant à leur forme,
leur taille et leur couleur, ils ont plusieurs caractéristiques communes.
Tous sont des vertébrés à sang froid et à peau sèche,dure et recou-
verte d’une couche protectrice d’écailles. Grâce à cette peau, dont la
fonction première est de reten ir l’humidité du corps, beaucoup peuvent
survivre sans eau pendant de longues périodes.
Périodiquement, sa couche superficielle, appelée «épiderme», change : c’e st
la mue. En muant, les lézards perdent des lambeaux de peau alors que chez les
serpents, la couche extérieure se retrousse en une seule pièce. Chez les crocodiles et les
tortues, il n’y a pas de véritable mue, mais une croissance des écailles liée à celle de l’animal.
Tous les reptiles ont une respiration aérienne, même ceux qui vivent dans l’eau. La p
lupart des
espèces comptent 2 poumons, mais presque tous les serpents n’en ont qu’un seul, très allongé.
Bien que la plupart des reptiles aient un cœur à 3 cavités, celui du crocodile en
raison de sa grande taille est constitué de 4 cavités.
C
A
R
A
C
T
É
R
I
S
T
I
Q
U
E
S
D
E
S
R
E
P
T
I
L
E
S
C
H
A
P
I
T
R
E
1
Lézard (Cameroun)
C
a
m
é
l
é
o
n
p
a
n
t
h
è
r
e
Lézard commun
Scinque
87
Un insecte a des pattes art iculées et un exos-
quelette, mais il se différencie des autres arthro-
podes par les particularités suivantes :
•il possède 6 pattes;
•son corps se divise en 3 régionsdistinctes:
la tête, le thorax et l’abdomen ;
•il a 1 seule paire d’antennes.
La plupart des insectes ont également 1 ou 2
paires d’ailes. Si tous les insectes
n’ont pas nécessairem ent
des ailes, tous les in-
vertébrés ailés, eux,
(mouche,
papillon,
coccinelle, etc.)
sont des insectes!
Le cycle de vie des insectes
La plupart des insectes ne vivent pas très longtemps. Généralement,
leur espérance de vie se mesure en mois, en semaines ou p
arfois
même en jours. L’espérance de vie du cafard commun est d’environ
une année et demie, ce qui est relativement long pour un insecte; celle
de certaines a
beilles et fourmis est de plus de 5
ans. Bien que les cigales pu issent vivre plusieurs
années (jusqu’à 17 ans pour la cigale des Etats-
Unis), leur larve doit passer la majeure partie de sa vie sous terre avant de
devenir un insecte parfait!
Chaque insecte commence sa vie dans un œuf. Chez certains insectes
sans ailes, comme le lépisme (appelé aussi «poisson d’argent»), le jeune
qui éclot est une réplique miniature de ses parents. Il grandit simplement
en taille, à chaque fois qu’ il mue, et se développe en un adulte mature
sans changer de forme. Beaucoup d’insectes, toutefois, passent par une
série de changements depuis leur éclosion jusqu’à leur forme adulte. Cette
merveilleuse transformation par laquelle les insectes parviennent à maturité
s’appelle «métamorphose». Elle peut être complète ou incomplète.
Dans le cas de la métamorphose
incomplète, le développement est
progressif. L
’insecte commence sa
vie dans un œuf et éclôt en une
larve qui ressemble à l’a dul te, mais
sans ailes et avec des proportions
de corps différentes. Environ 11 des
25 ordres d’insectes passent par
une m
étamorphose incomplète.
C’es t le cas de certains insectes
communs comme les libellules, les
éphémères, les sauterelles ou les
termites.
Le stade larvaire est celui au cours duquel l’insecte grandit. Son activité
principale est de satisfaire son appétit vorace! Durant la métamorphose
incomplète, la larve mue en changeant plusieurs fo is son exosquelette
devenu trop petit. Le nombre de mues varie selon l’espèce. Les sauterelles
muent au moins 3 fois durant la métamorphose incomplète et, à chaque fois,
la larve ressemble un peu plus à la sauterelle adulte.
Après la mue finale, l’insecte ailé adulte apparaît.
Dans le cas de la métamorphose complète, l’œuf se développe et éclôt en une larve très différente
de l’adulte. Elle est privée d’ailes et d’yeux composés et ressemble souvent à un ver. Certaines sont
appelées : «ver blanc» (scarabée et hanneton), «asticot» (mouche), «ver de vase» (moustique) ou «chenille»
(papillon et mite). Sa croissance impressionnante lui donne un fervent appétit : elle cause souvent de
grands dommages aux arbres et aux récoltes.
En grandissant, la larve subit une série de mues. Ayant atteint sa taille définitive, elle se prépare à la
nymphose en recherchant un endroit favorable. Elle y édifie souvent un abri appelé «cocon», à partir
d’une sécrétion (soie) ou de ma-
tériaux de son environnement.
La nymphe – appelée parfois
«pupe» o
u «
chrysalide» chez
les papillons – ne se n
ourrit
plus et reste généralement
immobile. La phase de nymphe
apparaît comme une phase de
repos, mais le corps de l’insecte
expérimente en fait un miracle
qui l’aura transformé en insecte
adulte (appelé «imago») à la fin
de sa métamorphose.
Les insectes les plus fami-
liers qui passent par la méta-
morphose complète sont les
papillons, les mouches, les
puces, les coléoptères (scara-
bée, coccinelle, etc.), les abeilles
et les fourmis.
Un insecte typique : la sauterelle
La sauterelle est un des insectes les plus communs et sert d’exemple typique à la classe des arthropodes.
Elle a 3 paires de pattes art iculées, un exosquelette composé de chitine et 2 paires d’ail es . Son corps est di-
visé en 3 parties distinctes : la tête, le thorax et l’abdomen. C’est un insecte à métamorphose incomplète.
•La tête
La tête de la sauterelle porte 2 antenn es flexibles qui lui servent à percevoir les odeurs, les contacts et
les courants d’air.
Disposés au milieu de la tête, ses 3 yeux simples détectent la lumière
et les ombres alors que, de chaque côté, ses 2 yeux composés
distinguent les fo rmes, les couleurs et les mouvements.
C
H
A
P
IT
R
E
1
-
A
R
T
H
R
O
P
O
D
E
S
6 pattes corps divisé en 3 parties
1 paire d’antennes
La fourmi est bien un insecte,
mais seules les reines ont des ailes!
M
é
t
a
m
o
r
p
h
o
s
e
d
’
u
n
e
l
i
b
e
l
l
u
l
e
à
4
t
a
c
h
e
s
Mue de libellule
101
La mâchoire du poisson est équipée de dents adaptées à son
type d’alimentation. Sa bouche s’ouvre sur le pharynx. Celui-
ci est séparé de l’ou verture des branchies par une sorte de filtre
constitué de petites ailettes situées sur l’arc branchial.L’a rrière
du pharynx donne sur l’œsophage, tube qui conduit à l’estom ac. Les aliments sont digérés dans
l’estomac, puis dans les intestins; les éléments nutritifs qu’ils contiennent sont absorbés par les parois
intestinales. Les déchets solides ainsi que les matières indigestes sont excrétés au travers de l’anus.
Quant aux déchets liquides présents dans le sang, ils sont filtrés par les reins. Les poissons de mer
boivent énormément, éliminent très peu d’urine mais beaucoup de sel par les reins et les branchies.
Le phénomène inverse se produit chez les poissons d’eau douce, qui ingèrent très peu d’eau propor-
tionnellement à la quantité d’urine qu’ils éliminent.
Le système nerveux
Comparé à d’autres vertébrés, le cerveau des poissons est simple mais il n’en est pas moins merveilleu-
sement conçu. Contrairement aux autres animaux, les poissons sont dotés de 6 sens : la vue, l’ouïe,
l’odorat, le toucher, le goût, ainsi que le sens vibratoire.
La vue est un sens qui est plus développé chez les poissons d’eau claire que chez ceux qui vivent dans
des eaux souterraine s. Les yeux offrent aux poissons un la rge champ de vision et sont très sensibles
aux changements de luminosité. Ils n’ont pas de paupières mobiles, distinguent mal les couleurs et ne
voient pas très loin.
L’odorat et le goût sont bien marqués (plus que chez les chiens). Les poissons perçoivent les odeurs
grâce aux substances chimiques dissoutes dans l’eau. Plusieurs utilisent leur «flair» pour trouver de la
nourriture, se protéger des prédateurs ou retrouver l’endroit
où ils sont nés. Les récepteurs du goût sont principalement
localisés au niveau des lèvres, des barbillons, de la bouche et
parfois même des nageoires.
Le saumon atlantique vit en eau salée mais se reproduit en
eau douce. En période de frai, il entreprend une migration de
plusieurs centaines de kilomètre s en franchissant des chutes.
Grâce à son souvenir olfactif et au champ magnétique terrestre,
il retrouve son lieu de naissance dans les eaux froides des tor-
rents. Après s’être reproduit, il meurt gé néralement, épuisé, sur
son lieu de reproduction.
L’ouïe se fait sa ns oreilles externes et se limite aux sons de
basses fréquences. L’oreille interne est également l’organe de
l’équilibre et de l’orientation.
Le sens du toucher n’es t pas le plus développé chez le pois-
son; il s’associe souvent à l’ouïe pour «toucher à distance». Il est
compensé par le 6e sens contrôlé par la ligne latérale, sorte
de petit sonar qui perçoit les lé- gères vibrations et changements de pression de l’eau
grâce à des terminaisons nerveuses. Cette ligne est
visible chez la plupart des poissons, sur les
écailles, depuis l’op ercule jus-
qu’à la queue. Elle donne
aux poissons une sensibili-
té extraordinaire aux cou-
rants, aux turbulences, à
la pression et
aux ondes de basses fréquences de l’eau. Le système de la
ligne latérale permet aux poissons de détecter l’approche
d’un prédateur, de se diriger vers une proie, d’éviter les
obstacles et de se déplacer en bancs (groupes de pois-
sons vivant ensemble).
Plusieurs poissons sont dotés de sens supplémentaires,
comme celui de perception du champ électrique produit
par le système nerveux d’autres animaux ou la faculté de
se diriger d’ap rès le champ magnétique terrest re, sur de
très longues distances.
Le système reproducteur
Les organes de reproduction d’un poisson sont situés à l’arrière de sa cavité corporelle. Les testicules
du mâle produisent des spermatozoïd es; les ovaires de la femel le un grand nombre d’ovules. Chez
les deux sexes, ces cellules sont libérées au travers de l’orifice urogénital (ouverture urinaire et géni-
tale), localisé un peu à l’arrière de l’anus. La plupart des poissons osseux se reproduisent au moyen de
la fécondation externe – les œu fs sont fécondés à l’extérieur du corps de la femelle.
C
H
A
P
IT
R
E
2
-
A
N
A
T
O
M
I
E
E
T
P
H
Y
SI
O
L
O
GI
E
Mâchoire
d’omble
L
i
g
n
e
l
a
t
é
r
a
l
e
-
s
a
n
d
r
e
L
E
S
S
A
U
T
E
U
R
S
G
R
E
N
O
U
I
L
L
E
S
E
T
C
R
A
P
A
U
D
S
:
C
H
A
P
I
T
R
E
2
LES CARACTÉRISTIQUES
Les particularités et les espèces
Les grenouilles, les rainettes et les crapauds appartiennent à l’ordre
des anoures, d’un mot grec qui signifie «sans queue». En plus de cette
caractéristique, les anoures
adultes sont pourvus de des
membres postérieurs adaptés au
saut. Leur corps est trapu, leur tête
aplatie et leur bouche largement fendue.
Les anoures profitent souvent de l’humidité de la nuit
pour chasser. Ils sont présents un peu partout s ur le globe,
depuis le niveau de la mer jusqu’à une altitude de 4 000 m.
Mais c’est sous les tropiques qu’on e n trouve la plus grande
diversité.
Les
grenouilles ont une peau lisse et peuvent être aquatiques
ou terrestres. Les rainettes sont arboricoles et sont munies
de doigts adhésifs qui leur permettent de grimper aux arbres.
Les crapauds sont recouverts d’une peau rugueuse et
verruqueuse (qui porte des verrues). Ils préfèrent la marche
au saut et vivent plutôt sur la terre ferme. Ils retour nent
dans l’eau pour se reproduire, ce qui occasionne parmi eux
un fort taux de mortalité, au printemps, car les adultes en
déplacement se font écraser par les automobilistes.
La peau et le venin
Certaines petites grenouilles tropicales – appelées dendrobates – arborent
des couleurs magnifiques. Elles ont la réputation de sécréter une substance
toxique utilisée par les tribus indiennes.
Les belles couleurs de cette grenouille d’Amérique du Sud prév ient les éven-
tuels prédateurs de sa toxicité! Les venins sécrétés par certains amphibiens,
en particulier les dendrobates, sont l’objet de recherches médicales. Leur
pouvoir analgésique pourrait être 200 fois plus puissant que la morphine.
Ces grenouilles ne sont pas les seules à
avoir une peau venimeuse. Les glandes
présentes sous la peau de la majorité
des amphibiens sécrètent 2 type s de
substances : soit un mucus (sécrétion
gluante) qui humidifie la peau, soit du venin.
Ces glandes peuvent être visibles, placées derrière l’œil, comme chez
certains crapauds, ou discrètes et réparties sur tout le corps.
C
H
A
P
I
T
R
E
2
G
R
E
N
O
U
I
L
L
E
S
E
T
C
R
A
P
A
U
D
S
:
L
E
S
S
A
U
T
E
U
R
S
Crapaud
R
a
i
n
e
t
t
e
v
e
r
t
e
Dendrobate azure
Dendrobate leucomelas
Grenouille verte
23
LES VERTÉBRÉS : ANIM AUX À SQUELETTE
g Lis cettepartie.
g Ecris letitre «VOCABULAIRE» puis recopie les mots suivants avec leur définition : vertébré,invertébré
et tétrapode (avec son synonyme ).
g Ecris le titre«EXERCICES» puis réponds (par des phras es complètes!) et applique les consignes.
• Quelles sont les troisc aractéristiquesque possèdent tous les vertébrés?
• Cite quatre tétrapo des appartenant chacun à u ne classe différente de ver tébrés.
• Trouve la référence biblique avant de co mpléter la phrase suivante :
Leversetde ..... :«Puisquetuasfaitcela,tuserasmauditentretoutlebétailettousles
animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre…» expliquela raison pour laquelle les
serpents n’ontpas de membres.
Squelette du renard à découper au chapitre 2
G
U
I
D
E
S
E
C
T
I
O
N
1
-
M
A
M
M
I
F
E
R
E
S
-
C
H
A
P
I
T
R
E
1
-
R
È
G
N
E
A
N
I
M
A
L
E
T
C
L
A
S
S
I
F
I
C
A
T
I
O
N
SQUELETTE DU RENARD
49
LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
Un système efficace
Le système respiratoire des oiseaux
est le plus perfectionné et le plu s effi-
cace du règne animal. En plus de leurs
poumons, les oiseaux sont équipés
de sacs aériens qui servent à la venti-
lation des poumons, où s’effectuent
les échanges gazeux. Il faut 2 cycles
d’inspiration et d’expiration pour que
l’air passe dans tout le système et en
ressorte.
Ensemble, les sacs aériens anté-
rieurs et postérieurs jouent le rôle de
soufflets qui maintiennent dans les
poumons une circulation d’air conti-
nue. Il n’y a pas de mélange entre
l’air frais et l’air résiduel et la présen-
ce de valves empêche l’air de revenir
en arrière.
Parce que de l’air frais circule conti-
nuellement à travers leurs poumons,
les oiseaux bénéficient constamment
d’oxygène et peuvent la rejeter en
quantités be aucoup plus import antes
que les animaux terrestres. Les sacs
aériens de certaines espèces se pro-
longent dans les parties creuses des
plus gros os, pour une meilleure ven-
tilation.
Les plumes empêchent les oiseaux de transpirer; ainsi, les sacs aériens servent également à réguler la
température de leur corps.
Le chant
Située à la bifurcation de la trachée et des
2bronches, la syrinx est l’organe des oiseaux
qui remplace nos cordes vocales. Elle contient
une membrane qui vibre sous l’effet de l’air ex-
piré pour produire des sons. La tension mus-
culaire et la différence de pression de l’air dé-
finissent le ton et le volume du son. Certains
oiseaux sont capables de produire des chants
plus complexes grâce au fait qu’ils disposent
d’une membrane dans chaque bronche. Cela
leur permet de produire simultanément 2 no-
tes distinctes et harmonieuses.
Chaque espèce d’oiseaux a un chant spécifique,
mais certaines parviennent à rajouter à leur ré-
pertoire une imitation du chant des autres.
Pourquoi le coq chante-t-il?
Pour dél imiter
son territoire.
Bien qu’il puisse
aussi chanter
tout au long
de la journée,
mais de façon
moins agressive,
c’est le matin au
lever du jour
qu’il est le
plus actif!
1
1
0
0
LES MEMBRES
g «EXERCICE»
• Noms des membres :
membres antérieurs (ousupérieurs) et
membres postérieurs (ou inférieurs). Par exemple : le chien
sedéplaceenmarchantsursesdoigts,c’estundigitigrade.
La marmotte est un
plantigrade, elle mar-
che sur la plante des
pieds.
Le chat est un digiti-
grade, il se déplase
en marchant sur ses
doigts.
p Remarque pour en «Savoir Plus» : parmi les
plantigrades, on trouve la marmotte, le blaireau, le raton-laveur, le singe et en partie l’ours.
En fait, l’ours est digitigrade des pattes avants et plantigrade des pattes arrières. L’homme est
également un plantigrade. Parmi les digitigrades, il y a le chien, le chat et le cochon d’Inde.
Parmi les onguligrades, on trouve la v ache, la chèvre, le cheval, l’éléphant. Le daman est
un plantigrade avec des petits sabots.
g Réponseaudéfi:enfait,ilnes’agitpasdugenou,maisdelacheville.Chezunonguligrade,legenou
est beaucoup plus haut, tout proche de la cuisse.
LES POILS
g «EXERCICE»
• Le pelaged’un animal a deuxprincipales fonctions; ilsert à lui tenir chaud et à le protéger
de ses prédateurs.
g «OBSERVATIONS»
•La fouine, la belette et l’hermine sont toutes trois des mustélidés avec du blanc sur le ventre.
Mais la fouine est plus grande (50 cm sans la queue) et produit parfois des ravages nocturnes.
La belette est la plus petite (17 cm). L’hermine (27 cm) devient blanche en hiver, sauf le bout
de sa queue qui reste toujours noir!
LA RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
g«VOCABULAIRE»
•animal à sang chaud : animal qui régule sa températureau moyen de mécanismes internes
•animal à sang froid :animalquirégulesatempératureaumoyendefacteursextérieurs(sa
température varie en fonction de son environnement)
•hibernation* : abaissement permanentde la température pendant l’hiver chez des animaux à
température constante.
C
O
R
R
I
G
É
S
E
C
T
I
O
N
1
-
M
A
M
M
I
F
E
R
E
S
-
C
H
A
P
I
T
R
E
2
-
C
A
R
A
C
T
É
R
I
S
T
I
Q
U
E
S
D
E
S
M
A
M
M
I
F
È
R
E
S
Nom, p rénom : ....................................................................................... Note : .......................................
Date : ........................................................................................................ Pts : ........................... / 40 pts
Biologie 7e TEST n°2 : Les mammifères (2ème partie)
1. Complète le texte suivant :
Quand le . . . . . . . . . . . . . . . et les muscles qui soulèvent les côtes se contractent, le volume de la cage
thoracique . . . . . . . . . . . . . . . et l’air riche en . . . . . . . . . . . . . . . (de formule chimique . . . . . . . . )
entre dans les poumons : c’est l’ . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand les muscles précédents se relâchent, les poumons, comprimés sous le poids de la cage thoracique
rejettent l’air riche en . . . . . . . . . . . . . . . (de formule chimique . . . . . . . . ) :
c’est l’ . . . . . . . . . . . . . . . .
/ 8
2. A l’aide des mots donnés, complète le schéma suivant :
accouplement, fécondation, fœtus, femelle, gestation, mâle, nais sance, nouvel être, ovule, petit,
spermatozoïde, testicule
Remarque : Les quatre étiquettes de gauche concernent les étapes nécessaires à la transmission de la
vie.
/ 12
Z
O
O
L
O
G
I
E
-
T
E
S
T
1
-
M
A
M
M
I
F
E
R
E
S
-
S
E
C
T
I
O
N
1
1
UNE MÉTHODE CHRÉTIENNE
DE BIOLOGIE EN FRANÇAIS !
Zoologie a été créée pour enseigner et faire découvrir aux élèves les ri-
chesses de la création des 5e et 6e jours. Cette méthode, bien organisée et
richement documentée, suscite la soif d’apprendre et favorise la recherche
personnelle. De plus, elle valorise la créativité : au terme de son étude, l’élève
possédera un dossier personnalisé, réalisé de manière progressive grâce aux
documents suivants :
• un manuel, riche en informations et en illustrations
Six sujets y sont traités : les mammifères, les oiseaux, les
reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés.
Bien structuré, cet ouvrage regroupe des connaissances
d’ordre général et de nombreux détails passionnants.
• un guide, qui conduit pas à pas l’élève dans son étude
L’élève progresse dans son apprentissage grâce à des ac-
tivités multiples et variées.
• un corrigé, qui facilite le travail de l’élève (pour une mé-
thode individualisée) ou celui de l’enseignant (pour un
enseignement magistral)
Les informations importantes à savoir y sont indiquées
de façon claire et complète.
• un set de tests et de corrigés des tests
Les notions essentielles que l’élève aura relevées dans
son dossier sont évaluées de façon objective en utilisant
divers niveaux taxonomiques.
Ce qu’en pensent deux élèves :
«J’ai beaucoup apprécié la méthode de zoologie. Elle est riche et vivante : on doit
réfl échir, se poser des questions, faire des recherches, etc. Elle nous fait voir com-
bien la nature est belle et parfaite.» Carline
«Avec cette méthode, j’ai eu du plaisir à étudier les différents groupes d’ani-
maux (mammifères, oiseaux, invertébrés, ...). J’ai pu voir la grande diversité des
espèces, de l’éléphant au ver de
terre. Les textes étaient faciles à
comprendre, le travail à effectuer
varié.» Siméon
Si vous voulez en savoir plus, contactez :
Association Alliance Pierres Vivantes
Place de la Gare
CH-1678 SIVIRIEZ
Tél. : +41 (0)26 656 18 18
Fax : +41 (0)26 656 18 19
E-mail : info@apv.org
Site Web : www.apv.org
Exemples de présentation
En projet : Botanique – la même
méthode de biologie, mais qui traite
des végétaux
1
/
1
100%