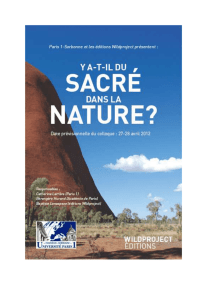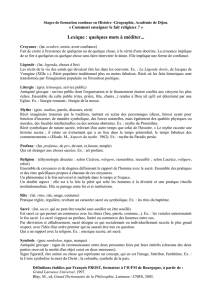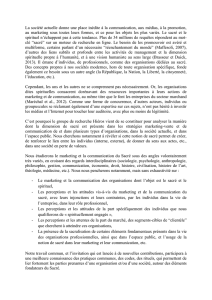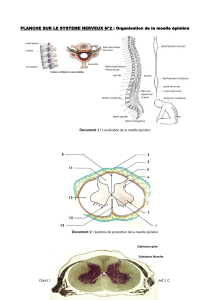BELLONE ou La pente de la guerre



BELLONE
ou
la pente de la guerre


Roger CAILLOIS
BELLONE
ou
La pente de la guerre
Nouvelle préface de Yves-Jean Harder
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%