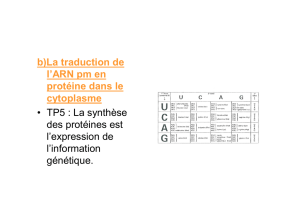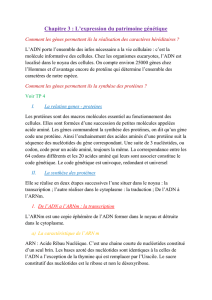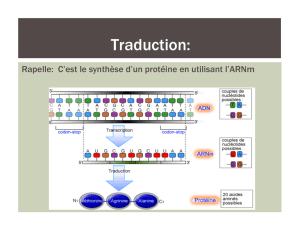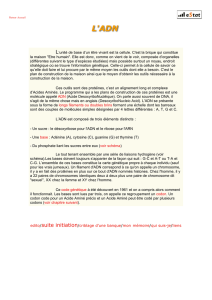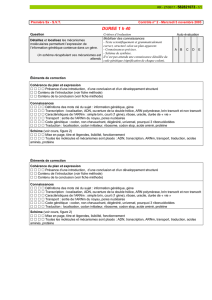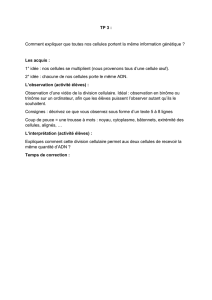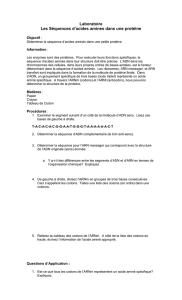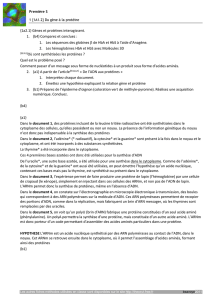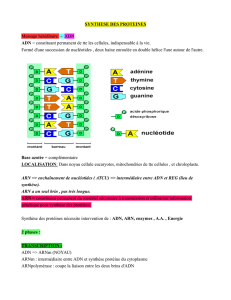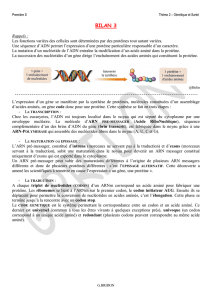3 Les protéines : expression du génotype et conséquences

Première S 21/46
Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59
3 Les protéines : expression du génotype et
conséquences phénotypiques
3.1 Rappels sur la molécule d’ADN
L’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) est le support de l’information
génétique. Il est constitué par condensation de nucléotides : assemblage
d’une base azotée, d’un sucre (désoxyribose), et d’un phosphate. C’est un
acide nucléique.
La modification de la molécule d’ADN (mutation) peut modifier le
phénotype.
[49.1]L’expérience de Beadle et Tatum montre qu’une mutation n’a de
conséquence que sur une seule enzyme. L’altération de l’ADN est
localisée, et seul le segment codant pour cette enzyme est modifié : un
gène code pour une enzyme (ex. saccharase des levures) ou plus
généralement une protéine. [Cependant, plusieurs gènes sont souvent
nécessaires pour l’établissement d’un caractère (ex. arg+).]
3.2 L’ARNm, intermédiaire entre ADN et protéine
[53.2bc]La synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme. Elle ne
nécessite pas la présence directe d’ADN (qui reste dans le noyau). Des
acides nucléiques, les ARNm (messager), sont mis en évidence dans le
cytoplasme de cellules énucléées. Ils ont un poids moléculaire très
inférieur à celui de l’ADN. Ils sont constitués de nucléotides construits avec
les mêmes bases azotées que l’ADN, sauf pour la thymine, remplacée par
l’uracile.
[52.2a]La synthèse d’ARNm a lieu dans le noyau.
Plusieurs brins sont fabriqués simultanément à partir d’une portion d’ADN
(correspondant à un gène).
[59.3A]La synthèse de chaque brin fait intervenir une enzyme (ARN
polymérase). Les bases s’apparient comme dans l’ADN : AU, TA, GC et
CG.
[54.1bc]La synthèse n’utilise qu’un seul des 2 brins de l’ADN (brin transcrit ou
non codant). Le brin inutilisé est appelé brin codant car il porte la même
séquence de nucléotides que l’ARNm (T/U)
La synthèse d’un ARNm correspondant à un gène est ponctuelle. La durée
de vie de l’ARNm dans le cytoplasme est de quelques heures.
L’ARNm est exporté vers le cytoplasme à travers des pores au niveau de
la membrane nucléaire.
La fabrication d’un ARNm à partir d’une séquence d’ADN est la
transcription.
Comment passer d’un langage à 4 nucléotides à un langage à 20 acides
aminés ?

Première S 22/46
Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59
3.3 De l’acide nucléique à la protéine
Les ARNm sont capables de déclencher la fabrication, en présence de
tous les organites du cytoplasme, de protéines. Il faut une suite de 3
nucléotides (codon) pour pouvoir coder 20 acides aminés (43 = 64
combinaisons).
[55.2a]La correspondance entre codon et acide aminé est donnée par un
tableau de correspondance : le code génétique. Plusieurs codons codent
pour le même acide aminé : le code génétique est dit dégénéré
(redondant).
Toutes les protéines commencent par l’acide aminé méthionine, qui
correspond au codon TAC sur le brin transcrit (AUG sur l’ARNm) : c’est le
codon initiateur, qui oriente la lecture du message. Certains codons ne
codent pour aucun acide aminé : ces codons STOP arrêtent la traduction
de l’ARNm.
La correspondance entre codon et acide aminé se fait dans le cytoplasme,
grâce à 2 autres types d’acides nucléiques : l’ARNr (ribosomal) et l’ARNt
(de transfert).
[55.3a]Deux ARNr différents s’associent à des protéines pour former un
ribosome.
[53.2b]Les ribosomes sont soit libres dans le cytoplasme, soit fixés sur le
réticulum endoplasmique granuleux.
Le ribosome permet la lecture de l’ARNm, et sa mise en relation avec les
ARNt. Chaque ARNt est capable de fixer d’un côté un acide aminé, et
comporte de l’autre côté un anticodon. Le déplacement progressif du
ribosome construit au fur et à mesure la protéine, en établissant des
liaisons peptidiques. Aucun ARNt ne correspond aux codons STOP, ce qui
arrête l’élongation de la protéine, et la libère dans le cytoplasme.
La fabrication d’une protéine à partir d’une séquence d’un ARNm est la
traduction.
La correspondance entre codon et acide aminé est commune à toutes les
espèces vivantes : le code génétique est universel (à de rares exceptions)
3.4 Relations entre génotype et phénotype
Un gène code pour une protéine. Différentes versions d’un gène existent :
ce sont les allèles. Chaque allèle code pour une protéine légèrement
différente, à l’origine d’un phénotype alternatif. Y a-t-il toujours une relation
directe entre un allèle et un phénotype alternatif ?
3.4.1 Un allèle détermine un phénotype
Des techniques de découpage de l’ADN, par des enzymes de restriction,
permettent d’établir une relation entre des allèles différents et des
phénotypes alternatifs.
Dans le cas de la drépanocytose, il existe 2 allèles (A = sauvage, S =
drépanocytaire). Un seul gène commande directement la fabrication de la
protéine finale :

Première S 23/46
Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59
Le phénotype alternatif [S] n’existe que lorsque l’individu est homozygote
(présence de 2 allèles S > HbS), il est donc récessif.
3.4.2 Plusieurs gènes déterminent un phénotype
Lorsque le phénotype dépend du produit d’une suite de réactions
enzymatiques, plusieurs gènes interviennent dans sa réalisation. La
mutation (apparition d’allèles nouveaux) de l’un ou l’autre de ces gènes
peut aboutir au même phénotype alternatif :
(cas des levures) :
Cas des groupes sanguins : le groupe O peut être obtenu par deux
enzymes non fonctionnelles (h ou O).
3.4.3 Interactions entre phénotypes
Dans le cas groupes sanguins, la codominance des allèles A et B crée un
phénotype supplémentaire [AB] aux échelles de la cellule et de l’individu.
Des phénotypes différents peuvent également se combiner pour donner un
phénotype intermédiaire (Scarlett + Brun rouge brique) : c’est la
dominance incomplète (lorsqu’un gène seul est concerné).
3.5 Bilan
1
/
3
100%