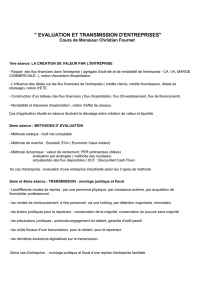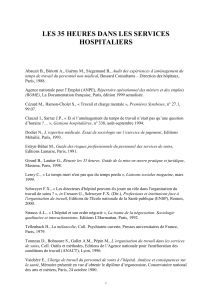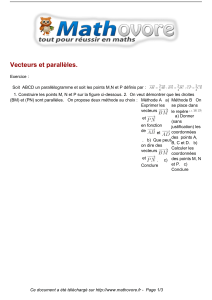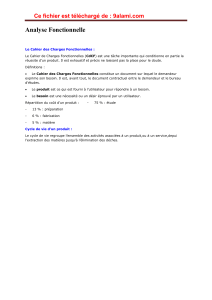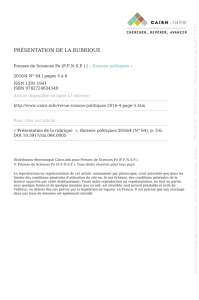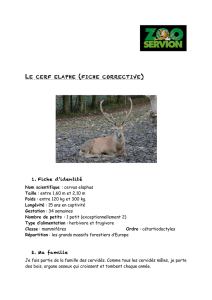le néolibéralisme, modèle économique dominant

LE NÉOLIBÉRALISME, MODÈLE ÉCONOMIQUE DOMINANT
Hugues Puel
Editions du Cerf | Revue d'éthique et de théologie morale
2005/1 - n°233
pages 29 à 51
ISSN 1266-0078
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-2005-1-page-29.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puel Hugues, « Le néolibéralisme, modèle économique dominant »,
Revue d'éthique et de théologie morale, 2005/1 n°233, p. 29-51. DOI : 10.3917/retm.233.0029
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Editions du Cerf.
© Editions du Cerf. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf

29
LE NÉOLIBÉRALISME
REVUE D’ÉTHIQUE ET DE THÉOLOGIE MORALE N 233 MARS 2005 P. 29-51
Hugues Puel, o.p.
LE NÉOLIBÉRALISME,
MODÈLE ÉCONOMIQUE
DOMINANT
INTRODUCTION
La désignation du modèle économique dominant comme
néolibéral est très répandue, mais elle mérite discussion. Le
libéralisme est d’abord une philosophie politique qui est à
l’origine de la démocratie et des droits de l’homme. D’où la
difficulté pour la tradition catholique qui a géré le problème de
façon plutôt tortueuse, tant cette Église a été liée au cours de
longs siècles à la légitimation de pouvoirs monarchiques et
autoritaires. Mais on vise ici le modèle économique dont le
contenu se caractérise par une confiance dans le marché comme
régulateur global (capitalisme anglo-saxon, versus économie
sociale de marché ou modèle rhénan). Le catholicisme est, par
tradition, favorable à une régulation forte par l’État avec une
large place faite aux services publics, un rôle important donné
aux politiques économiques et l’affirmation de responsabilités
collectives face aux problèmes sociaux.
Plus récemment, la place extravagante prise par la finance dans
notre modèle économique de capitalisme en incessantes trans-
formations change les données du problème et interroge les
comportements des entreprises et des États. La tradition catholi-
que a toujours eu une attitude critique face à l’argent et se trouve
en opposition face à ce néolibéralisme qui est surtout un
capitalisme financier. Pourtant les ressources et les virtualités de
l’économie de marché ne doivent pas être sous-estimées, tandis
que les rapports entre le socialisme et le libéralisme se nouent
entre eux de façon beaucoup plus complexe qu’on ne le dit
souvent. Mais si l’Église catholique a mené les discernements
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf

30
REVUE D’ÉTHIQUE ET DE THÉOLOGIE MORALE No 233
nécessaires sur l’économie de marché et donc sur le libéralisme
économique, la réflexion est beaucoup plus hésitante sur le
libéralisme politique.
Le mouvement altermondialiste désigne le système écono-
mique et politique qui domine aujourd’hui la planète comme
néolibéral. Ce langage est équivoque, car il ne distingue pas
clairement entre un libéralisme politique et un libéralisme
économique. Il faudra préciser les ambivalences du terme libé-
ralisme, analyser les évolutions du libéralisme économique,
éclairer les critiques faites au néolibéralisme présent, revenir sur
les critiques d’ordre politique et d’ordre moral faites à l’économie
de marché, pour enfin mettre à jour les insuffisances actuelles
de la pensée sociale catholique.
LES AMBIVALENCES DU TERME
DE LIBÉRALISME
Définitions
Dans un livre récent qui n’a pas eu toute l’audience qu’il
méritait, Monique Canto-Sperber et Nadia Urbinati montrent la
complexité de la tradition libérale, en donnant consistance à une
expression qui choque les oreilles françaises, mais qui prend sens
si on tient compte des perspectives européennes et américaines :
le socialisme libéral¹. Dans notre pays, le socialisme est
étroitement associé au marxisme. Le socialisme libéral serait
donc un oxymore, une contradiction conceptuelle, tandis que
sur le plan historique le socialisme réellement existant serait la
négation même de la liberté, du fait d’une dérive soi-disant
nécessaire vers le totalitarisme. Or le socialisme libéral est une
expression qui se défend tant sur le plan des idées que des faits
et a le mérite de mettre en forte évidence le contenu politique
du libéralisme lui-même.
L’ambition du socialisme libéral, écrit Monique Canto-Sperber,
n’est pas seulement d’intégrer le marché dans le socialisme ou de
montrer que les droits sociaux sont compatibles avec la liberté
économique. Elle est de revenir au libéralisme comme philosophie
1. M. CANTO-SPERBER et N. URBINATI, Le Socialisme libéral : une anthologie Europe
États-Unis, Paris, Éditions Esprit, 2003.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf

31
LE NÉOLIBÉRALISME
politique et méthode d’émancipation, et de montrer qu’il fonde
dès le XIX siècle une orientation forte du socialisme².
Le mot « libéralisme » apparaît en 1818 avec Maine de Biran
qui le définit comme « doctrine favorable au développement
des libertés ». L’année suivante, l’Oxford English Dictionary lui
donne le même sens. Le libéralisme désigne d’abord la liberté
politique et la liberté de conscience. Ces libertés s’affirment
avec la séparation de l’Église et de l’État, le refus de l’autocratie
et de l’inégalité des droits (notamment le suffrage censitaire et
le suffrage masculin), la limitation constitutionnelle du pouvoir
avec l’État de droit.
Le terme libéralisme est ambivalent : libéral veut dire de
gauche aux États-Unis car cette doctrine induit la nécessité de
lois sociales pour protéger les populations pauvres et étendre
leurs droits et leurs libertés. Le libéralisme économique n’est pas
moins ambivalent, car deux courants qui se réclament du
libéralisme politique ont des conceptions économiques diffé-
rentes. Dans la lignée de Locke (1632-1704) et, au XX siècle,
de Friedrich Hayek et de Robert Nozick, on y plaide pour un
État minimum. Dans la filiation de Jérémie Bentham (1748-1832),
de John Stuart Mill (1806-1873) et de John Rawls (1921-2002),
on y fait la théorie de la social-démocratie. Au début des années
1970, John Rawls a relancé la réflexion sur la justice, dans le
cadre d’une philosophie politique libérale, en prônant un prin-
cipe de différence qui justifie l’intervention redistributive de l’État
et l’introduction de mesures de discrimination positive en faveur
de populations en difficulté.
Dans son ouvrage classique, L’Ère des tyrannies, Élie Halévy
souligne que « le socialisme depuis sa naissance, au début du
XIX siècle, souffre d’une contradiction interne : héritier de la
révolution de 1789, il se présente à la fois comme un mouvement
pour la liberté et comme une réaction contre l’individualisme
et le libéralisme³ ». Cette dualité est antérieure au marxisme.
Donc le débat entre libéralisme et anti-libéralisme est interne au
socialisme. Comme l’écrit encore Monique Canto-Sperber : « Le
socialisme libéral est la continuation et l’accomplissement du
2. M. CANTO-SPERBER, op. cit., p. 8.
3. E. HALÉVY, L’Ère des tyrannies (1938), Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 213.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf

32
REVUE D’ÉTHIQUE ET DE THÉOLOGIE MORALE No 233
libéralisme. Il achève un processus d’émancipation qui s’inscrit
dans une histoire de la liberté⁴ ».
Sur le plan historique, il y a des socialismes non marxistes
qui ont promu la liberté politique, même s’il est vrai qu’en
Russie les bolcheviks l’ont emporté sur les mencheviks, événe-
ment qui a marqué soixante-dix ans de l’histoire dans ce pays
et brouillé l’image du socialisme au-delà de ses frontières. Le
parti socialiste allemand a abandonné la référence au marxisme
lors de son Congrès de Bad Godesberg en 1959 et les partis
sociaux-démocrates européens, notamment en Scandinavie, ont
pratiqué le libéralisme politique depuis les premières décennies
du XX siècle. Le parti socialiste français a, quant à lui, été
beaucoup plus contradictoire et surtout extrêmement confus dans
sa référence au marxisme.
En bref, le libéralisme politique s’oppose aux aspects anti-
sociaux de certaines formes de libéralisme économique, tandis
que le socialisme peut désigner soit l’extension de la démocratie
au domaine social, soit la dérive totalitaire. Cela invite à
considérer les politiques concrètes plutôt que les formules
idéologiques.
Évolution du libéralisme économique
Contre John Locke, théoricien de la propriété individuelle, le
philosophe libéral John Stuart Mill reconnaît le caractère en
partie social et conventionnel de la propriété et dissocie le
libéralisme des formes radicales du laisser-faire économique. En
ce sens, les partisans actuels du socialisme libéral peuvent se
réclamer de lui. Mais le libéralisme économique des théoriciens
de l’économie, au XIX siècle et au début du XX siècle, met
l’accent sur le caractère sacré du droit de propriété individuel
et sur l’ordre économique réalisé par le marché, de façon
automatique et sans aucune intervention de la volonté humaine,
par le jeu de la loi de l’offre et de la demande. La confrontation
de l’offre et de la demande n’était pas vue comme une loi sociale,
mais comme une vraie loi physique fonctionnant à l’état pur, sans
prise en compte des contingences et des particularités de la
société. La preuve en était que les crises et les dysfonctionne-
ments de l’économie étaient supposés provenir des interventions
4. M. CANTO-SPERBER, op. cit., p. 28.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université Paris-Descartes - Paris 5 - - 193.51.85.60 - 27/04/2013 16h50. © Editions du Cerf
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%