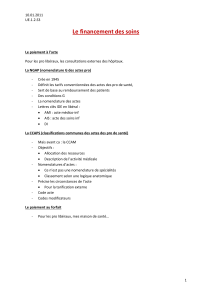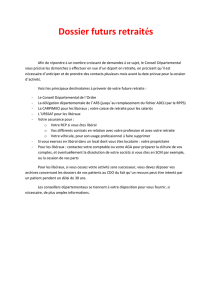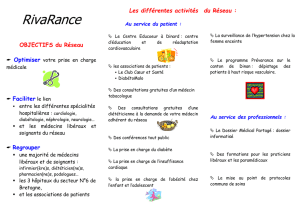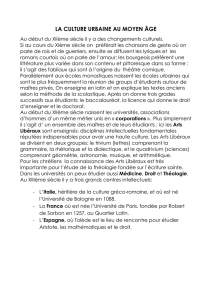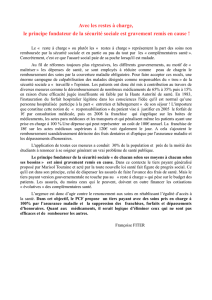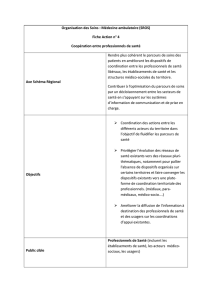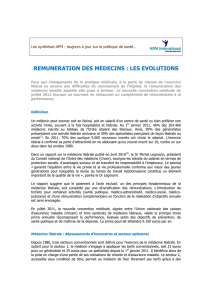ENA: Rapport sur la rémunération des médecins libéraux

Direction de la formation
Promotion 2008-2010
« Émile ZOLA »
« Option d’approfondissement »
Groupe n° 13
LA REMUNERATION DES MEDECINS LIBERAUX
4 élèves
Février 2010
Exemplaire personnel de : M.

Lettre de mission
Les médecins libéraux, généralistes et spécialistes, représentent 60% des médecins français.
Au nombre de 115 000, ils sont en France essentiellement payés à l’acte, ce qui a notamment
pour conséquence de les inciter à maintenir une activité soutenue. Leur rémunération est une des
variables clés de régulation de notre système de santé.
Le paiement à l’acte est l’un des principes fondateurs de la médecine libérale. Il n’a pas été
remis en cause par la socialisation des dépenses de santé en 1945, faisant des médecins une
catégorie singulière de libéraux rémunérés en grande partie sur fonds publics. Si ce système a
participé au développement d’une médecine accessible à tous et sans délai d’attente, il soulève
néanmoins un certain nombre de difficultés.
Depuis le début des années 1970, l’impératif croissant de maîtrise des dépenses de santé a
conduit les pouvoirs publics à chercher à limiter l’effet inflationniste du paiement à l’acte et à
encadrer l’activité des médecins : définition de tarifs opposables, références médicales
opposables ou non, et, depuis 2005, augmentation de tarifs conditionnée à une modération des
prescriptions.
Plus récemment, de nouveaux modes de rémunération ont été introduits dans l’objectif d’une
meilleure prise en compte des enjeux de santé publique : création de forfaits pour le suivi des
patients en affection longue durée et pour la permanence des soins, introduction du paiement à la
performance avec la mise en oeuvre du contrat d’amélioration des pratiques individuelles
(CAPI), expérimentation de nouveaux modes de rémunération ouverte par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008. Ces innovations ont fait avancer l’idée selon laquelle le
paiement à l’acte n’est plus le mode de rémunération incontournable et exclusif de la médecine
de ville.
Toutefois des difficultés demeurent. L’effet inflationniste du paiement à l’acte n’est pas
maîtrisé et des dépassements d’honoraires mettent en cause l’égal accès aux soins. Par ailleurs, la
survalorisation de certains actes entraîne de fortes disparités de revenus entre professionnels,
tandis que les activités de santé publique sont insuffisamment rémunérées. Enfin, favorisant un
exercice isolé de la médecine qui a perdu de son attractivité auprès des jeunes générations, ce
mode de rémunération semble devoir évoluer pour accompagner les réorganisations en cours de
notre système de santé.

Dans le contexte de la négociation de la prochaine convention médicale, le Gouvernement
s’interroge sur l’opportunité et les moyens de poursuivre une réforme de la rémunération des
médecins libéraux.
La diversité des situations, notamment entre médecins généralistes et spécialistes, la
complexité des dispositifs de rémunération et leur impact sur l’organisation du système de soins,
imposent de réaliser un état des lieux préalable afin d’analyser, à la lumière de comparaisons
internationales, les caractéristiques, avantages et limites du système de rémunération français.
Vous déterminerez ensuite, au regard des enjeux auxquels est confronté notre système de
santé et compte tenu des récentes modifications intervenues, les priorités à assigner à une
réforme. Vous présenterez différents scénarios en précisant leur impact financier et les mesures
de nature à favoriser leur acceptabilité. Vous veillerez à distinguer les améliorations qui peuvent
être apportées au système actuel de rémunération, d’une part, de propositions visant à
accompagner et favoriser une réorganisation de notre système de santé, d’autre part.
Votre rapport devra être rendu le 5 février 2010.
Fait à Paris - le 15 janvier 2010
Vu, le 15 janvier 2010 Vu, le 15 janvier 2010
Signée
SYNTHESE
L’activité libérale constitue l’une des deux formes d’exercice de la médecine en France et la
forme principale de l’exercice ambulatoire. Le mode de rémunération qui lui est associé est le
paiement à l’acte, qui lie le revenu du médecin au nombre d’actes pratiqués. Le tarif des actes
médicaux est fixé par une négociation entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et
les représentants des médecins. Le paiement à l’acte se distingue du salariat, qui s’applique en
France aux praticiens hospitaliers, et de la capitation, qui prévoit une rémunération en fonction
du nombre de patients suivis.
Les médecins libéraux figurent parmi les professions les mieux rémunérées en France. Il
existe toutefois des disparités importantes entre médecins généralistes et spécialistes, mais aussi
entre spécialités. Si certains écarts sont justifiés par des critères objectifs, d’autres traduisent des
dysfonctionnements. En outre, les médecins généralistes français ont une rémunération

inférieure à celle de leurs homologues étrangers, pour un temps de travail plus élevé.
Le mode de paiement français incite à accroître le nombre d’actes pratiqués et à privilégier
les plus rémunérateurs. Dans le même temps, des dépassements d’honoraires croissants nuisent
à l’accès aux soins. Notre système de rémunération favorise par ailleurs une pratique isolée de la
médecine, orientée vers les activités curatives, qui répond mal aux attentes des professionnels et
aux besoins médicaux liés aux évolutions démographiques et épidémiologiques. Enfin, coûteux
pour la collectivité, il n’est pas pour autant gage d’une qualité optimale.
Pour autant, l’analyse économique montre qu’aucune modalité de rémunération n’est à elle
seule parfaitement satisfaisante. Le paiement à l’acte, qui a pour principal atout dans le contexte
de baisse de la démographie médicale, de maintenir une productivité importante des médecins
doit rester le fondement de notre système. Mais il doit être complété par d’autres modes de
rémunération afin de favoriser l’adaptation de la médecine ambulatoire aux nouveaux enjeux de
notre système de santé.
Malgré les difficultés des négociations conventionnelles, le contexte est favorable à une
réforme. L’évolution des aspirations des médecins l’encourage, comme les récentes innovations
législatives - réorganisation de la gouvernance régionale, définition des missions du médecin de
premier recours, possibilité d’expérimenter de nouveaux modes de rémunération. La situation
des comptes sociaux rend d’autant plus nécessaire la réforme d’un système dont l’efficience est
discutée.
Le rapport envisage, en conséquence, deux voies d’amélioration du système de rémunération
des médecins libéraux.
La première consiste à orienter la politique tarifaire vers la réduction des distorsions dans
l’offre et l’accès aux soins. Il s’agit d’améliorer le fonctionnement actuel du paiement à l’acte,
notamment pour les spécialités techniques auxquelles il est bien adapté. La mission propose de
confier à un comité indépendant, hors des négociations conventionnelles, le soin de fixer et
d’actualiser la valeur des différents actes, en fonction de leur spécificité et selon des critères
objectifs. Cette option doit être préférée aux mesures de plafonnement ou à celles liant le tarif et
le volume des actes telles qu’elles existent parfois à l’étranger (recommandations 1 à 5). La
mission suggère d’introduire des mécanismes de régulation des dépassements. La création d’un
nouveau secteur de conventionnement dit optionnel visant à encadrer la liberté tarifaire,
constitue une piste d’avenir mais devant les risques qu’elle emporte, il en est proposé une mise
en œuvre expérimentale et limitée. Un encadrement régional des dépassements d’honoraires
pourrait, dans le même temps, être mis en œuvre (recommandations 6 à 8).
La seconde voie consiste à engager une diversification des modes de rémunération. Cet
ensemble de recommandations participe de la revalorisation de la médecine de premier recours
engagée par la loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux
Territoires (HPST). La mission propose d’introduire des rémunérations forfaitaires pour
encourager la coordination et la coopération entre professionnels de santé et améliorer la prise
en charge des malades atteints de pathologies chroniques (recommandations 9 à 13). Il est
également suggéré de développer le paiement à la performance afin d’associer les médecins à la
satisfaction d’objectifs de santé publique et à la réalisation d’activités de prévention. Enfin, les
modalités de rémunération doivent évoluer de façon à assurer une meilleure répartition de la
médecine de premier recours sur le territoire (recommandations 14 à 17).
* *

*
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
1
/
46
100%