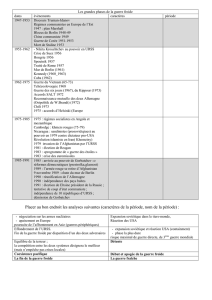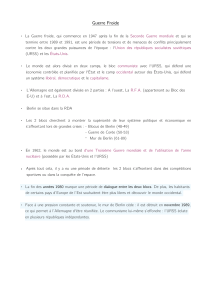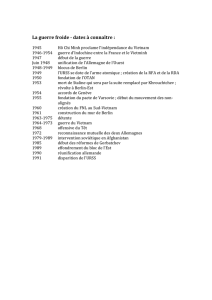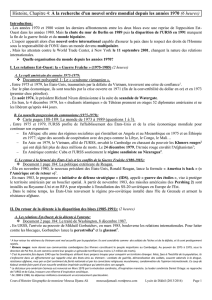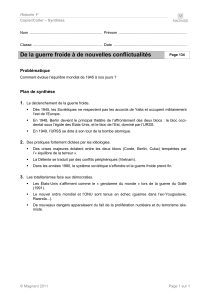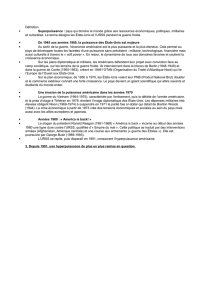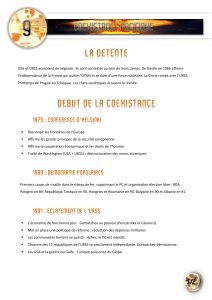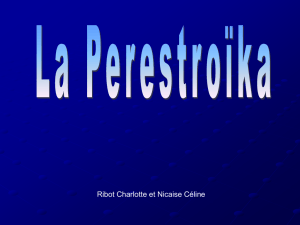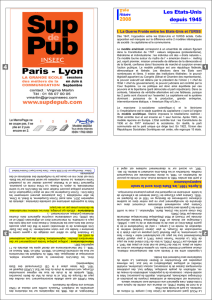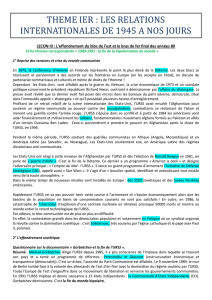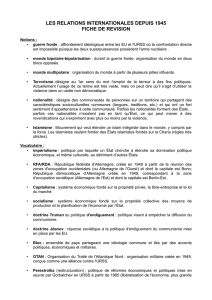Chap 06-Regain tensions à fin guerre froide _1975-1991

1
Chapitre VI
DU REGAIN DES TENSIONS A LA
FIN DE LA GUERRE FROIDE
(1975-1991)
I. LA GUERRE FRAICHE (1975-1985)
Pourquoi les relations Est-Ouest connaissent-elles un regain de
tension ?
A. L'expansionnisme soviétique
1. Une influence grandissante dans le Tiers-Monde
Pour l'URSS, la détente n'a jamais signifié renoncement à
l'expansion. À partir de 1975, profitant de l'affaiblissement de
l'Occident consécutif au choc pétrolier et à l'échec américain au
Vietnam, elle étend son influence dans le Tiers-Monde. Leonid
Brejnev fait appel aux troupes de Cuba pour soutenir les régimes
pro-soviétiques qui s'installent en Éthiopie (1974) et dans les
anciennes colonies portugaises, le Mozambique et l'Angola
(1975). En Amérique latine, elle apporte son appui aux guérillas
marxistes au Salvador et au Guatemala et contribue à la victoire
des sandinistes au Nicaragua en 1979. En Asie, les communistes
triomphent en 1975 avec la réunification du Vietnam sous l'égide
du Nord, l'installation des Khmers rouges au Cambodge et du
Pathet Lao au Laos.
2. L'invasion de l'Afghanistan
En 1979, afin de venir au secours du régime communiste
de Kaboul, installé l'année précédente, l'Armée rouge pénètre en
Afghanistan. À la volonté de soutenir un régime ami s'ajoute la
crainte de voir la rébellion islamique gagner les républiques
musulmanes soviétiques. Les États-Unis dénoncent un arc de
crise, qui, du Mozambique à l'Afghanistan, en passant par
l'Éthiopie et le Yémen du Sud, viserait à couper l'Occident de ses
approvisionnements pétroliers du golfe Persique.
B. Les États-Unis, du repli à l'offensive
1. L'ère des «bons sentiments» (1975-1979)
Au milieu des années 1970, l'idée que les systèmes
américain et soviétique sont en train de se rapprocher est
courante aux États-Unis. Pour Henry Kissinger, conseiller à la
Maison-Blanche, l'URSS changera d'elle-même si l'on développe
avec elle des liens commerciaux. De plus, le démocrate Jimmy
Carter, qui accède à la présidence en 1976, entend redonner aux
États-Unis la légitimité morale qu'ils semblent avoir perdue avec
la guerre du Vietnam et la crise du Watergate. Se faisant le
défenseur du respect des droits de l'homme, il réduit les aides aux
dictatures anticommunistes d'Amérique latine, les affaiblissant face
aux guérillas marxistes.
2. «America is back» (1980-1985)
L'invasion de l'Afghanistan modifie l'attitude de J.
Carter. Sa réaction est ferme : embargo sur les ventes de céréales,
boycott en 1980 des jeux Olympiques de Moscou. En 1980, son
successeur, le républicain Ronald Reagan, lance contre l'URSS,
qu'il désigne comme 1'«Empire du Mal», une véritable croisade.
C'est la « guerre fraîche». L'Afrique du Sud, qui pratique le
système de l'apartheid, mais soutient la résistance antisoviétique en
Angola, redevient un allié privilégié. Au Nicaragua, les contras
antisandinistes reçoivent armes et subsides. En 1983, les
Américains occupent l'île de Grenade, dont le régime est jugé
menaçant.
B. La reprise de la course aux
armements
1. Les États-Unis rattrapent leur retard
Dans les années 1970, l'URSS a dépassé les États-Unis
dans le domaine des armes conventionnelles (chars, avions, etc.) et
des armes stratégiques (missiles intercontinentaux). Après
l'invasion de l'Afghanistan, les États-Unis décident de rattraper leur
retard. Ils ne ratifient pas le traité SALT II, signé en 1979. À
partir de 1983, l'URSS refusant de retirer les missiles SS2O qu'elle
a installés en Europe de l'Est, l'OTAN déploie à l'ouest des fusées
Pershing II.
2. L'initiative de défense stratégique
En 1983, Ronald Reagan lance une Initiative de défense
stratégique (IDS), surnommée « guerre des étoiles », car le projet
vise à abattre les missiles par le biais de rayons lasers diffusés par
satellites. En dotant les États-Unis d'un bouclier anti-nucléaire, le
projet romprait avec le principe de la destruction mutuelle
assurée, qui a garanti l'équilibre de la terreur. Les Soviétiques
s'inquiètent, étant incapables de suivre leur rivale dans la course
technologique aux armements.
II. LA FIN DE LA GUERRE FROIDE
(1985-1991)
Comment l’évolution en URSS conduit-elle à la fin de la guerre
froide ?
A. Les bouleversements en URSS
1. Perestroïka et glasnost
Mikhaïl Gorbatchev, nommé secrétaire général du
PCUS en 1985, veut rénover le système soviétique. La priorité
accordée aux industries d'armement nuit au développement des
industries de consommation et aux investissements dans le secteur
éducatif. La population manifeste son mécontentement par une
résistance passive (absentéisme, faible productivité) qui entrave la
bonne marche des entreprises. M. Gorbatchev lance un appel à la
restructuration (perestroïka) et demande plus de transparence
(glasnost) dans l'information et les décisions.
2. La politique de désarmement
Pour rénover le système soviétique, M. Gorbatchev a
besoin d'une pause dans la course aux armements et d'une aide
financière de l'Occident. Dès 1985, il entame un véritable tour du
monde des capitales occidentales où il est très populaire. En 1987,
il accepte un plan de suppression des euromissiles (traité de
Washington). Dans les années suivantes, deux autres accords sont
signés : le traité de Paris sur la réduction des forces
conventionnelles en Europe (1990) et le traité START 1 (1991).
B. Le repli soviétique
1. La fin de la coupure de l'Europe en deux
En 1988, Gorbatchev annonce le retrait des troupes
soviétiques stationnées en Europe de l'Est. Cette décision et la
politique de réformes lancée en URSS permettent la chute des
régimes communistes. Au printemps 1989, la Hongrie ouvre sa
frontière avec l'Autriche. De nombreux Allemands de l'Est
empruntent cette brèche dans le rideau de fer pour se rendre en
RFA. Les autorités est-allemandes, débordées, décident finalement

2
d'ouvrir leur propre frontière : le 9 novembre 1989, le mur de
Berlin tombe. Le chancelier ouest-allemand, H. Kohl, propose
aussitôt un plan de réunification. Le 12 septembre 1990, le traité
« 2+4 » réunifie l'Allemagne. En 1991, la dissolution du pacte de
Varsovie consacre la fin du bloc de l'Est.
2. Le retrait soviétique du Tiers-Monde
L'URSS se désengage des régions du Tiers-Monde où elle
avait apporté son appui à des régimes se réclamant du marxisme.
Des accords de paix sont signés sous l'égide de 1'ONU, qui peut
jouer son rôle de médiateur depuis la fin de la confrontation entre
les deux Grands. Entre 1988 et 1990, ces accords débouchent sur le
retrait de l'URSS et de ses alliés d'Afghanistan, du Nicaragua et
du Salvador, d'Ethiopie et d'Angola (en échange, l'Afrique du
Sud reconnaît l'indépendance de la Namibie).
C. L'effondrement de l'URSS
1. De I'URSS à la CEI
Les réformes économiques désorganisent la production.
La tenue d'élections libres en mars 1989 réveille les oppositions et
les nationalismes ; des incidents éclatent en Asie centrale en 1986 ;
au printemps 1990, les pays Baltes proclament leur
indépendance. Pour empêcher le démembrement de l'URSS, les
conservateurs communistes tentent un coup d'Etat le 18 août
1991. Le nouveau président de la République de Russie, Boris
Eltsine, qui reprochait à M. Gorbatchev sa timidité dans les
réformes, prend la tête de la résistance. Le putsch échoue. Le 24
août, M. Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire
général du PCUS; le 29, les activités du parti communiste sont
suspendues. En décembre, l'URSS disparaît, remplacée par la
CEI, à laquelle adhérent 11 des 15 anciennes républiques d'URSS.
2. Le reflux du monde communiste
La disparition de l'URSS et de ses satellites d'Europe de
l'Est marque le reflux des régimes communistes. Ne subsistent que
Cuba, la Corée du Nord, le Vietnam et la Chine. Cette dernière,
engagée dans la voie de la libéralisation économique au début des
années 1980, refuse « la cinquième modernisation : la démocratie ».
En 1989, le «printemps de Pékin» est durement réprimé (massacre
de Tienanmen). La fin de la guerre froide ne signifie pas la victoire
de la démocratie libérale.
III. LES LIMITES DE L’ORDRE
BIPOLAIRE (1975-1991)
Quels sont les conflits qui échappent à la logique Est-Ouest ?
A. Divergences et luttes à l'intérieur des
blocs
1. La concurrence entre les États-Unis et leurs alliés
La crise rend plus intense la compétition économique
entre les pays du bloc occidental. Pour protéger leurs
approvisionnements pétroliers, les États de la CEE et le Japon se
rapprochent des pays arabes. Après l'invasion de l'Afghanistan, les
Européens profitent de l'embargo américain pour accroître leurs
échanges commerciaux avec l'URSS. Ils tentent de promouvoir
leur propre diplomatie.
2. La troisième guerre d'Indochine
Après le triomphe des communistes au Vietnam, au
Cambodge et au Laos en 1975, la péninsule indochinoise devient
l'enjeu de la rivalité sino-soviétique. En 1977, le Vietnam, allié de
l'URSS, établit sa tutelle sur le Laos. En 1978, les troupes
vietnamiennes envahissent le Cambodge où les Khmers rouges,
soutenus par la Chine, ont perpétré un génocide. La Chine réplique
en lançant une attaque contre le Vietnam. La fin de la guerre
froide permet cependant l'ouverture de négociations qui
aboutissent en 1991 à un accord de paix.
B. La radicalisation du conflit israélo-
palestinien
1. Des accords de Camp David à l'intifada
La guerre de 1973 entre Israël et ses voisins marque un
renversement partiel des alliances au Proche-Orient. Le
président égyptien Anouar al-Sadate se rapproche des États-Unis.
À leur instigation, en 1978, il s'engage à signer avec le Premier
ministre israélien Menahem Begin un traité par lequel l'Égypte
reconnaît l'État hébreu en échange du retrait d'Israël du Sinaï.
Mais Sadate, accusé d'avoir trahi la cause arabe, est assassiné par
des islamistes. Israël continue d'implanter des colonies dans les
territoires palestiniens. En 1987, les jeunes Palestiniens
déclenchent l’Intifada. En novembre 1988, Y. Arafat reconnaît
le droit à l'existence d'Israël mais proclame un État indépendant
en Palestine. Il veut éviter que l'OLP ne soit débordée par des
mouvements extrémistes - le Hamas et le Jihad islamique - dont
l'influence grandit.
2. La guerre au Liban
L'afflux de réfugiés palestiniens crée des tensions
croissantes dans ce pays où cohabitent dans un équilibre fragile
des communautés chrétiennes et musulmanes. En avril 1975, la
guerre civile éclate. Elle oppose des milices que séparent
antagonismes religieux et prises de position rivales dans le conflit
israélo-palestinien. Les armées Syrienne et israélienne
interviennent. En 1982, pour tenter de stopper les raids lancés par
l'OLP depuis ses bases libanaises, Israël lance l'opération «paix en
Galilée» qui contraint Yasser Arafat à quitter le pays. Mais elle
laisse les milices chrétiennes perpétrer des massacres dans les
camps palestiniens de Sabra et Chatila.
C. La montée de l'islamisme
1. La révolution Iranienne et la guerre Iran-Irak
En 1979, la dictature du chah d'Iran est renversée.
L'ayatollah Khomeyni instaure une république islamiste, qui
dénonce tant l'impérialisme américain que le communisme athée et
met en application la charia. Les Américains perdent ainsi un appui
important. Bien plus, ils subissent un lourd affront en novembre
1979: le personnel de l'ambassade américaine de Téhéran est
pris en otage. La guerre que l'Irak déclenche en envahissant l'Iran
en 1980 permet de contenir la poussée islamiste, mais déstabilise la
région.
2. Une menace dont l'Occident ne prend pas la
mesure
Les États-Unis ne mesurent pas le renforcement de
l'islamisme. À Beyrouth, en 1983, des mouvements islamistes
libanais, financés par l'Iran, font exploser des camions suicides sur
les quartiers généraux américains et français de la force
multinationale stationnée au Liban. Dans le conflit afghan, les
États-Unis arment les moudjahidin qui résistent à l'Armée rouge. En
1986, le scandale de I'Irangate révèle que l'administration Reagan
a fourni des armes à l'Iran, en dépit de l'embargo officiel. Le
« nouveau désordre mondial » s'amorce.
1
/
2
100%