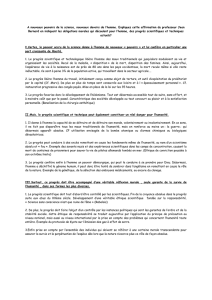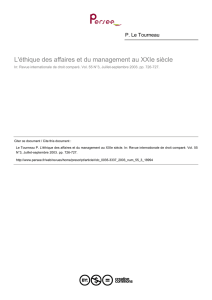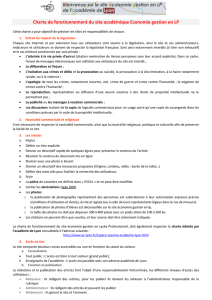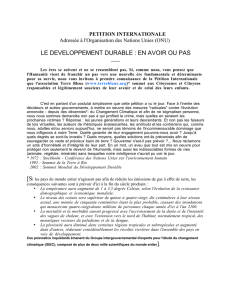Article Reference - Archive ouverte UNIGE

Article
Reference
Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l'humanité :
de l'intervention pour cause d'humanité à l'intervention pour violation
des lois de l'humanité
GARIBIAN, Sévane
Abstract
L’étude des débats et textes postérieurs à la Grande Guerre permet de mettre en lumière les
innovations majeures qui découlent de la conceptualisation du crime contre l’humanité, dans
le cadre du génocide des Arméniens : l’expression de la nécessité, puis de la volonté, de
sanctionner pénalement des atrocités commises par un gouvernement, à l’encontre d’une
partie de sa population civile en dehors du contexte de conflit armé international ; la
reconnaissance du principe de la responsabilité pénale individuelle des dirigeants ; ainsi que
la tentative, avortée, de concrétiser l’idée d’une ingérence judiciaire dans les affaires
intérieures d’un Etat tiers pour la défense des droits fondamentaux de la personne humaine.
Les lendemains de la Première Guerre mondiale préparent la définition juridique et la mise en
œuvre ultérieures du concept de crime contre l’humanité, qui adviendront une vingtaine
d’années plus tard. Ils préfigurent aussi très nettement – dans la lignée des débats théoriques
suscités, dès le XIXe siècle, par la pratique de l’intervention pour cause [...]
GARIBIAN, Sévane. Génocide arménien et conceptualisation du crime contre l'humanité : de
l'intervention pour cause d'humanité à l'intervention pour violation des lois de l'humanité. Revue
d'Histoire de la Shoah, 2003, no. 177 - 178, p. 274-294
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23567
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
1 / 1

1
Génocide arménien et conceptualisation
du crime contre l’humanité.
De l’intervention pour cause d’humanité
à l’intervention pour violation des lois de l’humanité
∗
∗∗
∗
Sévane GARIBIAN
Il est d’usage de situer la naissance du concept de crime contre l’humanité en 1945,
dans le cadre des procès du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI) chargé de
poursuivre les grands criminels de guerre nazis. Mais cet évènement correspond en réalité à
l’élaboration de la première définition juridique du concept
1
. En revanche, le « crime contre
l'humanité » apparaît bien plus tôt dans une Déclaration alliée du 24 mai 1915, avant d’être
utilisé sous la dénomination de « crime contre les lois de l’humanité » au lendemain de la
Première Guerre mondiale, lors de la Conférence de la Paix de Paris de 1919. Dans les deux
cas, on qualifie de la sorte les massacres et déportations perpétrés par la Turquie à l’encontre
de la population ottomane arménienne. Ce concept désigne dès lors une catégorie de
crimes dont la particularité est double : ils sont commis par un État envers une partie de sa
propre population civile et sont considérés comme suffisamment graves pour susciter
l’intervention d’États tiers dans un domaine qui relève pourtant de la compétence interne de
l’État mis en cause. En ce sens, le crime contre l’humanité se distingue du crime de guerre,
acte commis par un État à l’encontre de ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un conflit
armé international.
S’il existe un lien direct entre le génocide des Arméniens et l’émergence du concept de
crime contre l’humanité, la référence à « l’humanité » et/ou aux « lois de l’humanité » dans le
contexte particulier des relations entre États souverains n’est, en 1915, pas nouvelle. La
notion d’« humanité », tout d’abord, justifie l’intervention des Puissances européennes dans
les affaires intérieures de l’Empire ottoman dès le XIX
e
siècle, suite à l’émergence de la
∗
∗∗
∗
Article publié in Revue d’Histoire de la Shoah, n° 177-178, 2003, pp. 274-294. L’auteur tient à remercier
chaleureusement Madame Claire Mouradian et Mademoiselle Séverine Devaux pour leur relecture attentive de
ce texte et leurs précieuses observations.
1
Le crime contre l’humanité est défini à l’article 6c du Statut du TMI (annexé à l’Accord de Londres du 8 août
1945) en ces termes : « Les crimes contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en
esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant
la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou
persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été
commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ». Pour une
étude du concept de crime contre l’humanité à Nuremberg, on renverra à S. GARIBIAN, « Souveraineté et
légalité en droit pénal international : le concept de crime contre l’humanité dans le discours des juges à
Nuremberg », in M. HENZELIN et R. ROTH dir., Le droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Paris,
Genève, Bruxelles, LGDJ, Georg, Bruylant, mai 2002, pp. 29-45.

2
Question d’Orient
2
. Tant les acteurs que la doctrine classique du droit international d’avant-
guerre, désignent cette ingérence politico-diplomatique dans les relations qu’entretient un État
avec une partie de ses citoyens, par le terme générique d’intervention pour cause d’humanité
3
.
Cette notion est dès lors entendue au sens d’intervention en faveur de minorités opprimées par
leur propre Etat, sans aucun lien de nationalité entre les victimes et l’Etat intervenant
4
.
Les « lois de l’humanité », ensuite, justifient à la même époque l’existence d’un
supposé droit d’intervention d’humanité selon les auteurs positivistes classiques dits
interventionnistes. Ceux-ci estiment en effet que le droit d’intervention en question est issu
d’un corps de normes de droit positif supérieures tant aux droits internes qu’au droit
international, s’imposant à tous les États. Les normes supérieures dont il s’agit ne sont pas
clairement définies et suscitent des appellations diverses et confuses telle que, notamment,
celle de « lois de l’humanité »
5
. Par ailleurs, les États se réfèrent à cette même notion dans la
Convention de Saint-Petersbourg du 11 décembre 1868 destinée à interdire l’utilisation des
projectiles explosifs et incendiaires
6
, mais l’on considère généralement que ces « lois »
deviennent du droit positif international suite à l’adoption des Conventions de La Haye de
1899 et 1907
7
.
2
Sur la Question d’Orient qui domine la diplomatie européenne au XIX
e
siècle, voir l’article de Claire
MOURADIAN dans ce même volume. On en date traditionnellement le début au traité de Kutchuk-Kaïnardji du
21 juillet 1774 qui met fin à la guerre russo-turque et amorce le processus de démembrement de l’Empire
ottoman (cf. Y. TERNON, Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement, Paris, Editions du Félin, 2002, pp.
82sq). Notons que l’article 7 du traité de Kutchuk-Kaïnardji prévoit un droit d’intervention des Russes pour la
défense des fidèles orthodoxes, dont les Grecs et les Bulgares. Mais le caractère à proprement parlé humanitaire
des interventions européennes transparaît pour la première fois dans le préambule du Traité de Londres du 6
juillet 1827, qui légitime l’action de l’Angleterre, de la France et de la Russie contre la domination turque en
Grèce (texte reproduit dans G. F. de MARTENS, Nouveau Recueil de Traités, Gottingue, Librairie de Dieterich,
1830, tome VII, pp. 465-466). Ce caractère humanitaire sera ensuite réaffirmé à chaque intervention des
puissances européennes dans l’Empire ottoman, tout au long du XIX
e
siècle.
3
Sur ce sujet, voir V. DADRIAN, « L’origine et l’application du concept d’intervention d’humanité. Les
enseignements tirés du génocide arménien », Les Cahiers de l’Orient, n° 57, mars 2000, pp. 22sq.
4
L’intervention pour cause d’humanité est à dissocier de l’ingérence au nom de la stricte protection des
orthodoxes, telle que prévue par le Traité de Kutchuk-Kaïnardji susmentionné, ainsi que du protectorat de la
France sur les catholiques (sujets ou « protégés » de la France) issu des Capitulations renégociées en 1740 (cf. C.
MOURADIAN, « Les chrétiens à Jérusalem, un enjeu pour les Puissances », in C. NICAULT dir., Jérusalem,
1850-1948. Des Ottomans aux Anglais : entre coexistence spirituelle et déchirure politique, Paris, Autrement,
1999, pp. 177-204). Par ailleurs, les doctrines moderne et contemporaine du droit international distingueront plus
tard intervention pour cause d’humanité et intervention humanitaire, la seconde supposant un « soutien
logistique et militaire pour assurer la sécurité de convois ou d’aide humanitaire organisée (en général) par des
ONG ou des organisations internationales (lesquelles feront alors de l’assistance humanitaire) » (E. SPIRY,
« Interventions humanitaires et interventions d’humanité : la pratique française face au droit international »,
Revue générale de droit international public, 1998, pp. 408-409).
5
On trouve aussi, dans un certain nombre d’écrits de la fin du XIXe et du début du XX
e
siècles, les notions
connexes de « droits de l’humanité », « droits humains », « droit commun de l’humanité », « droits individuels
reconnus comme nécessaires à l’humanité » ou encore « droits fondamentaux humains ». Pour plus de détails sur
ce point, voir B. WEIL-SIERPINSKI, L'intervention d'humanité : un concept en mutation, Thèse de doctorat en
Droit, Montpellier I, 1995, pp. 69sq.
6
Il s’agit de la première référence expresse aux « lois de l’humanité » dans un texte juridique international (cf.
les alinéas 6 et 11 de la Convention : C. SAMWER et J. HOPF, Nouveau Recueil général de Traités, Gottingue,
Librairie de Dieterich, 1873, série I, tome XVIII, pp. 444-45).
7
Cf. Infra.

3
L’innovation majeure apportée par la Déclaration de mai 1915 est l’utilisation du
terme « crime ». Aussi le nouveau concept est-il en lui-même porteur d’une volonté de
sanctionner pénalement des atteintes commises par un État à l’encontre de ses propres
ressortissants indépendamment d'une situation de guerre ; en l’occurrence les massacres des
Arméniens par la Turquie (I). Pourtant, s’il permet d’attribuer à l’intervention politico-
diplomatique pour cause d’humanité une nouvelle dimension, judiciaire cette fois, le concept
verra, au lendemain de la Grande guerre, sa mise en œuvre effective vouée à l’échec (II).
I. Naissance du concept de crime contre l’humanité dans le cadre du
génocide des Arméniens
Peu après la première Conférence de Paix de La Haye visant la prévention des
calamités de la guerre
8
, et parallèlement au processus de codification du droit international
humanitaire (ou, plus généralement, du droit des conflits armés internationaux), les
interventions européennes pour cause d’humanité reprennent dans l’Empire ottoman entre
1903 et 1908. Le contrôle du concert européen se raffermit en Macédoine
9
, touchant toutes les
branches de l’administration ottomane, ce qui a pour effet d'accélérer le mouvement
nationaliste et libéral Jeune-Turc (Ittihad ve Terraki ou Comité Union et Progrès).
C’est dans un contexte de forte confusion et de tension politique accrue en Turquie
que débutent les massacres des Arméniens d’Adana en 1909
10
, prélude à l’apparition du
concept de crime contre l’humanité une première fois en 1915, puis à nouveau lors de la
Conférence de Paris en 1919.
1. Le « crime contre l’humanité et la civilisation » dans la Déclaration alliée de
1915 : expression d’une nécessité de sanctionner pénalement
Alors que la Première Guerre mondiale mobilise tous les esprits, le gouvernement
Jeune-Turc réalise son plan de « turquification » radicale de l’Empire ottoman, en organisant
les déportations et exterminations systématiques des Arméniens de Turquie
11
. Un mois après
8
Rappelons que cette Conférence de Paix, initiée par S. M. Nicolas II, donne lieu à trois Conventions datées du
29 juillet 1899, portant respectivement sur le règlement pacifique des conflits internationaux (Convention I), les
lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention II) et l’adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève de 1864 sur le traitement des militaires blessés (Convention III). Elle sera suivie par une
seconde Conférence de Paix à La Haye, inaugurée le 15 juin 1907 dans le but de donner un développement
nouveau aux principes humanitaires ayant servi de base à l’œuvre de la Conférence de 1899.
9
Province replacée sous la domination turque par le Traité de Berlin du 13 juillet 1878. Sur les événements dans
cette région, cf. notamment Dotation Carnegie pour la Paix internationale, Enquête dans les Balkans. Rapport
présenté aux Directeurs de la Dotation par les membres de la Commission d’Enquête, Paris, Georges Crès et
Cie, 1914.
10
Cf. par exemple : le numéro spécial de la Revue d’histoire arménienne contemporaine, tome III, 1999 ; C.
MOURADIAN, L’Arménie, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? n° 851, 2002 (3
e
éd.), pp. 50sq ; Y. TERNON,
Empire ottoman…, Op. cit., pp. 231sq. Les massacres d’Adana rappellent ceux commis sous le règne du Sultan
Habdul Hamid II, entre 1894 et 1895 (voir infra, note 16), sorte de « répétition générale » du génocide de 1915 »
(C. MOURADIAN, Idem, p. 49).
11
Le plan d’extermination des Arméniens fera plus d’un million de morts. Il sera par ailleurs accompagné de
massacres de centaines de milliers de Grecs, Libanais et Assyro-Chaldéens. A ce sujet, citons notamment V.
DADRIAN, Histoire du génocide arménien (trad. Marc Nichanian), Paris, Stock, 1996 ; V. DADRIAN, Warrant

4
le début de ce qui sera plus tard qualifié de génocide, la France, la Grande-Bretagne et la
Russie lancent un avertissement dans une Déclaration conjointe du 24 mai 1915. Leur
condamnation est claire :
« En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la
civilisation, les Gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime
Porte qu’ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous les
membres du Gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se
trouveraient impliqués dans de pareils massacres »
12
Cette Déclaration appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, il s’agit de la première
apparition du concept de crime contre l’humanité. Ensuite, l’utilisation du mot « crime »
traduit tant la reconnaissance d’une responsabilité que d’une nécessité de sanctionner
pénalement. Or si la France, la Grande-Bretagne et la Russie affirment expressément la
responsabilité individuelle de dirigeants d’État (en l’espèce les chefs des autorités ottomanes),
c’est-à-dire contrecarrent le principe classique d’immunité des chefs d’État et des agents
diplomatiques, ils ne prévoient pour autant aucune sanction. La condamnation, bien que
politique
13
, n’en demeure pas moins déterminante dans la mesure où des actes de dirigeants
visant leurs propres ressortissants, indépendamment du contexte de guerre, sont qualifiés de
« crimes contre l’humanité et la civilisation » et, de ce fait, considérés comme nécessairement
punissables.
Par ailleurs, le nouveau concept constitue une incrimination sans infraction puisque si
crime il y a, le texte de loi transgressé n’est pas identifié pour autant. En effet, les actes en
question constituent un irrespect non pas d’un ou plusieurs textes juridiques, mais de
for Genocide. Key Elements of Turko-Armenian Conflict, New Brunswick & London, Transaction Publishers,
1999; R. HOVANNISIAN, The Armenian Genocide. History, Politics, Ethics, London, St Martin Press, 1992 ;
Y. TERNON, Les Arméniens, histoire d’un génocide, Paris, Le Seuil, 1977 ; G. CHALIAND et Y. TERNON, Le
Génocide des Arméniens, Bruxelles, Complexe, 1980. Pour une bibliographie d'approche, voir Infra, ainsi que
CDCA, L'actualité du génocide des Arméniens, Paris, Edipol, 1999, pp. 489 sq. Pour une synthèse commode des
travaux historiques, voir Bulletin de l'Assemblé nationale, Rapport n° 925 fait au nom de la Commission des
affaires étrangères sur la proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien.
12
La Déclaration intégrale, telle qu’elle a été remise au gouvernement ottoman, est la suivante (Note du
ministère français des Affaires étrangères à l’Agence Havas, 24 mai 1915 : Archives du ministère des Affaires
étrangères, Guerre 1914-1918, Turquie, tome 887, folio 127 ; texte reproduit dans A. BEYLERIAN, Les
Grandes Puissances, l’Empire ottoman et les Arméniens dans les archives françaises (1914-1918), Paris,
Publications de la Sorbonne, 1983, p. 29) :
« Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l’Arménie procède, de connivence et souvent avec
l’aide des autorités ottomanes, à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril
(nouveau style) à Erzéroum, Dertchan, Eguine, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeitoun et dans toute la Cilicie ; les
habitants d’une centaine de villages aux environs de Van ont été tous massacrés ; dans la ville même, le quartier
arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le Gouvernement ottoman sévit contre la
population arménienne inoffensive.
En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les Gouvernements alliés
font savoir publiquement à la Sublime Porte qu’ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous
les membres du Gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de
pareils massacres » (c’est nous qui soulignons).
13
Lorsque le ministre des Affaires étrangères britannique, Sir Edward Grey, décide de se joindre à ses collègues
français et russe, il précise que la menace de punir les dirigeants des autorités ottomanes n’est qu’une
« continuation de la politique menée au XIXe siècle contre les atrocités turques », in V. DADRIAN, Histoire du
génocide arménien, Op. cit., p. 643.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%