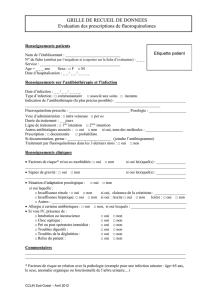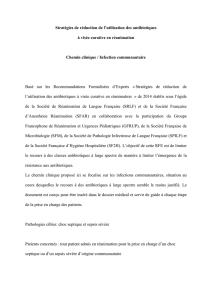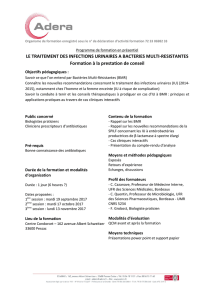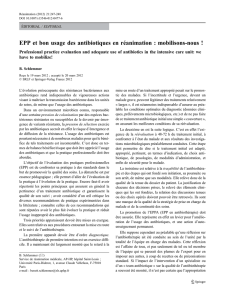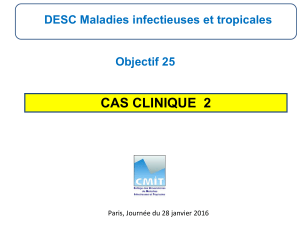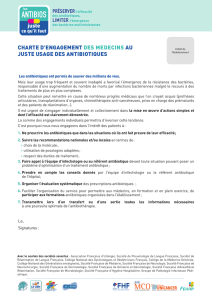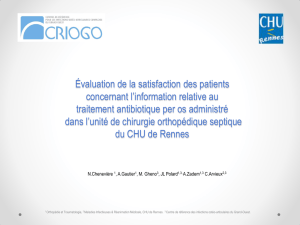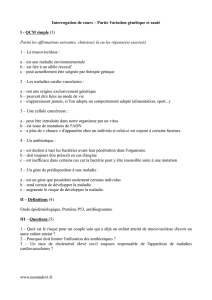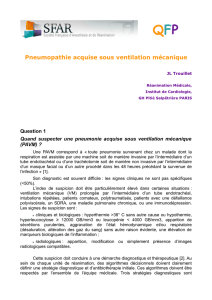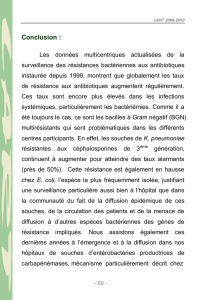ANTIBIOTHéRAPIE DES éTATS SEPTIQUES GRAVES

AntibiothérApie des étAts
septiques grAves
Benoît Ragonnet, Clément Brun, Julien Textoris, Marc Leone
Service d’anesthésie et de réanimation, Hôpital Nord, Assistance Pu-
blique - Hôpitaux de Marseille, Aix Marseille Université, 13915 Marseille
Cedex, France. E-mail : [email protected]
INTRODUCTION
La prescription d’une antibiothérapie probabiliste est définie comme
l’initiation d’un traitement antibiotique en présence d’une infection prouvée ou
suspectée avant l’identification microbiologique, c’est-à-dire avant que le ou les
micro-organismes responsables de l’infection ne soient identifiés.
En prenant en considération tous les éléments disponibles, elle doit cor-
respondre au traitement admis pour être efficace dans la situation en cause.
L’adéquation de l’antibiothérapie probabiliste initiale vis-à-vis du ou des germes
responsables de l’infection a démontré son impact sur l’amélioration du pronostic
vital des patients en sepsis grave, notamment en cas de bactériémies, de
péritonites et de pneumopathies. Le défi consiste ainsi à prescrire un traitement
approprié sans aucune documentation microbiologique.
1. PRINCIPES
Tout retard à l’initiation d’une antibiothérapie appropriée chez les patients
en sepsis grave est associé à une mortalité accrue [1-3]. Ainsi, les patients chez
lesquels il existe une suspicion d’infection associée à une défaillance d’organe
doivent recevoir une antibiothérapie probabiliste. De même, un tel traitement est
justifié dans certains cas de suspicion d’infections graves, comme les méningites
ou dans des populations spécifiques de patients. Le délai d’administration des
antibiotiques est primordial, conditionnant directement le pronostic.
Le choix de l’antibiothérapie probabiliste repose sur la synthèse de différents
éléments décisionnels tels que la connaissance du site infecté, le terrain, la
gravité du tableau clinique et le caractère lié aux soins ou non de l’infection [4].
Cette réflexion en amont de la prescription est un pari microbiologique.
La connaissance de l’écologie bactérienne de l’unité dans laquelle le patient
est hospitalisé, de la flore colonisante du patient et des données fournies
par l’examen direct des prélèvements bactériologiques s’intègre dans cette
évaluation. La synthèse de ces éléments permet la prescription raisonnée de
l’antibiothérapie probabiliste [5]. Dans ce contexte, la conformation des praticiens
aux recommandations publiées revêt une importance particulière [6].
Afin de minimiser le risque d’échec, l’antibiothérapie probabiliste est le plus
souvent à large spectre. La principale limite de cette approche est qu’elle conduit
possiblement à la surconsommation d’antibiotiques [7]. Cette pratique peut alors

MAPAR 2013
188
être associée à l’émergence de bactéries multirésistantes, à des infections à
Clostridium difficile et à une augmentation des coûts [8]. Il est ainsi primordial
de déterminer les conditions dans lesquelles une antibiothérapie probabiliste doit
être initiée. Enfin, chez tous les patients, le traitement antibiotique probabiliste
doit être systématiquement réévalué et ajusté dès que l’identification micro-
biologique et les résultats de l’antibiogramme sont disponibles. Cette pratique,
qui implique généralement une désescalade du traitement probabiliste, est
associée à une diminution de l’incidence des surinfections et de l’émergence
de résistances aux antibiotiques [8].
2. DÉLAI D’ADMINISTRATION
En fonction de la situation clinique rencontrée, on identifie schématique-
ment trois délais d’administration recommandés : urgent, précoce ou différé.
Urgent et précoce sont définis par la nécessité d’administrer le(s) antibiotique(s)
respectivement dans l’heure et dans les six à huit heures après le diagnostic.
L’administration de l’antibiothérapie peut être différée de 8 à 24 h si on suspecte
une infection non grave chez un patient stable [9]. Dans les infections non
associées à des signes de gravité, il est probablement raisonnable de surseoir à
la prescription d’antibiotiques en l’absence de documentation microbiologique,
notamment chez des patients sous surveillance continue. Cette attitude réduit
l’utilisation d’antibiotiques, augmente l’adéquation des traitements, et diminue
les coûts [10].
Chez les patients atteints de sepsis grave ou de choc septique, il est
recommandé d’administrer l’antibiothérapie dans l’heure suivant le diagnostic
[11], chaque heure de retard dans l’administration d’antibiotiques est associée à
une diminution moyenne de survie de 7,6 %. C’est ainsi qu’il est fondamental de
s’assurer que les prescriptions sont réellement administrées sans retard. Il en
est de même en présence d’un patient neutropénique, splénectomisé et avec
des symptômes neuroméningés évoquant une méningite (Figure 1).
Figure 1 : Algorithme décisionnel pour la prise en charge des patients en état
septique grave en réanimation. SARM : Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline ; BMR : bactérie multirésistante ; *seulement si insuffisance rénale.
• Traitement antibiotique dans les 3 mois
• Ecologie locale : forte prévalence des BMR
• Immunodépression
• Facteurs de risque de pneumonie liée aux soins :
- Hospitalisation > 3 jours (< 21 jours)
- Patient vivant en institution
- Patient en hospitalisation à domicile
- Hémodyalise dans les 30 jours
- Notion de membre de la famille porteur de BMR
ß-lactamine sans activité
contre P. aeruginosa
ß-lactamine avec activité
contre P. aeruginosa
Signe de
choc
Séjour en
réanimation
NON OUI
ET
< 5 j > 5 j
Suspicion de
SARM
Ajourter un antibiotique actif sur le SARM
(glycopeptide ou linezolide*)
Associer de la gentamicine
(ou une fluoroquinolone) Associer de l'amikacine
(ou une fluoroquinolone)
Adapter l'antibiothérapie dès l'identification de la bactérie

Infectieux 189
3. CHOIX DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE PROBABILISTE
Le choix de l’antibiothérapie probabiliste est basé sur les caractéristiques
de l’hôte, le site de l’infection, l’écologie locale, la pharmacocinétique et la
pharmacodynamie des antibiotiques. Par ailleurs, la toxicité et les coûts des
molécules sont à prendre en compte. Le choix entre monothérapie et association
d’antibiotiques est également discuté dans ce paragraphe. Des propositions
d’antibiothérapies probabilistes pour le traitement des infections nosocomiales
graves sont regroupées dans le Tableau I.
Tableau I
Bactéries suspectées en fonction du site de l’infection et propositions
d’antibiothérapies pour les infections graves. SARM : Staphylococcus aureus
résistant à la methycilline ; BMR : Bactérie multirésistante. La somme des
pourcentages ne totalise pas 100 car certains patients ont plusieurs infections
ou des infections polymicrobiennes.
Site Bactérie % Traitement proposé
Infections uri-
naires
(Pyélonéphrite
aiguë grave)
Enterobacteriacae :
• Escherichia coli
• P. aeruginosa
• Enterococcus sp.
• Staphylococcus sp.
60-70
40
8
15
4
Ceftriaxone IV ou ceftazidime
(si suspicion de P. aeruginosa)
± aminoglycoside
Sepsis intra-
abodominal
Bacilles à Gram negative :
• Escherichia coli
• P. aeruginosa
Cocci à Gram positif :
• Enterococcus sp.
Anaérobies:
• Bacteroides sp.
Champignons
60
40
30
30
20
30
20
20
Ertapéneme (si absence de
risque de P. aeruginosa)
Pipéracilline-tazobactam
Céphalosporine de 3°- or 4°
génération (active sur P.
aeruginosa) + métronidazole
Imipéneme or doripéneme
(facteurs de risque)
± fluconazole
± aminoglycoside (Etat de choc)
Pneumonies
nosocomiales
• Enterobacteriacae
• P. aeruginosa
• Staphylococcus a.
• Streptococcus p.
• Haemophilus influenzae
30–40
17-30
7-15
3-5
4-6
β-lactamine (active sur
P. aeruginosa)
± aminoglycoside
± glycopeptide ou linezolid si
suspicion de SARM
Pneumonies sans
facteur de risque
deBMR
• Staphylococcus aureus
• Streptococcus p.
• Haemophilus influenzae
•Autres bacilles à Gram-
• Anaérobies
45
9
20
20
4
Céphalosporine de 3° genera-
tion
sans activité sur P. aeruginosa
± Macrolide
Infections cuta-
nées
• Streptococcus sp.
• Staphylococcus sp.
• Anaérobies
• Bacilles à Gram négatif
40
30
30
10-20
β-lactamines + inhibiteur des
β-lactamases
Pipéracillin/Tazobactam
Céphalosporine de 2° genera-
tion
(céfoxitine)
Carbapénemes
Infections liées
aux
cathéters
• Staphylococcus sp.
• Enterobacteriacae
• P. aeruginosa
50
30
10-15
Glycopeptide ou Linezolid +
β-lactamine avec activité sur
P. aeruginosa
Méningites noso-
comiales
• Bacilles à Gram négatif
- Acinetobacter sp.
• Staphylococcus sp.
• Streptococcus sp.
• Neisseria meningitidis
60
30
20
10
1
Méropenem + Glycopeptide ou
Linezolid

MAPAR 2013
190
3.1. CARACTÉRISTIQUES DU PATIENT
Pendant de nombreuses années, le choix des antibiotiques en réanimation
était fonction de la durée de l’hospitalisation antérieure. Or, l’émergence de
bactéries multirésistantes (BMR) communautaires a rendu ce concept obsolète
[12]. Les facteurs de risque identifiés d’être porteur de BMR sont la prescription
d’un traitement antibiotique dans les trois mois précédents, un séjour dans un
hôpital dans les 30 jours précédents, une durée d’hospitalisation de plus de
cinq jours, des soins invasifs à domicile, la présence d’un porteur de BMR dans
l’entourage d’un patient et l’immunosuppression. En présence de ces facteurs de
risque, le spectre de l’antibiothérapie initiale doit inclure les BMR. Cela implique
le plus souvent la prescription d’un antibiotique actif sur les entérobactéries
productrices d’une β-lactamase de spectre étendu (BLSE) et d’un antibiotique
actif sur le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).
Dans le cas des pneumonies, les facteurs de risque spécifiques d’infection
à des BMR sont d’une durée d’hospitalisation ≥ deux jours, une résidence
prolongée dans une institution médicalisée, un contexte d’hospitalisation à
domicile, une dialyse chronique et un membre de la famille porteur de BMR.
3.2. SITE DE L’INFECTION
Le site de l’infection est l’un des principaux déterminants dans le choix de
l’antibiothérapie (Tableau I). Les infections les plus fréquemment rapportées
en réanimation sont les pneumonies (63 %), les infections intra-abdominales
(20 %), les bactériémies (15 %) et les infections des voies urinaires (14 %) [12].
Leur gravité n’est pas égale, les infections urinaires étant associées à une faible
morbidité.
Chez les patients sans facteur de risque de BMR, les principaux micro-
organismes responsables de pneumonie sont : Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Legionella sp., Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae et les virus. Pour les patients avec des
facteurs de risque de BMR, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii,
Klebsiella pneumoniae et le SARM doivent être suspectés.
Soixante pour cent des épisodes de péritonites bactériennes primaires sont
dues à des entérobactéries à Gram négatif, Escherichia coli et Klebsiella sp.
étant les micro-organismes les plus fréquemment isolés. Des streptocoques
et entérocoques sont retrouvés chez 25 % de ces patients. A contrario, les
péritonites secondaires sont fréquemment polymicrobiennes, associant des
bactéries à Gram négatif (E. coli, Enterobacter sp., Klebsiella sp.), des cocci
à Gram positif (entérocoques dans 20 % des cas) et anaérobies (Bacteroides
sp.). Pour les patients qui ont des facteurs de risque de BMR, ou dans le cas de
péritonites tertiaires, les BMR et les levures sont prises en compte.
Les infections cutanées sont également souvent polymicrobiennes. Les
bactéries les plus fréquemment identifiées sont Streptococcus sp. (40 %),
S. aureus (30 %), bactéries anaérobies (30 %) et les bactéries à Gram négatif
(10-20 %). S. pneumoniae (35 %) et Neisseria meningitidis (32 %) sont res-
ponsables de la majorité des méningites communautaires, contrairement aux
méningites postopératoires. La documentation bactériologique avec culture du
liquide céphalo-rachidien est indispensable dans ce contexte. Du point de vue
microbiologique, les staphylocoques (Staphylococcus epidermidis) et les bacilles

Infectieux 191
à Gram négatif (entérobactéries et Acinetobacter baumanii) sont le plus souvent
rencontrés dans ces méningites.
3.3. ECOLOGIE LOCALE
Une connaissance de l’écologie locale augmente la probabilité de prescrire
un traitement antimicrobien approprié. Le rôle des prélèvements systématiques
reste discuté, avec des conclusions variables dans la littérature. Par contre,
des points épidémiologiques, dont la fréquence est à déterminer, semblent
utiles. L’idée est de connaître les micro-organismes les plus fréquents dans
l’environnement de son unité. Le contrôle hebdomadaire ou bi-hebdomadaire
est probablement moins efficace en termes de coût/bénéfice. La surveillance
systématique évalue le niveau de résistance spécifique d’une unité donnée,
identifie les patients porteurs de BMR et facilite la révision des protocoles à la
lumière des modifications de l’écologie de l’unité [13]. Le bénéfice est collectif, en
termes de rédaction de protocoles. Toutefois, devant la survenue d’une infection
à l’échelon individuel, le poids de la surveillance systématique pour prescrire une
antibiothérapie probabiliste est sujet à caution.
3.4. PHARMACOCINÉTIQUE ET PHARMACODYNAMIE
La pharmacocinétique des antibiotiques est modifiée chez les patients
de réanimation en raison de l’importance de la balance hydrique journalière,
des variations rapides de poids, de l’hypoalbuminémie, de l’œdème et de
l’hématocrite réduit, qui conduisent à des variations importantes du volume
de distribution, de la demi-vie et de l’élimination des antibiotiques [14]. D’une
part le sepsis, en augmentant initialement le débit cardiaque et en créant un
troisième secteur par augmentation de la perméabilité capillaire, augmente la
clairance de nombreux antibiotiques. D’autre part, par les défaillances d’organe
induites, le sepsis peut également réduire fortement cette même clairance. En
conséquence, la surveillance des concentrations plasmatiques est encouragée.
Ainsi, pour les antibiotiques concentration-dépendant comme les aminogly-
cosides, la prescription en une injection unique quotidienne est recommandée.
La première dose, toujours élevée, est indépendante de la fonction rénale. Il est
recommandé de limiter la prescription à trois jours [15]. Pour les β-lactamines, les
concentrations plasmatiques doivent être au-dessus de la concentration minimale
inhibitrice (CMI) des bactéries visées pendant au moins 50 % du temps qui
sépare deux injections. Pour les fluoroquinolones, un ratio élevé AUC/CMI (AUC
pour « Area Under Curve » : Aire sous la courbe) est nécessaire (> 125 ou 250
selon les molécules). Pour ces raisons, les β-lactamines et les fluoroquinolones
doivent être prescrits à des posologies élevées et/ou en perfusion continue [16].
Toutefois, en cas d’insuffisance rénale, une adaptation des posologies est
nécessaire. Enfin, la prédiction de la pénétration des antibiotiques au sein des
organes et des tissus reste difficile en réanimation [17].
3.5. MONOTHÉRAPIE OU ASSOCIATION D’ANTIBIOTIQUES
L’association d’antibiotiques est supposée élargir le spectre d’activité
antibactérienne et dans certains cas augmenter l’activité bactéricide. Il est ainsi
recommandé de prescrire une association d’antibiotique dans le traitement de
bactéries spécifiques (principalement P. aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis)
et en présence d’un choc septique. Dans des analyses rétrospectives, l’associa-
tion d’antibiotique apparaît associée à une diminution mortalité à 28 jours chez
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%