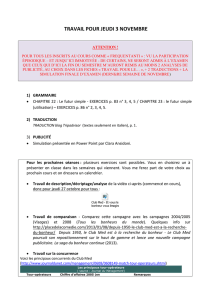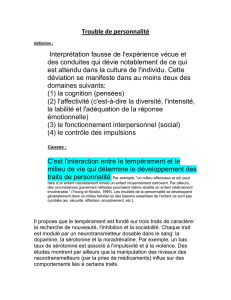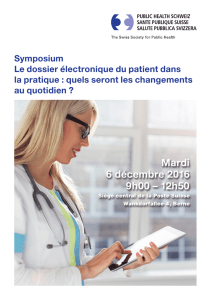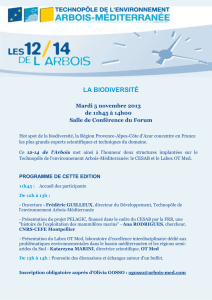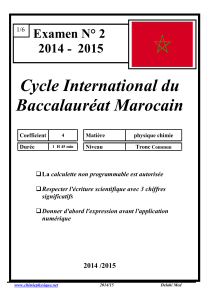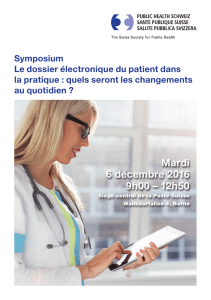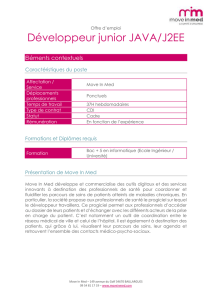Etude de la dynamique des communautés végétales des

USTHB‐FBS‐4thInternationalCongressofthePopulations&AnimalCommunities“Dynamics&Biodiversityofthe
terrestrial&aquaticEcosystems""CIPCA4"TAGHIT(Bechar)–ALGERIA,19‐21November,2013
267
Etude de la dynamique des communautés végétales des dunes littorales de
l’Est-Algérois.
HANIFI NADIR
USTHB-Faculté des Sciences Biologiques, Laboratoire de Biologie et Physiologie des Organismes
BP 32 El-Alia, Bab-Ezzouar, Alger 16111;
E-mail: [email protected]
Résumé
Les dunes maritimes de l’Est-algérois, ayant déjà fait l’objet par le passé de demandes de protection, font
face actuellement à des dégradations préjudiciables à l’équilibre naturel. Les communautés végétales
littorales existantes n’occupent que quelques surfaces réduites. Elles représentent une part importante de la
Biodiversité.
Ces communautés sont organisées selon le niveau de stress édaphique : granulométrie, salinité,
recouvrement de la végétation ; ainsi que le mode et l’intensité des perturbations majeurs d’origine
éolienne, pâturages et phénomène de piétinement (Hanifi et al., 2007).
Dans ces dunes soumises à des perturbations régulières, les traits de vie liés à la biologie des espèces
(production, dispersion et germination des semences) sont autant discriminants que les traits
morphologiques ; mais, les stratégies adaptatives de Grime (1979) sont les meilleurs prédicteurs de
l’ordination des espèces sur les gradients de stress et de perturbation.
Les résultats obtenus après l’utilisation de la démarche de Hill & Gauch (1980) et Ter Braak (1986) mettent
en évidence des corrélations étroites entre les espèces, les relevés mésologiques ainsi que les traits
biologiques des différents groupes fonctionnels d’espèces. Cette approche fonctionnelle est souvent utilisée
en écologie des communautés pour décrire, comprendre et prédire les phénomènes écologiques.
Mots clés : Algérie, dune littorale, biodiversité, communautés végétales, groupes fonctionnels
Abstract
The coastal dunes of East Algiers, having already been in the past applications for protection, are currently
facing adverse damage to the natural balance. Existing coastal plant communities occupy only a few small
areas. They represent an important part of biodiversity. These communities are organized
according to level of stress edaphic: size, salinity, vegetation cover, and the mode and intensity of major
disturbances from wind, grazing and trampling phenomenon (Hanifi et al., 2007). -.
In these dunes subject to regular disturbance, life history traits related to biology
species (production, dispersal and germination of seeds) are as discriminating as the morphological traits,
but the adaptive strategies of Grime (1979) are the best predictors of the ordination of species on gradients
of stress and disturbance.
The results obtained after the use of the approach of Hill & Gauch (1980) and Ter Braak (1986) show strong
correlations between species, mesological and biological traits of different functional groups of species
identified. This functional approach is often used in community ecology to describe, understand and predict
ecological phenomena.
Key words: Algiers, coastal dune, biodiversity, plant communities, functional groups.
1. Introduction
Ces dunes maritimes, ayant déjà fait l’objet par le passé de demandes de protection, font face
actuellement à des dégradations préjudiciables à l’équilibre naturel. Les communautés végétales

USTHB‐FBS‐4thInternationalCongressofthePopulations&AnimalCommunities“Dynamics&Biodiversityofthe
terrestrial&aquaticEcosystems""CIPCA4"TAGHIT(Bechar)–ALGERIA,19‐21November,2013
268
littorales existantes n’occupent que quelques surfaces réduites. Elles représentent une part
importante de la Biodiversité.
Ces communautés sont organisées selon le niveau de stress édaphique (granulométrie, salinité,
recouvrement de la végétation) ainsi que le mode et l’intensité des perturbations majeures
(d’origine éolienne, pâturages ainsi que le phénomène de piétinement).
Dans ces dunes soumises à des perturbations régulières, les traits de vie liés à la biologie des
espèces (production, dispersion et germination) sont autant discriminants que les traits
morphologiques ; mais, les stratégies adaptatives de Grime, 1979) sont les meilleurs prédicteurs de
l’ordination des espèces sur les gradients de stress et de perturbation.
L’objectif principal de ce travail est de caractériser sur les dunes littorales de Zemmouri (Est-
algérois) des groupes fonctionnels d’espèces montrant à la fois des traits biologiques communs et
des réponses similaires aux principaux facteurs environnementaux. L’analyse floristique des
communautés végétales sont déjà connus précédemment (Hanifi et al., 2007) ; sur la base de leurs
traits biologiques, des groupes d’espèces seront identifiés séparément afin de prévoir leur évolution
dynamique. Une ordination simultanée des espèces, des variables environnementales et des traits
biologiques est ensuite produite afin de classer les espèces en groupes fonctionnels (Lavorel et
al.,1998). Cette nouvelle classification des espèces en groupes fonctionnels est proposée dans une
perspective de gestion conservatoire des communautés végétales en milieu dunaire (Hanifi et al.,
2004).
2. Matériels et méthodes
2.1. Les caractéristiques générales de la zone d’étude
La zone d’étude fait partie du littoral Est-algérois. Elle est limitée, au Nord par la mer Méditerranée,
au Sud par la Route Nationale 24, à l’Ouest par le port de Zemmouri-El -Bahri, et à l’est par l’Oued
Isser. Elle correspond à un cordon dunaire qui s’étale sur 12 Kms de côte, d’une largeur variable
entre 100 m et 200 m.
Le relief du Sahel est relativement plat, l’altitude moyenne est de 20 m. Le réseau hydrographique
est constitué de 3 Oueds : Bergouga, Merdja et Isser. Le sol est de nature siliceuse.
La végétation psammophile du littoral est de type azonal, liée essentiellement à l’édaphisme (Sadki
et al, 1991); aussi le climat et le bioclimat de la zone d’étude sont analysés brièvement, sur les
bases de données climatiques de Seltzer (1946).
La pluviosité moyenne annuelle « p » varie de 579 mm (Bordj-El-Bahri) à 815 mm (Thénia).
Le régime pluviométrique saisonnier est partout de type H, A, P, E.
La moyenne des températures minimales du mois le plus froid « m », oscille entre 5.7°C (Thénia) et
9.3°C (Bordj-El-Bahri) ; Celle maximale du mois le plus chaud « M », entre 28.9°C (Bordj-El-
Bahri) et 33.8°C (Thénia). Le bioclimat est de type subhumide, variante à hiver chaud.
La durée de la période sèche, est estimée à l’aide de diagrammes ombrothermiques de Bagnouls et
Gaussen (1953) ; elle se situe entre 4mois à Thénia et 5 mois à Bordj-El-Bahri.
Les vents sont faibles à modérés et leur force n’excède jamais la valeur 3. Au cours de la période
hiver, automne et printemps, la direction des vents à dominance Ouest et Nord-Ouest. En été, la
direction des vents est Nord-est et Est.
Au plan phytogéographique, le littoral Est-Algérois s’inscrit dans le secteur algérois de Maire
(1926), ou le secteur littoral de Quézel & Santa (1962-1963).
2.2. Echantillonnage et traits fonctionnels
La végétation est étudiée d’un point de vue fonctionnel afin de mettre en relation la réponse de la
végétation aux conditions du milieu d’une part et les effets des traits biologiques sur le
fonctionnement de l’écosystème d’autre part.
Des relevés floristiques ont été effectués dans plusieurs parcelles en juin 2006 en utilisant la
méthode des points quadrats (Gounot, 1969). Nous avons placés, de manière aléatoire, des transects
linéaires de 10 m dans la parcelle en veillant toutefois à considérer le groupement végétal dans son

USTHB‐FBS‐4thInternationalCongressofthePopulations&AnimalCommunities“Dynamics&Biodiversityofthe
terrestrial&aquaticEcosystems""CIPCA4"TAGHIT(Bechar)–ALGERIA,19‐21November,2013
269
ensemble et de traduire ainsi la variabilité due à une éventuelle hétérogénéité de la perturbation
(hétérogénéité du pâturage, du piétinement, par exemple). Le long de ces transects, tous les 10 cm,
nous avons relevé toutes les espèces entrant en contact avec une aiguille descendue verticalement
dans la masse végétale. Cette méthode, permettant d’évaluer les fréquences de toutes les espèces
recensées, est reconnue pour sa fiabilité (Daget et Poissonnet, 1971). Nous obtenons donc un total
de 30 relevés. Les espèces ont été identifiées grâce à la flore de Quézel et Santa (1962). La liste de
l’ensemble des principales espèces présentes est illustrée au tableau I.
Tableau I : Liste des taxons rencontrés à Zemmouri (espèces, numéro, 1 à 43, et codes).
N° Code
chiffres Code
lettres E S P E C E S Type
Biolog.
Type
Phytog..
01 0088 Aj Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea
= Agropyrum junceum
Géo Atl-Med
02 0249 Aa Ammophila arenaria Link subsp. australis (Mabille)
Lainz
Géo Circ.Bor
03 0268 Ac Anacyclus clavatus Desf. The Euro-Med
04 0675 As Avena sterilis L. The M.I.T
05 0824 Br Bromus madritensis L. The Euro.Med
06 0881 Cm Cakile maritima Scop. The Euro-Med
07 1194 Cs Centaurea sphaerocephala L. Hem Med
08 1353 Ca Cistus albidus L. Nph Med
09 1380 Cf Clematis flammula L. Nph Med
10 1541 Cv Crepis vesicaria L. The Euro-Med
11 1561 Crm Crucianella maritima L. Cha Med
12 1596 Cum Cutandia maritima (L) Benth.. The Med
13 1766 Dm Otanthus martimus. (L.) Hoffmanns et Link = Diotis
maritima (L.) Sm
Cha Med-Atl
14 1834 Ec Echium confusum De coincy The Med
15 1862 Es Helichrysum stoechas (L.) DC. Cha Atl-Med
16 1887 Ef Ephedra fragilis Desf Pha Med
17 1990 Em Eryngium maritimum L. Hem Med
18 2034 Ep Euphorbia paralias L. Géo Euro-Med
19 2285 Gf Genista ferox Poiret Nph End-N.Af
20 2337 Gf Glaucium flavum Crantz The Med
21 2395 Hc Hedypnois cretica (L.) Will. The Med
22 2732 Jp J. turbinata (Guss.) P. Lebreton et P. Perez
subsp. turbinata = Juniperus phoenicea L.
Pha Med
23 2778 Lo Lagurus ovatus L. The Med
24 3037 Ls Linum strictum L. The Med
25 3080 Li Lonicera implexa Aiton Nph Med
26 3093 Lc Lotus creticus L. Cha Med
27 3215 Mt Matthiola tricuspidata (L.) R.Br The Med
28 3232 Mm Medicago marina L. Cha Med
29 3534 Ov Ononis variegata L. The Med
30 3607 Om Orlaya maritima Koch. The Med
31 3684 Opc Oxalis pes-caprae (L.) Thumb. The Cosm.
32 3699 Pm Pancratium maritimum L. Géo Circ.Med
33 3806 Pa Phillyrea media L. Npha Med
34 3869 Pl Pistacia lentiscus L. Nph Med
35 3971 Pom Polygonum maritimum The Cosm.
36 4096 Qc Quercus coccifera L. Pha Med
37 4163 Ra Reseda alba L. The EurAs.
38 4264 Rp Rubia peregrina L. Nph Med-Atl
39 4276 Rb Rumex bucephalophorus L. The Med
40 4338 Sk Salsola kali L. The Paléo-Temp.
41 4582 Sl Senecio leucanthemifolius Poiret The Med
42 4648 Sc Silene colorata Poiret The Med
43 4737 Sa Smilax aspera L. Nph Med

USTHB‐FBS‐4thInternationalCongressofthePopulations&AnimalCommunities“Dynamics&Biodiversityofthe
terrestrial&aquaticEcosystems""CIPCA4"TAGHIT(Bechar)–ALGERIA,19‐21November,2013
270
Les mesures des 8 variables du milieu sont; elles sont classées en 6 variables géo-pédologiques et 2
variables de perturbation biotiques (Tab.II).
Tableau II : Modalités des variables écologiques considérées
Variables Géopédologique Modalités
1 - Salinité du sol
2 – Granulométrie
3 - Matière organique
4 – Recouvrement de la végétation
5 – Position sur les dunes
6 – Exposition au vent
- faible, Moyenne, Forte : 1, 2, 3
- Sable fin, sable grossier : 1, 2
- Absence, présence : 1, 2
- faible, Moyenne, Forte : 1, 2, 3
- Dune mobile, semi-fixée, fixée 1,2, 3
- non-exposée, Exposée : 1, 2
Perturbations biotiques
7 – Surpâturage
8 -
p
iétinement
- Absence, Ovins-Bovins-Equins : 1,2,
- Non-piétinée, piétinée : 1, 2
Les variables de fonctionnement sont des variables permettant de quantifier les processus
écosystémiques. L’ensemble des variables de fonctionnement classées en une douzaine de traits
biologiques portent sur des caractères morphologiques, et de régénération, (Tab.III)
Tableau III : Traits biologiques, morphologiques et de régénérations retenus pour l’analyse fonctionnelle
Traits
Nombre de
Modalités Abréviations Caractéristiques
Morphologiques
Cycle de Vie C.Vie 2 1 AnBi Annuelle/Bisanuelle
2 Viva Vivace
Hauteur
Haut 2 1 H1 ≤ 50 cm
2 H2
>50
cm
Extension latérale Ext.L 3 1 Limit Extension limitée
2 Comp Compacte < 20 cm
3 Colo Colonisatrice>20 cm
Type Biologique T.bio 5 1 Théro Thérophytes
2 Géo Géophytes
3 Hémi Hémicryptophytes
4 Cham Chamaephytes
5 Phan Phanérophytes sl.
De régénérations
Mode de Régénération M.Reg. 2 1 Grain par graines de préférence
2 Vég Multiplication végétative
Type de dispersion T.dis 3 1 Aném par le vent
2 AutBa Dispersion non spécialisée
3 Zooc par les animaux
Banque de graines B.Grn 2 1 Absente éphémère
2 persistante présente
Des corrélations entre les variables climatiques et les variables phénologiques seront testées par des
régressions linéaires multiples. Le fonctionnement de l’écosystème peut être relié au milieu via des
traits fonctionnels végétaux (surface foliaire, hauteur de la plante, type de banque de graine, type
biologique, mode de régénération….).
L’approche fonctionnelle est basée sur l’hypothèse suivante, que les milieux étudiés sont organisés
selon un gradient de stress et un gradient de perturbation (Grime, 1979). Alors, les stratégies des
espèces sont axées sur un compromis dans le recyclage des nutriments (acquisition ou conservation
des ressources).

USTHB‐F
B
t
2.3. Répo
n
Afin de
m
utilisée p
o
b
iologiqu
e
Pour cela
l
- Un ta
b
- Un t
a
b
iotiques
recouvre
m
- Un ta
b
plantes (P
F
obtenue.
Afin d’ide
n
des corres
p
(version 4.
L’ordinati
o
affinités
e
compositi
o
Le traitem
e
indirect d
e
considéra
n
ordonnés
d
Ces « Pla
n
relativeme
n
végétaux
(
processus
d
3. Ré
s
Le plan f
a
d’inertie d
u
B
S‐4thInterna
t
errestrial&
a
n
ses de la
v
m
ettre en é
v
o
ur quantifi
e
e
s (de morp
h
l
’ensemble
d
b
leau Y : e
s
a
bleau X :
r
(surpâtura
g
m
ent de la v
é
b
leau Z :
e
F
Ts), en t
r
ntifier les
d
p
ondances
5) de Ter-
B
o
n obtenu
e
e
ntre les
g
o
n spécifiq
u
e
nt de la
m
e
distributi
n
t uniquem
e
d
ans un dia
g
n
ts Foncti
o
n
t homogè
n
(
ou syntax
d
ynamique
s
s
ultats et
d
a
ctoriel con
s
u
premier a
x
tionalCongr
e
a
quaticEcosy
s
v
é
g
étation
a
v
idence et
d
e
r la part
d
h
ologie et
d
d
es donnée
s
s
pèces-rele
v
r
elevés-var
i
g
e et piét
i
é
gétation, g
r
e
spèces-trai
t
r
aitant la
m
d
ifférents g
r
détendanc
é
B
raak & S
m
e
peut être
g
roupement
s
u
e.
m
atrice rele
v
on des ha
b
e
nt les reg
r
g
ramme po
u
o
nnels Typ
e
n
es en ter
m
ons) et su
b
s
(ou stade
s
d
iscussions
s
idéré est c
e
x
e est élev
é
e
ssofthePop
s
tems""CIPC
A
a
ux pertur
b
d
’identifier
d
es effets d
e
d
e régénérat
s
se présen
t
v
és (43x42)
i
ables envi
r
i
nement)
e
r
anulométr
i
t
s biologiq
u
m
atrice croi
s
r
oupes fon
c
es (DCA)
a
m
ilauer (199
interprété
e
s
de relev
v
és-traits bi
o
b
itats indé
p
r
oupement
s
u
vant être a
e
s (PFTs)
»
m
es de trait
b
issant les
s
successio
n
e
lui défini
p
é
, 67,5% ;
a
ulations&A
n
A
4"TAGHIT(B
e
271
b
ations
des group
e
es perturb
a
t
ion).
t
ent sous fo
r
est établit.
r
onnementa
l
e
t de pert
u
i
e….) est d
r
u
es, 43x12
p
s
ée Y’ rel
e
c
tionnels,
u
a
été reten
u
8).
e
comme
u
v
és tenant
o
logiques
d
p
endamme
n
s
sur la b
a
a
ssimilé co
m
» sont dé
fi
t
s biologiq
u
mêmes c
o
n
nels) ident
i
p
ar les axes
a
lors que c
e
imalCommu
n
e
char)–ALGE
e
s fonction
n
a
tions (biot
i
r
me de troi
s
l
es constit
u
u
rbations
a
r
essé (42x8
)
p
ermet d’i
d
e
vés-espèce
ne méthod
e
u
e et réalis
é
u
n gradient
compte d
e
d
es espèces
n
t de leur
a
se des trai
t
m
me des gr
o
i
nis comm
e
u
es apparte
n
o
nditions
e
i
ques.
DCA1 et
D
e
lui de l’ax
e
n
ities“Dyna
m
RIA,19‐21N
o
n
els, une a
n
ques et ab
i
s
tableaux
o
u
ant des fa
c
a
biotiques
)
.
d
entifier les
s
et Z esp
è
e
d’ordinati
é
e à l’aide
environne
m
e
s degrés
d
p
ermet de
d
compositi
o
t
s biologiq
u
o
upes fonct
i
e
des unité
n
ant aux
m
e
nvironnem
e
D
CA 2. On
r
e
2, il est de
m
ics&Biodive
o
vember,201
a
nalyse mu
l
i
otiques) s
u
o
u matrice :
c
teurs de p
e
(expositio
n
s
types fon
c
è
ces-traits
b
i
on indirect
e
du logiciel
m
ental ex
p
d
e similar
i
d
éterminer
o
n taxono
m
q
ues. Des r
e
i
onnels de
p
é
s de plant
e
m
êmes grou
p
e
ntales ai
n
r
emarquera
, 15,8%.
rsityofthe
3
l
tivariée es
t
u
r des trait
s
e
rturbation
s
n
au vent
,
c
tionnels d
e
b
iologique
s
e
, l’analys
e
CANOC
O
p
liquant le
s
i
té dans l
a
un gradien
t
m
ique, mai
s
e
levés son
t
p
lantes.
e
s qui son
t
p
ements d
e
n
si que de
s
que le tau
x
t
s
s
,
e
s
e
O
s
a
t
s
t
t
e
s
x
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%