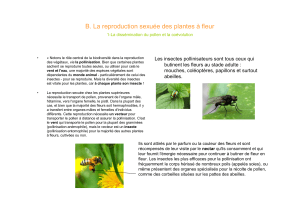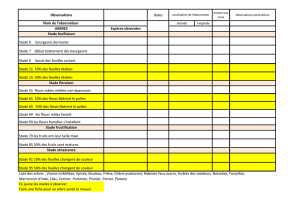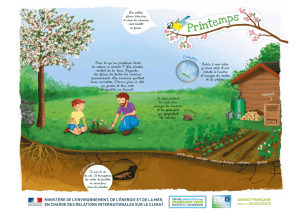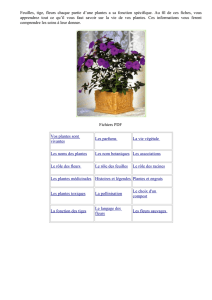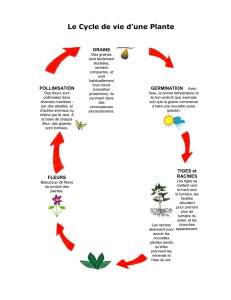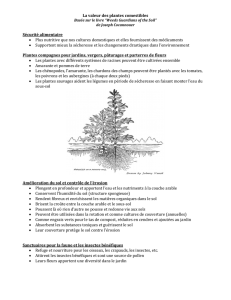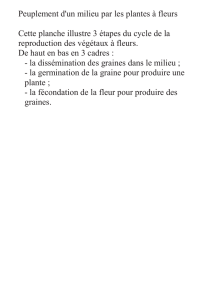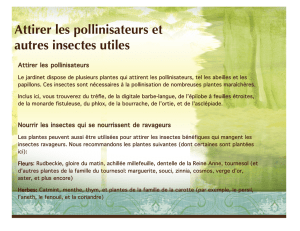la symbiose entre insectes et plantes au jardin

LA
LA LA
LA SYMBIOSE
SYMBIOSESYMBIOSE
SYMBIOSE
ENTRE
ENTREENTRE
ENTRE
INSECTES
INSECTESINSECTES
INSECTES
ET
ETET
ET
PLANTES
PLANTESPLANTES
PLANTES
AU
AUAU
AU
JARDIN
JARDINJARDIN
JARDIN
Laurent
Laurent Laurent
Laurent BRAY
BRAYBRAY
BRAY
Conservateur du Jardin Botanique de Paris
Conservateur du Jardin Botanique de ParisConservateur du Jardin Botanique de Paris
Conservateur du Jardin Botanique de Paris
Les plantes à fleurs ou Angiospermes sont les végétaux
ayant le plus grand nombre d'espèces et dont les habitats
sont les plus diversifiés alors qu'elles constituent le groupe
le plus récent de l'histoire évolutive des plantes terrestres.
Cette radiation importante s'expliquerait par les relations
privilégiées, diversifiées et originales établies avec les in-
sectes. Le transport du pollen de l'organe mâle où il est
produit vers le stigmate du pistil où il est déposé est réalisé
par les insectes pour la majorité des plantes à fleurs. Des
exemples de pollinisation sont étudiés chez les composées,
les légumineuses, les orchidées, les aracées et les figuiers.
LES
LES LES
LES PLANTES
PLANTESPLANTES
PLANTES
À
ÀÀ
À
FLEURS
FLEURSFLEURS
FLEURS,
, ,
, ÉVOLUTION
ÉVOLUTIONÉVOLUTION
ÉVOLUTION
LA
LALA
LA
PLUS
PLUSPLUS
PLUS
RÉCENTE
RÉCENTERÉCENTE
RÉCENTE
DES
DESDES
DES
PLANTES
PLANTESPLANTES
PLANTES
TERRESTRES
TERRESTRESTERRESTRES
TERRESTRES
Les plantes terrestres ancestrales sont apparues il y a 410
millions d'années. Par rapport aux algues vertes dont elles
divergent, elles se caractérisent, en particulier, par une
cuticule imperméable limitant la déshydratation et la pro-
tection des spores qui sont enfermées dans un sac avec une
enveloppe.
Les fougères et plantes alliées développent un port érigé,
grâce aux tissus conducteurs et de soutien, et généralisent
l'hétérosporie chez les taxons les plus évolués afin d'aug-
menter statistiquement le brassage génétique.
Chez les Gymnospermes qui apparaissent il y a 260 mil-
lions d'années, la fécondation est sécurisée et le brassage
génétique facilité grâce à la graine et au grain de pollen
chez les Gymnospermes.
Enfin, chez les Angiospermes, la survie et la dispersion des
semences sont assuré grâce au carpelle et à la double fé-
condation (50 M années).
Les tendances de l'histoire évolutive sont donc :
– la libération de la contrainte « eau » dans le cycle de vie
des plantes ;
– la facilitation du brassage génétique ;
– la sécurisation de la fécondation et du développement de
l'embryon ;
– la mise en place de mécanismes assurant la survie et la
dispersion de la descendance sexuée.
Les plantes à fleurs ou Angiospermes sont les plantes
terrestres qui sont différenciées le plus tardivement
mais dont la radiation est la plus importante.
DES
DES DES
DES RELATIONS
RELATIONSRELATIONS
RELATIONS
POUR
POURPOUR
POUR
UN
UNUN
UN
BÉNÉFICE
BÉNÉFICEBÉNÉFICE
BÉNÉFICE
MU-
MU-MU-
MU-
TUEL
TUELTUEL
TUEL
ENTRE
ENTREENTRE
ENTRE
LES
LESLES
LES
INSECTES
INSECTESINSECTES
INSECTES
ET
ETET
ET
LES
LESLES
LES
PLAN-
PLAN-PLAN-
PLAN-
TES
TESTES
TES
À
ÀÀ
À
FLEURS
FLEURSFLEURS
FLEURS
Les plantes à fleurs constituent le groupe dont les
relations avec les insectes sont le plus riches et diver-
sifiées. Pour les insectes les plantes à fleurs
peuvent servir :
– de nourriture soit directement (nectar, sève, feuil-
les, bois) ou soit indirectement (déjections de puce-
rons, création de compost) ;
– d' abri soit directement (bambou, feuilles) soit
après transformation de matériel végétal (cire des
abeilles).
A l'inverse, pour les plantes à fleurs les insectes peu-
vent servir :
– de vecteurs de pollinisation pour les plantes à
fleurs ;
– de nourriture (plantes insectivores) ;
– de transport des semences ;
– de semeurs (fourmis semeuses ou sarcleuses)
La pollinisation est la relation qui a permis le déve-
loppement du plus grand nombre d'adaptations de
part et d'autre.
LE
LE LE
LE POLLEN
POLLENPOLLEN
POLLEN
ENTOMOPHILE
ENTOMOPHILEENTOMOPHILE
ENTOMOPHILE,
, ,
, UNE
UNEUNE
UNE
MORPHO-
MORPHO-MORPHO-
MORPHO-
LOGIE
LOGIELOGIE
LOGIE
ADAPTÉE
ADAPTÉEADAPTÉE
ADAPTÉE
AU
AUAU
AU
TRANSPORT
TRANSPORTTRANSPORT
TRANSPORT
PAR
PARPAR
PAR
LES
LESLES
LES
INSECTES
INSECTESINSECTES
INSECTES
Le grain de pollen est un gamétophyte, c'est-à-dire
une “plante” produisant des gamètes, et non pas un
gamète lui-même. Il est à comparer au prothalle des
fougères.
Quand son transport est assuré par les insectes, il est
de grande taille, à exine (paroi externe) ornementée
pour faciliter la fixation sur le corps des insectes. Il
est produit par des étamines souvent placées à l'inté-
rieur d'une fleur colorée, bien visible et produisant
du nectar.

Ils transportent le pollen jusqu’à 2 km autour de la ru-
che pour les abeilles (Ramsey
et al.,
1999). La distance
normale de pollinisation d’un bourdon est comprise
entre 70 et 631 m, même quand des champs de culture
sont très proches (Osborne
et al.,
1999).
A l'inverse, chez les plantes à fleurs pollinisées par le
vent, le pollen est de petite taille, à exine lisse et pro-
duit dans des anthères pendantes et à filets longs dans
des fleurs réduites et discrètes.
DES
DES DES
DES POLLINISATIONS
POLLINISATIONSPOLLINISATIONS
POLLINISATIONS
ILLUSTRANT
ILLUSTRANTILLUSTRANT
ILLUSTRANT
LA
LALA
LA
COM-
COM-COM-
COM-
PLEXITÉ
PLEXITÉPLEXITÉ
PLEXITÉ
DES
DESDES
DES
RELATIONS
RELATIONSRELATIONS
RELATIONS
INSECTES
INSECTESINSECTES
INSECTES-
--
-
PLANTES
PLANTESPLANTES
PLANTES
À
ÀÀ
À
FLEURS
FLEURSFLEURS
FLEURS
Chez les composées, le capitule, comme beaucoup d'in-
florescences, a un effet d'affichage important dû à la
multiplication des fleurs.
Chez certaines composées, les fleurs périphériques
étant stériles n'ont aucun rôle sexuel direct mais ser-
vent à guider les insectes vers celles fertiles placées au
centre de l'inflorescence. Après la fécondation, le fruit
est transporté par le vent ou les animaux.
Chez les légumineuses papilionacées, les inflorescences
ne sont pas en capitule mais la forme particulière de la
corolle, étendard surplombant la carène et 2 ailes laté-
rales, conduit les insectes vers les organes sexuels de la
fleur.
Chez les orchidées, l'attraction des insectes pollinisa-
teurs est due à différents facteurs :
– la production de nectar (genres
Spiranthes
et
Or-
chis
) ;
– l'éperon joue, comme cela a été prouvé, un rôle im-
portant ;
– le mimétisme avec les plantes à nectar (genre
Or-
chis
) ;
– le leurre sexuel (genre
Ophrys
).
Une fois l'insecte attiré par la fleur, la morphologie de
celle ci permet la fixation du pollen sur le corps de
l'animal, son transport puis son dépôt sur l'organe fe-
melle de la fleur, le stigmate du pistil, qui est
pollinisé ensuite (cas de
Orchis morio
).
Chez
Ophrys scolopax,
le labelle imite la forme
de l'insecte pollinisateur.
L'insecte mâle est adulte avant la femelle. Il participe à
la pollinisation car il est attiré par un bouquet d'odeur
similaire à la phéromone sexuelle de la femelle.
Chez les orchidées, d'autres facteurs peuvent intervenir
sur la pollinisation : morphologie de l'inflorescence
(spiranthe d'été) ou position des fleurs dans l'inflores-
cence (spiranthe d'automne).
L'hybridation interspécifique est possible (orchis singe
et orchis homme pendu) car le pollinisateur
est commun entre ces deux espèces.
Chez les aracées, les insectes pollinisateurs sont attirés
par l'odeur nauséabonde émise par l'inflorescence, un
spadice enveloppé d'une spathe. Les fleurs femelles si-
tuées vers le bas de l'inflorescence sont fertiles avant les
fleurs mâles (protogynie). Il existe aussi des fleurs stéri-
les, mâles ou femelles, réglant le passage des insectes
d'un niveau à l'autre du spadice. Chez
Arum italicum,
les
insectes chargés de pollen sont bloqués au niveau de
l'ampoule de la spathe par des fleurs stériles pour per-
mettre la pollinisation et la fécondation des fleurs femel-
les fertiles. Ceci étant fait, les insectes peuvent remonter
au niveau des fleurs mâles devenues fertiles entre temps
et se chargent à nouveau de pollen. Quand les appendi-
ces des fleurs mâles stériles se flétrissent à leur tour, ils
peuvent quitter la spathe qui les piégeaient pour pollini-
ser une autre plante (allopollinisation).
Les 800 espèces de figuiers de par le monde ont chacun
un mutualisme de pollinisation spécifique et obligatoire
avec un hyménoptère du genre
Blastophaga
. Les inflo-
rescences des figuiers sont protogynes, comme celles des
aracées : les fleurs femelles sont fertiles avant les mâles.
Les insectes femelles rentrent dans le jeune « fruit »,
l'inflorescence en fait, par une ouverture naturelle, l'os-
tiole. Ils pondent leurs oeufs dans quelques fleurs femel-
les, celles mâles n'étant pas encore développées. Les
fleurs, dans lesquelles les larves se développent, se trans-
forment en galle.
Les insectes mâles, matures avant les femelles, les fé-
condent alors qu'elles sont encore dans les galles. Avant
WWW.SNHF.ORG

de mourir, les insectes mâles dépourvus d'ailes creu-
sent un tunnel pour sortir du fruit dont l'ostiole s'est
fermée lors de la maturation du fruit. Les insectes
femelles effectuent leur premier vol à l'intérieur du
fruit, se chargent de pollen au contact des fleurs mâ-
les fertiles, avant de sortir par les tunnels creusés par
les mâles. Quand elles vont pondre dans les jeunes
inflorescences de figuier, les fleurs femelles sont ferti-
les et recevront le pollen que les insectes avaient pris
dans
l'inflorescence précédente.
D'autres acteurs participent à ce mutualisme : des
insectes parasites des pollinisateurs et des fourmis
prédatrices attirées aussi bien par les parasites et les
pollinisateurs que par des messages chimiques olfac-
tifs évoquant des hormones sexuelles.
En conclusion
conclusionconclusion
conclusion, les relations entre les insectes et les
plantes à fleurs sont anciennes : chez les Angiosper-
mes ancestrales, la pollinisation déjà était assurée par
des Coléoptères qui mangeaient le pollen. Elles sont
devenus complexes et diversifiées, permettent d'offrir
le gîte et le couvert pour les insectes et d'assurer la
pollinisation de 80% des plantes à fleurs. Chacune des
parties, l'animal
ou la plante, pouvant posséder des caractères morpho-
logiques adaptés à l'autre partie, certaines relations
sont uniquement spécifiques.
Certains auteurs n'hésitent donc pas à qualifier les
relations entre les insectes et les plantes à fleurs de
co-évolution. Quelles que soient leur différentes qua-
lifications (co-évolution, mutualisme...) liées à leur
degré de complexité, ces relations privilégiées expli-
quent sans doute la radiation importante des Angios-
permes alors que le groupe est récent par rapport aux
autres plantes terrestres.
Vive la biodiversité dans les jardins
Vive la biodiversité dans les jardinsVive la biodiversité dans les jardins
Vive la biodiversité dans les jardins
Journée à thème de la SNHF
Journée à thème de la SNHFJournée à thème de la SNHF
Journée à thème de la SNHF
Paris, le 22 janvier 2009
Paris, le 22 janvier 2009Paris, le 22 janvier 2009
Paris, le 22 janvier 2009
1
/
3
100%