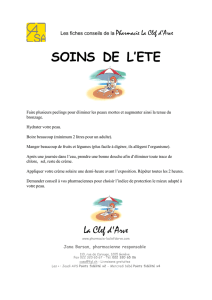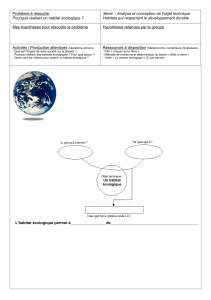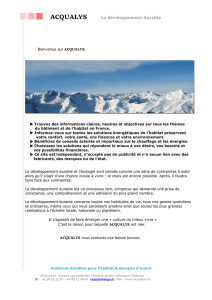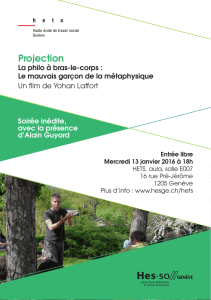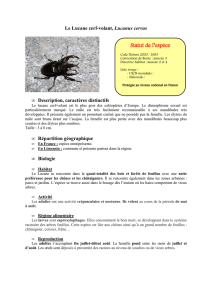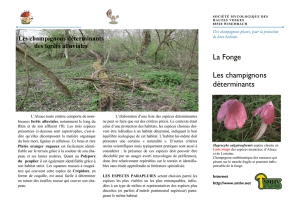diagnostic écologique

Diagnostic écologique du périmètre d’étude Natura 2000 « Moyenne vallée de l’Arve »
Synthèse des inventaires – janvier 2011
1
Diagnostic écologique du
périmètre d’étude Natura 2000
« Moyenne vallée de l’Arve »
SY N T H E S E D E S
I N V E N T A I R E S
photos FRAPNA, LPO, ONF

Diagnostic écologique du périmètre d’étude Natura 2000 « Moyenne vallée de l’Arve »
Synthèse des inventaires – janvier 2011
2

Diagnostic écologique du périmètre d’étude Natura 2000 « Moyenne vallée de l’Arve »
Synthèse des inventaires – janvier 2011
3
Sommaire
I. Les habitats naturels
I.1. Les habitats forestiers
I.2. Les habitats ouverts
II. Les oiseaux
III. Les mammifères
III.1. Les chiroptères
III.2. Les mammifères terrestres ou aquatiques
IV. Les amphibiens et les reptiles
IV.1 Les amphibiens
IV.2 Les reptiles
V. Les insectes
V.1 Les odonates
V.2 Les lépidoptères
V.3. Les coléoptères
V.4 Les orthoptères
VI. Conclusions
Bibliographie
Annexes
I. Les habitats naturels

Diagnostic écologique du périmètre d’étude Natura 2000 « Moyenne vallée de l’Arve »
Synthèse des inventaires – janvier 2011
4
I.1. LES HABITATS FORESTIERS
I.1.1. Description générale
Les relevés effectués entre mai et juillet 2010 ont permis de relever 10 types d’habitats forestiers,
parmi lesquels 3 habitats d’intérêt communautaire. La distribution des habitats forestiers en
bordure de la rivière Arve est influencée par de multiples facteurs : la topographie, l’alimentation
en eau, la pédologie, mais aussi la dynamique de la rivière et l’action de l’homme, influençant la
distribution et la succession de stades pionniers ou matures.
la topographie : elle est liée à la mise en place des formes alluviales avec schématiquement des
zones basses proche du chenal et des zones hautes sur la frange externe. Ce gradient peut être
modifié par la présence d’anciens chenaux ou de ballastières.
l’alimentation en eau : elle s’exprime par la fréquence de submersion et le niveau de la nappe
d’accompagnement et se trouve corrélée avec la position altitudinale.
la pédologie : dans ce type de milieu elle est surtout liée aux dépôts alluviaux (sable, galets,...)
et dans une moindre mesure à l’action des organismes vivants.
Sur
tous
les
secte
urs,
hormi
s
entre
le
Pont
de
Bellec
ombe
et la
confl
uence
avec
la
Menoge, la présence d’un lit majeur assez large a permis à la dynamique latérale de la rivière de
s’exprimer jusqu’aux années 1950. Le lit mineur (bande active) avait lui-même une largeur
importante (plusieurs centaines de mètres parfois). Les peuplements étaient régulièrement
renouvelés et la nappe d’accompagnement était probablement assez haute. Les extractions de
matériaux réalisées massivement à partir des années 1950 ont eu de nombreuses conséquences
sur la distribution des habitats forestiers :
DH 91EO
DH 3240
DH 9160
Saussaie
préalpine
Galerie d’aulnes blancs
Chênaie
pédonculée
Chênaie
charmaie
Galerie de
saules
blancs
Habitat
d’intérêt
Type
d’habitat
s
hautes eaux : crue
décennale
nappe
d’accompagnement
Figure 1. Distribution des habitats forestiers sur les bords d’Arve.

Diagnostic écologique du périmètre d’étude Natura 2000 « Moyenne vallée de l’Arve »
Synthèse des inventaires – janvier 2011
5
le lit mineur s’est rétréci et a été colonisé par une végétation pionnière (saulaie-aulnaie). La
majorité des peuplements alluviaux actuels (91EO) se sont ainsi développés dans l’enveloppe de
la bande active des années 1930.
l’enfoncement du lit a provoqué une influence beaucoup plus faible des crues sur la dynamique
de renouvellement des peuplements, sur la fréquence des débordements, ainsi que sur le niveau
de la nappe d’accompagnement. A signaler néanmoins que l’abaissement de la nappe est
quelque peu gommé par le régime nival ou pluvio-nival de l’Arve, qui implique des hautes eaux
en période de végétation.
de nombreuses ballastières ont été créées et ont été colonisées sur les berges par une
végétation pionnière. Certaines ont été comblées par des crues de l’Arve et colonisées ensuite
par une végétation spécifique (saulaie blanche essentiellement).
Les transformations des abords de l’Arve entraînent aujourd’hui des phénomènes de
dépérissement de l’aulne blanc associés à une régénération importante de frêne. Les peuplements
de bois tendre, habitats d’intérêt communautaire prioritaire (91EO) semblent ainsi subir une
évolution progressive vers des peuplements de bois durs (frênaie), de bien moindre intérêt
patrimonial.
Remarques : la distinction entre la forêt de frêne et d’aulne présentant un stade plutôt mature
caractérisé par la quasi absence des espèces à bois tendre, et la chênaie charmaie peut s’avérer
parfois difficile. De surcroît cette distinction est rendue encore plus difficile du fait que le
caractère inondable de certaines forêts a progressivement disparu pour les raisons évoquées
précédemment.
I.1.2. Détail des habitats forestiers relevés sur le périmètre d’étude
Code Corine
Biotope
Code
Directive
Habitat
Intitulé
Surface
La notion d’état de conservation apparue avec la Directive Habitats doit permettre de rendre compte
de «l’état de santé» des habitats. Il est défini, par la directive, comme «l’effet de l’ensemble des
influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent
affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long
terme de ses espèces typiques ». L’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers doit
non seulement permettre, dans le cadre des Documents d’objectifs, de programmer des actions de
gestion ou de restauration qui visent au maintien ou au rétablissement vers un état de conservation
équivalent ou meilleur, mais aussi d’évaluer sur l’ensemble du site NATURA 2000 l’efficacité des
mesures mises en place.
Une méthodologie visant à étudier l’état de conservation des habitats forestiers a été proposée
récemment (Nathalie CARNINO méthode d’évaluation des habitats forestiers SPN / ONF – 2009). Celle
- ci nécessite des investigations de terrain assez importantes et n’a, par conséquent, pas pu être
mise en place sur le site. Nous avons toutefois pris en compte certains éléments mentionnés dans cet
ouvrage qui caractérise l’état de conservation des habitats.
Pour les renseigner nous nous sommes appuyés sur les résultats de placettes que nous avions mises
en place en 2006 dans le cadre d’un projet LIFE sur l’ étude de la forêt alluviale de l’Arve. Certaines
d’entre elles ont en effet pu être rattachées aux principaux habitats forestiers d’intérêt
communautaire présents sur le site. La densité des placettes est évidemment statistiquement
insuffisante. Les informations énoncées n’ont donc pas une valeur scientifique mais sont à considérer
à dire d’expert. Ces informations s’appuient également sur les observations qui ont pu être faites en
2010 à l’occasion de la réalisation de la cartographie des habitats.
A propos de l’état de conservation des habitats forestiers
(confère annexe 1)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
1
/
71
100%