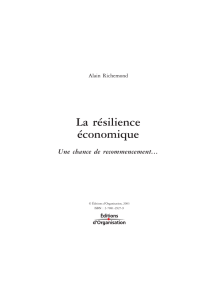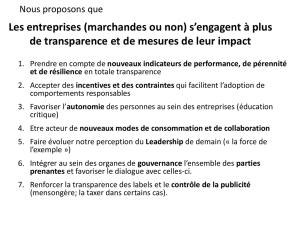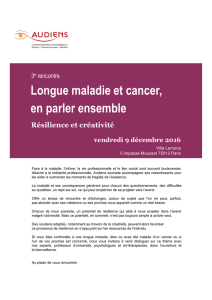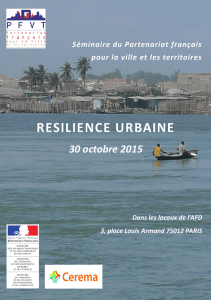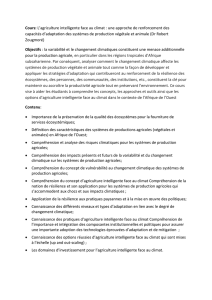Texte de la conférence

1

2
Les Lundis de l’IHedn
Lundi 7 novembre 2011
« Philosophie de la résilience et Esprit de défense »
Monique Castillo
La résilience, en tant que phénomène psychologique, désigne la capacité de « récupérer » après
un drame ou un choc traumatisant. Le terme « résilience » suppose une analogie avec la
capacité d’un métal de reprendre sa forme initiale après déformation. C’est un concept
voyageur puisqu’il s’importe dans le domaine de l’écologie (on pense à des modes de culture
restauratrice de fécondité ou garante de durabilité) ou de la santé et qu’il gagne aujourd’hui le
domaine de la défense nationale. Il faut d’abord éviter d’en faire un concept magique qui serait
la solution à tous les types de crises ou un concept-star qui servirait une nouvelle langue de bois
ou un nouveau snobisme.
La question qui nous intéresse est celle de savoir comment une théorie de la résilience peut
avoir des effets pratiques sur l’esprit de défense.
Dans une première partie, on ira de la psychologie à la philosophie et on verra que la résilience
repose sur certaine une philosophie de la vie et de la force. Pour en cerner le sens, je partirai de
deux types d’expérience, l’une empruntée à la psychologie et l’autre à la pédagogie, de
manière à en extraire la philosophie qui permet de comprendre son lien avec l’esprit de défense
et la communauté nationale.
Dans une deuxième partie, on verra comment l’esprit de défense suppose un besoin de savoir,
un modèle positif d’action et la capacité de s’inscrire dans la culture publique.
*
De la résilience à la vie
Commençons donc par aller de la résilience à la vie
Deux exemples
« Un enfant qui a vécu des choses très douloureuses est plus fort qu’un autre s’il peut se servir
de cette expérience pour s’assumer » écrit Françoise Dolto
1
. Cette formule fait de la résilience
le propre de la vie : la vie surpasse les dangers, encaisse les coups, surmonte les séparations,
1
Françoise Dolto, Andrée Ruffo, L’enfant, le juge et la psychanalyse, Gallimard, Entretiens, 1999, p. 103.

3
résiste aux déchirements. Les solutions cherchées dans les illusions, la fuite en avant ou le refus
de la réalité sont le contraire de la santé psychique. La santé comme résistance aux chocs ne
consiste pas à se maintenir dans l’assistance ou la dépendance, dans une sécurité surprotégée ;
mais à trouver soi-même sa voie, à s’ouvrir à l’avenir. Dolto va jusqu’à faire un parallèle entre
le surmontement des crises et la résurrection au sens religieux et spirituel : « cet ‘éveil’ ou cette
résurrection de l'être vivant après la séparation de son placenta est une image de ce qu'est après
la mort d'un mode de vie connu la résurrection de l'être de désir que je suis, que nous sommes
tous. Après la perte de qui nous paraît indispensable pour vivre et qui est laissé à la corruption,
nous naissons à une nouvelle connaissance d’un vivre, impensable auparavant.
2
».
L’autre expérience de la résilience « appliquée », si l’on ose dire, est la pédagogie. Là encore, il
faut éviter l’erreur de croire que la réussite consiste à éviter l’échec, et il vaut mieux
promouvoir une éthique de la résilience qui consiste à surmonter l’échec. Le danger
compassionnaliste est d’offrir à un élève en difficulté une exclusion en version douce, portée
par une bienveillance qui le cantonne, parce qu’il est malchanceux, dans le camp des
marginaux qui sont, certes, reconnus et respectés, mais, pour ainsi dire, institutionnellement
installés dans un déclassement définitif en tant que victimes prévisibles d’un échec scolaire
anticipé. A cette égalisation dans la marginalité, l’élève préfèrera sûrement une égalité de
participation à des projets de sens dont la tâche de l’école est de lui en donner la force. Force
contre violence : voilà la résilience. Même si cela paraît paradoxal et choquant, il est salutaire
qu’un élève en difficulté puisse faire de sa difficulté même une force, quand on ne l’incite pas à
en faire sa faiblesse. Telle serait l’éthique de la résilience : fais de ton malheur une force,
transforme la malchance en chance. N’est-ce pas un peu la leçon de Machiavel, pour qui
provoquer la fortune, changer la fortune à son avantage est la marque de la virtú, ce qui peut
s’appliquer à la compétence d’un chef militaire aussi bien qu’à la sagesse d’un chef d’Etat ?
Une certaine philosophie de la vie
Ces deux exemples montrent que la résilience suppose une certaine philosophie de la vie. Que
la vraie vie n’est pas celle qui se préserve de la souffrance et du négatif, mais celle qui la
surmonte. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il faille faire l’apologie de la souffrance au
nom d’une quelconque idéologie barbare ; il s’agit de prendre en compte l’inévitabilité de la
souffrance, parce que la séparation, la maladie et la mort restent la marquent de notre finitude.
Mais la résilience suppose que l’on choisisse entre deux philosophies de la vie. Nous cultivons
2
Françoise Dolto, G. Sévérin, L’évangile au risque de la psychanalyse, Points, 1977, tome II, p. 165.

4
de deux manières l’art de nous maintenir en vie. La plus ordinaire est de viser la sécurité, la
stabilité. Nous nous protégeons des dangers et cherchons à prévoir des lendemains plus sûrs.
C’est l’intelligence
3
qui se consacre à cette tâche : elle nous fait ingénieurs, médecins, soldats,
mathématiciens et physiciens. L’intelligence organise le monde en fonction de nos besoins, elle
adapte notre langage aux nécessités du travail, elle réduit notre expérience à des cadres
habituels, connaissables, maîtrisables. C’est à cette condition qu’elle nous rassure : elle fixe
notre compréhension du réel dans des cadres mécaniques et installe notre action dans les limites
sécurisées de l’utile.
Mais la vie s’éteindrait si elle devait se borner tout entière à ce travail de réduction d’elle-
même. C’est comme si l’on voulait supprimer la vie pour éviter le danger de vivre. Il faut
qu’existe une autre dimension de la vie pour nous protéger des menaces sécuritaires, il faut une
autre vie que celle qui se protège, qui se clôt et qui s’arrête ; une autre vie que celle que nous
fabrique l’intelligence : il faut la vitalité même de la vie, c’est-à-dire la vie qui se crée elle-
même, la vie qui s’invente, la vie qui procède par transformations ininterrompues. Cette
philosophie de la vie fait de la résilience bien plus qu’une capacité de résister, une capacité de
se reconstruire.
Une éthique ?
Peut-on imaginer une éthique de la résilience ? On peut essayer. Pour ma part, je tends à
chercher dans la générosité, comprise dans un sens interactif, une base possible pour une
éthique de la résilience. Il faut d’abord distinguer entre la générosité et la pitié. La générosité
est une puissance d’être. On peut être gentil, attentionné et parfaitement honnête sans être pour
autant généreux. Dans un individu généreux, le don est puissance d’être comme un
débordement d’être.
La générosité n’est pas la compassion ni la complaisance, elle ne maintient pas l’autre
dans l’assistance ou la dépendance, elle l’ouvre à la vitalité de la vie. Un philosophe, Bergson,
a pu penser que le mobile naturel de l’homme n’est pas l’égoïsme, mais la générosité comme
philosophie héroïque, « celle des magnanimes, des forts, des généreux (…) celle des âmes
véritablement royales, nées pour le monde entier et non pour elles, restées fidèles à l’impulsion
originaire, accordées à l’unisson de la note fondamentale de l’univers qui est une note de
générosité et d’amour. »
4
3
Nous évoquons ici la philosophie de Bergson.
4
In La Pensée et le mouvant,

5
Cette formule confère à la générosité une dimension cosmique : comme forme de l’amour
et comme expression de la créativité même de la vie. Ainsi, la générosité se trouve apparentée
au génie même de la vitalité créatrice, à « la nouveauté sans cesse renaissante, la mouvante
originalité des choses »
5
. Associer la générosité à la vie, c’est comprendre que la générosité
n’est pas une simple posture morale, qu’elle n’est en rien le résultat d’un effort contre-nature,
qu’elle n’est ni faiblesse ni compassionnalisme ni victimisme, mais qu’elle est une création
d’énergie vitale qui porte la vie au-delà d’elle-même, au-delà des conventions et des calculs. Si
nos valeurs n’étaient pas périodiquement réinventées par des êtres d’exception qui les recréent
comme modèles d’action par inspiration, elles deviendraient des conventions figées et vides de
sens. En résumé, la générosité est ce qui communique à autrui le pouvoir de pouvoir, la
« capabilité », c’est-à-dire la puissance de vouloir, de commencer etc. Parce que le don suscite
le contre-don, la générosité est une action créatrice de puissance d’agir.
La résilience est donc un état d’esprit qui associe la vie à l’action et qui regarde les défis
comme ce qui provoque l’action au lieu de les décourager. Tel problème, par exemple, sera
perçu comme un échec par un esprit découragé, passif ou paresseux ; mais il sera vu comme
une occasion de créer une solution et d’ouvrir de nouveaux chemins par un esprit inspiré par la
résilience. Un esprit combattant est évidemment porteur de résilience, mais le goût de
l’invention et de la création en est une autre version tout comme l’art de traiter les changements
qui marquent l’existence comme nouvelle chance de vie.
Une éthique appliquée ?
Mais on ne peut en rester à une simple pensée de la résilience ; il faut aussi se demander
comment cette philosophie peut s’appliquer et faire ses preuves dans la réalité.
Comment passer de la résilience comme expérience subjective à la résilience comme besoin
collectif ? Peut-on imaginer ce que peut être une culture de la résilience qui s’associerait à l’esprit
de défense au sein de la communauté nationale. ?
La résilience repose, pour une communauté donnée, sur la volonté de rester ensemble, de
continuer à vivre ensemble. Il lui faut des motifs qui prennent la forme d'une disposition qui
conjugue une énergie psychique (à base de confiance), une énergie morale (à base d'altruisme)
et une énergie sociale (à base de solidarité). Traditionnellement, le patriotisme est cette
5
Bergson, La Pensée et le mouvant, Puf, 1966, p. 146.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%