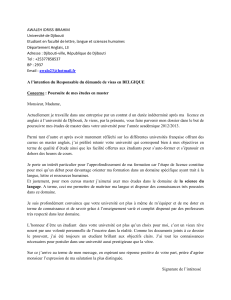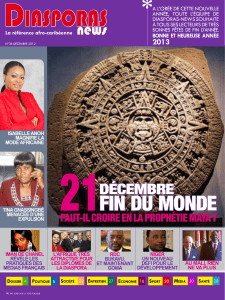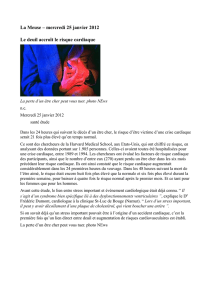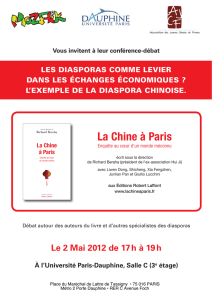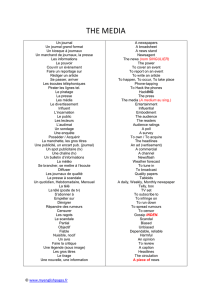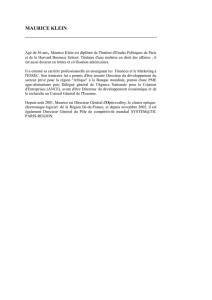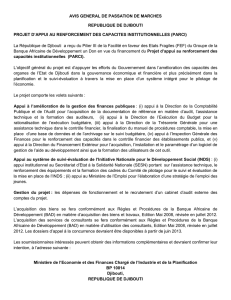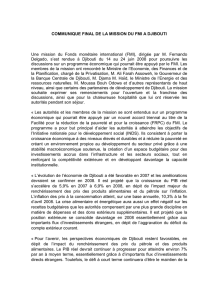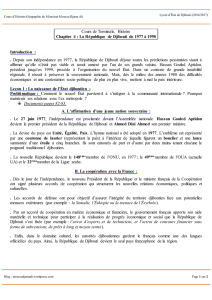2010 : 50 aNs d`iNdépeNdaNce, uN soMMet pour uN Nouveau

Gratuit
La référence afro-caribéenne
Ne pas jeter sur la voie publique
Po l i t i q u e 4d o s s i e r 22 c u l t u r e 24
so c i é t é 20
in v i t é d u m o i s 14
Di a s p o r a s
news
N°7
Mai 2010
2010 :50 ANS D'INDÉPENDANCE, UN
SOMMET POUR UN NOUVEAU DÉPART ?
DJIBOUTI : LA PLUS
GRANDE BASE AÉRO-
NAVALE MULTINATIO-
NALE DU MONDE
CÔTE D'IVOIRE :
la P a i x o u l a g u e r r e
à t o u t P r i x
SÉNÉGAL :
le s o P i f ê t e s e s d i x
Bo u g i e s !
INVITÉ DU MOIS :
LE CONGOLAIS
Ma u r i c e Ng u e s s o
MAROC :
UNE VIE POLITIQUE
MAL EN POINT

Edito
On est subjugué par les discours dis-
cordants des dirigeants des pays
africains qui commémorent au cours
de l’année 2010, le 50ème anni-
versaire de leur indépendance et aussi l’attitude
jugée paternaliste voire néocolonialiste de la
France vis-à-vis de ses ex-colonies. On voit se re-
produire devant nous, dans un contexte évidem-
ment anachronique, les deux dernières années qui
ont précédé la décolonisation des pays africains.
On se souvient qu’en 1958, face à la pression des
élites africaines, le général de Gaulle, ragaillardi
par la libération de la France et la victoire des al-
liés sur les Nazi, avait jeté comme un pavé dans la
mare, deux alternatives. L’une à laquelle il s’était
résolument engagé, défendant l’idée d’une Com-
munauté d’ailleurs inscrite dans la Constitution de
la Ve République. Celle-ci était synonyme d’une in-
féodation des colonies à la France, portée par le
député Félix Houphouët Boigny de Côte d’Ivoire
et ses amis de la RDA (Rassemblement démocrati-
que africain), et à l’opposé, l’alternative d’une in-
dépendance immédiate ayant pour conséquence
la rupture de tout accord de coopération avec la
Métropole que seule la Guinée de Sékou Touré
avait courageusement choisie.
50 ans après ces événements, l’histoire semble
se répéter à quelques degrés près. La France de
Nicolas Sarkozy a décidé, depuis le début de
l’année 2010, de commémorer dans une certaine
mesure ce cinquantenaire sur son territoire en in-
vitant ses ex-colonies à sa fête nationale du 14
juillet prochain. Et pour la première fois, des trou-
pes militaires africaines sont conviées à déler sur
les Champ Élysées.
L’idée est certes séduisante mais elle n’est pas
approuvée par la quasi-totalité des ex-colonies.
Ceux qui ont accepté l’invitation de Sarkozy en
protent pour revendiquer des actifs. C’est le cas
du Sénégal et du Burkina Faso. Le premier pays
cité a, à l’occasion de la commémoration de ses
50 ans d’indépendance, décidé de s’approprier
la base militaire française basée à Dakar. Quant
au second, il réclame la quasi-totalité des archives
détenues par la France sur son histoire coloniale.
Situation comparable aux revendications des élites
africaines qui, tout en étant favorables au projet
de la Communauté de Gaule, avaient demandé
plus d’autonomie face à une Métropole voulant
conserver l'essentiel de ses prérogatives dans les
domaines de la défense, de la diplomatie, de la
monnaie, du commerce extérieur (…)
Seule la Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo a dé-
cliné l’invitation de Nicolas Sarkozy comme Sékou
Touré l’avait fait, 52 ans avant, au Général de
Gaule. Ironie du sort d’une Côte d’Ivoire pré-
sentée jadis comme le pays le plus réceptif aux
propositions françaises en matière de coopération
avec ses ex-colonies. La question est de savoir si
ce pays va subir les mêmes conséquences que la
Guinée en son temps ? Loin s’en faut du fait que
le contexte n’est plus le même. Cependant, la na-
ture des rapports entre les dirigeants français et
ivoiriens ne sera plus jamais pareille comme par
le passé.
Au demeurant, la commémoration du cinquantenai-
re des pays africains concernés, sonne en quelque
sorte le glas aux prérogatives de la France dans
son ancien pré carré. La seconde indépendance
revendiquée par les ex-colonies n’est plus politi-
que même si elles restent toujours sous inuence
des réseaux françafrique, mais plutôt économique,
diplomatique, culturelle (…)
Pour ces pays, à court terme, il n’est plus ques-
tion que leurs monnaies continuent d’être arrimées
sur l’ancien franc français et insatiablement gé-
rées par la Banque de France. Pas plus que la
présence des bases militaires françaises sur leur
territoire, perçue comme une occupation. D’où leur
souhait de voir expressément la promesse de ré-
vision des accords de défense de Nicolas Sarkozy
se traduire en acte concret avant la n de son
quinquennat.
Au plan de la coopération, les ex-colonies ne veu-
lent plus être redevables à vie à la France qui voit
d’un mauvais œil la présence de nouvelles puis-
sances économiques s’implanter sur leur territoire.
Surtout dans le contexte de mondialisation où la
diversication des partenaires et le libre échange
doivent guider toute politique de développement
de tout pays souverain.
Au plan diplomatique, ces pays ne veulent plus
que l’on continue de les infantiliser en décidant à
leur place aux Nations Unies. Ils veulent avoir droit
au chapitre au Conseil de sécurité et un pouvoir
de décision, ne serait-ce qu’à travers des repré-
sentants issus du continent.
Les dés à relever sont si nombreux que tous ont
parié sur les cinquante années à venir pour s’af-
franchir dénitivement de la France, rattraper
leur grand retard de développement sur les pays
émergeants et principalement d’Asie.
Rendez-vous est donc pris dans 50 ans. L’on verra
bien le visage que présenteront ces ex-colonies
françaises. Qui vivra verra !
Clément Yao
Di a s p o r a s
News
NUMÉRO 7 DE MAI 2010
DIASPORAS-NEWS
ÉDITÉ PAR DCS GROUP
AGENCE DE COMMUNICATION EN RELA-
TIONS PUBLIQUES ET SERVICES
39, RUE FÉLIX FAURE 92700 COLOMBES
TEL: 09 50 78 43 66
06 34 56 53 57
FAX : 09 55 78 43 66
DIRECTEUR DE PUBLICATION
THOMAS DE MESSE ZINSOU
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :
KARIM WALLY
CLEMENT YAO
JAMES NGUMBU
ALEX ZAKA
MAUD OYABI
LAMINE THIAM
SÉBASTIEN BEQUEREL
LUCIEN HOUNKANLI
PROMOTION - MARKETING - PUBLICITÉ
COURA SENE
CONTACT PUBLICITÉ
06 34 56 53 57
DIRECTION ARTISTIQUE
CRISTÈLE KARMEN DANDJOA
DÉVELOPPEMENT RÉGION RHÔNE-ALPES
DIEUDONNÉ SOME WENS
DÉVELOPPEMENT RHÔNE
VALENTIN SIKELY
DÉVELOPPEMENT DE L’HÉRAULT
BENJAMIN AKA
DÉVELOPPEMENT HAUTE GARONNE
JÉRÔME M’BOUA
EQUIPE COMMERCIALE
ORNELLA MALLET, JEAN MARIE OULAI DE
VIANNEY
CISSÉ SINDOU, MOUSSA DIOMANDE
IMPRESSION : EN FRANCE
ISSN : 2105-3928
LE CINQUANTENAIRE OU LE DÉBUT D’UNE SECON-
DE INDÉPENDANCE DES EX-COLONIES FRANÇAISES

Politique
4
Di a s p o r a s
Ne w s
5
Di a s p o r a s
Ne w s
LE SORT DU CONTINENT AFRICAIN
S’EST-IL JOUÉ À LA FIN DU 19ÈME
SIÈCLE ?
Titre prémonitoire de René Dumont : « l’Afri-
que noire est mal partie » ; dès 1962 c’est-
à-dire quelques années seulement après l’In-
dépendance, ce livre dénonçait la persistance
des structures héritées de la colonisation. La
Françafrique, néologisme datant de 1955
dont la paternité revient à Félix Houphouët-
Boigny, caractérise les bonnes relations avec
la puissance colonisatrice. Aujourd’hui, cette
expression a une connotation péjorative ; elle
dénit l’ensemble des réseaux d’inuence po-
litique, économique mais aussi de groupes de
lobbies en Afrique et en France, avec pour
objectif : la perpétuation du système d’ex-
ploitation économique du continent.
ACTE I : LA CONFÉRENCE DE BERLIN EN
NOVEMBRE 1884
Jusqu’au milieu du 19ème siècle, les euro-
péens se contentaient d’établir des comptoirs
commerciaux pour exporter les ressources na-
turelles de l’Afrique. Mais à partir de 1875,
leurs explorations s’enfoncent de plus en plus
à l’intérieur du continent où ils découvriront
le potentiel que regorgent le sous-sol et les
vastes supercies de terres arables. Et les
désaccords pour cause d’empiètement sur les
territoires des uns et des autres commencent
alors à poindre et créent des tensions entre
les différentes puissances. La conférence de
Berlin n’a d’autre motif que d’édicter de nou-
velles règles d’occupations des côtes de l’Afri-
que même si l’Allemagne de Bismarck, puis-
sance invitante, afche d’entrée des objectifs
plus larges : le désenclavement du continent
africain ou l'éradication de l'esclavage et de
la traite musulmane. Tandis que la France et
le Portugal sont sur une autre perspective : ils
conçoivent les territoires acquis comme un mo-
nopole commercial.
La Conférence de Berlin, du 15 novembre
1884 au 23 février 1885 a été déterminante
mais pas décisive sur le destin de l’Afrique. Au
bout de trois mois de conclave, les représen-
tants des 14 pays participants signent l’Acte
général de cette Conférence. Il proclame la
liberté de navigation sur les grands euves
africains, le Niger et le Congo. Il arrête aussi
quelques principes humanitaires contre la
traite des esclaves ainsi que le commerce de
l'alcool et des armes à feu
ACTE II : LES TRAITÉS BILATÉRAUX ET LES
PROTECTORATS
La Conférence de Berlin n’a fait qu’entéri-
ner les règles de partage entre puissances
coloniales mais la délimitation dénitive des
territoires se sont fait au gré d’accords bila-
téraux et de tensions extrêmes qui faillirent
provoquer une guerre entre l’Angleterre et la
France au Soudan en 1898 (la crise de Fa-
choda).
La France entamera sa conquête coloniale
d’abord sous forme de protectorat pour bas-
culer ensuite vers une annexion totale de leurs
possessions. La politique expansionniste fran-
çaise est mue par deux moteurs : d’une part,
l’armée française, humiliée par la perte de
l’Alsace-Lorraine en 1870, veut redorer son
blason ; d’autre part, l’Europe toute entière
est en crise ; ceci impose la recherche de nou-
veaux débouchés économiques ou de ressour-
ces naturelles.
ACTE III : L’IMPACT DES DEUX GUERRES
MONDIALES
L’Afrique a été pillée de ses ressources mais
a également payé un lourd tribut au cours
des deux Guerres Mondiales. Dès l’entrée
en guerre de la France en 1914, le Général
Charles Mangin décida d’engager des sol-
dats issus des colonies. Ainsi environ 200.000
contingents africains ont été envoyés au front
pour défendre la « mère-patrie » ; 70.000
d’entre eux ont péri au combat. En 1940, au
début de la seconde Guerre Mondiale, plus
de 180.000 « tirailleurs » ont été enrôlés.
Quelques mois avant le débarquement des
forces alliées en Normandie, le Général De
Gaulle organisa la Conférence de Brazzaville
le 30 janvier 1944. C’est une reconnaissance
de l’effort consenti par l’Empire colonial et la
nécessité de poursuivre ce sacrice. Mais c’est
surtout pour la France, que la Seconde Guerre
Mondiale induira une profonde mutation des
structures coloniales. En d’autres termes, c’est
une forme d’anticipation pour éviter les erreurs
commises au lendemain de la Grande Guer-
re. Le Traité de Versailles de 1918 stipule le «
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes…
» Mais la France l’a superbement ignoré. Ce
qui, à l’époque, engendrera un fort relent de
nationalisme et de mouvements d’émancipa-
tion dans les colonies. En effet, les leaders
de mouvements insurrectionnels sont pour la
plupart des anciens combattants démobilisés,
plus au fait des réalités métropolitaines. Cette
fameuse Conférence de Brazzaville a accou-
ché de quelques recommandations qui étaient
censées améliorer la situation des colonies et
des colonisés mais « toute idée d’autonomie,
toute possibilité d’évolution hors du bloc fran-
çais de l’Empire » étaient écartées.
LA 4ÈME RÉPUBLIQUE ET LES GUER-
RES DE DÉCOLONISATION
Le 8 mai 1945, jour de l’armistice, une mani-
festation de partis nationalistes algériens est
violemment réprimée à Sétif faisant 45.000
victimes. En 1947, le Général Leclerc, Com-
mandant en chef de la Deuxième Division
Blindée, partie de Koufra (Lybie) pour libé-
rer la France, demande à cette dernière de
s’acquitter de sa dette d’honneur auprès des
colonies. Cette année-là, un corps expédi-
tionnaire de 30.000 hommes arriva à bout
du soulèvement malgache en 21 mois. Cette
insurrection noyée dans un bain de sang se
soldera par au moins 45.000 morts et autant
de victimes collatérales dues à la famine et à
Fr a N ç a F r i q u e
partenariat ? Seule la Guinée exigea une
Indépendance totale et immédiate. Lors de
sa tournée d’explication dans les colonies,
l’étape de Conakry fut très mouvementée. Le
Général avait été hué par la foule que Sékou
Touré avait manipulée à telle enseigne qu’il
en oublia son képi. Avant d’embarquer dans
l’avion du retour, De Gaulle s’est fendu d’un
« Au revoir la Guinée !» et lui fera payer cet
affront.
Conformément à la Loi Cadre, plusieurs réfor-
mes sont engagées. Des élections au suffrage
universel, pour la mise en place de Conseil du
gouvernement, ont eu lieu dans les colonies en
1957. C’est un pouvoir exécutif local présidé
par un français qui a assuré progressivement
le transfert des compétences et les passa-
tions de pouvoir. Les premiers Présidents de
la République sont pour la plupart des Vice-
présidents de ce Conseil. Leur prol : repérés
parmi les intellectuels ou encartés au sein de
la SFIO (l’ancêtre du parti Socialiste) voire
ayant déjà siégé comme Députés lors de l’As-
semblée Constituante de 1946, ce sont des
hommes dignes de conance pour la France.
Plusieurs signes indiquent que la France ne
voulait pas se séparer de son empire colonial
alors qu’aux Nations-Unies, cette situation pa-
raît pour le moins intenable face aux injonc-
tions américaines et soviétiques. Qui plus est,
la Grande Bretagne a entamé son processus
de décolonisation depuis 1948.
LA VAGUE D’INDÉPENDANCE
C’est ainsi que les pays africains francopho-
nes accéderont à leur indépendance en 1960.
L’Algérie, colonisée depuis 1834, n’obtiendra
la sienne que deux ans plus tard. Les ancien-
nes colonies sont arrimées à la mère patrie
par plusieurs engagements : les accords de
coopération se devaient de préserver, autant
que faire se peut, les intérêts économiques de
la France comme l’exclusivité de l’exploitation
des ressources naturelles. Ensuite, la présen-
ce de ses comptoirs commerciaux lui permet
d’avoir des débouchés pour ses produits nis.
Et la création de la Zone Franc garantie une
convertibilité sur le marché des devises du
Franc CFA. En contrepartie, elle occulte toute
souveraineté monétaire des pays membres.
Les accords de défense, signés au lendemain
la maladie.
En 1954, deux évènements majeurs ont ra-
dicalement changé la position des autorités
françaises pour accélérer le processus de dé-
colonisation : la Guerre d’Algérie déclenchée
par le FNL et la défaite française en Indo-
chine. Le Général Giap et ses Viêt Minh ini-
gèrent une humiliation aux troupes coloniales
dans la cuvette de Diên Biên Phu. Vaincue,
la France est obligée de s’asseoir à la table
des négociations. Les accords de Genève re-
connaîtront le partage du Viêt-Nam en deux
Etats. Pierre Mendès France, éphémère Prési-
dent du Conseil de la 4ème République en-
gagera dans la foulée des pourparlers avec
la Tunisie qui obtiendra son Indépendance en
1956 ; de même que le Maroc. Pour l’Afrique
noire francophone, une certaine autonomie se
dessine sous le gouvernement de Guy Mollet
impulsée par la Loi Cadre de Gaston Defer-
re, Ministre de l’Outre-mer.
LE RETOUR DU GÉNÉRAL DE
GAULLE
Le Général De Gaulle revient au pouvoir en
1958. Le conit algérien a eu raison de la
4ème République. Il proposera une nouvelle
Constitution par voie référendaire ; étant en-
tendu que le sort des colonies faisait égale-
ment partie du choix. C’est ainsi qu’il formula
la proposition suivante : l’Indépendance inté-
grale ou une Indépendance en restant dans
la Communauté française, une sorte d’union-
de l’indépendance,
ont été les plus
néfastes pour les
africains. Non seu-
lement, ils conte-
naient une compo-
sante commerciale
: des minerais stra-
tégiques sont
classiés lorsqu’il
s’agit de matières
premières prota-
bles à la France et
donc vendus exclu-
sivement à celle-ci.
Outre l’installation
de bases militaires
françaises, il existe
une clause secrète
qui permettait à la France de défendre les
régimes africains « amis ».
De citoyen de seconde ordre, le peuple du
continent a vite compris qu’il n’a pas son destin
en main ; l’ex-colonisateur exerce un contrôle
politique, économique et militaire avec parfois
la complicité et la turpitude de ses propres
dirigeants. Au lendemain de la proclamation
de l’indépendance, toute velléité d’émancipa-
tion était perçue comme une sorte de trahison
par les colonisateurs. Patrice Lumumba qui a
dénoncé les abus de la Belgique fut mis hors
d’état de nuire. Le ghanéen Kwame Nkrumah,
chantre du panafricanisme et ayant choisi la
voie socialiste, a été débarqué par les anglais
avant la n de son mandat en 1966. La Fran-
ce veille sur son pré-carré ; les Chefs d’Etats
qui voulaient dénoncer cette forme de néo-
colonialisme ne sont pas restés très longtemps
au pouvoir et furent remplacés.
Le Général de Gaulle, père de l’Indépen-
dance des pays africains, est un totem que
nul n’ose remettre en cause, même encore
aujourd’hui, la responsabilité dans la perpé-
tuation de cet empire colonial et ses effets
pervers. Jacques Foccart, Monsieur « Afrique
» à l’Elysée, instigateur de nombreuses conspi-
rations, faiseur de rois, voyait à chaque n de
journée le Général de Gaulle pour rendre
des comptes. Comment pourrait-il ne pas être
au courant ?
Alex ZAKA
Les commémorations d’un demi- siècle d’Indépendance se
succèdent sur le continent noir. La France, ancienne puissance
coloniale, donne rendez-vous à l’Afrique : Sommet des chefs
pays sur les Champs-Elysées le 14 juillet. Diaspora News
aura l’occasion de vous en informer.
dernier imprimeur

Politique
6
Di a s p o r a s
Ne w s
7
Di a s p o r a s
Ne w s
GENÈSE D’UNE RÉPUBLIQUE DE
23.000 KM²
Pendant des millénaires les côtes d’Afrique
australe servaient de comptoirs commerciaux
aux marchands de la péninsule arabique.
Elles étaient relativement épargnées par les
conquêtes maritimes que se livraient les euro-
péens jusqu’au 15ème siècle ; les portugais
ont installé leurs escales tout au long du canal
de Mozambique mais se sont limités au port
de Mombasa avant de mettre le cap vers
l’Inde. Au 19 ème siècle, les anglais étaient les
seuls européens à occuper les deux rives du
Golfe d’Aden plus précisément dans le port
de Zeila, géographiquement situé en Soma-
lie aujourd’hui. C’est une zone de transit de
marchandises que transportaient des carava-
niers en provenance d’Abyssinie. C’est à cette
époque que la France cherchait à établir une
base commerciale dans cette région. En 1862,
elle signa un traité de cession du mouillage
d’Obock avec les sultans Afars de Raheita.
L’ouverture en 1869 du canal de Suez chan-
gea à jamais le destin de la corne d’Afrique.
La mer Rouge et la Méditerranée sont désor-
mais reliées , ce qui signie un gain de temps
substantiel pour les échanges commerciaux
entre l’Europe et l’Asie.
La recherche de débouchés et un lieu d’escale
de ravitaillement pour les navires français pour
le Tonkin et l’Océan Indien incitèrent la France
à s’installer durablement dans cette région.
Elle s’effectua en plusieurs phases : d’abord
la signature d’un protectorat en 1885 avec les
sultans Afars et Issas ; ensuite l’ouverture cinq
ans plus tard d’un port plus au sud, au Cap
Djibouti dans le golfe de Tadjourah et enn
l’installation du siège du gouverneur en 1892
dans la ville de Djibouti peuplée à peine de
1.200 âmes. Ce territoire sera baptisé Côte
française de Somalie (CFS). Son histoire colo-
niale ressemble aux autres colonies françaises
du continent noir : membre de l’Assemblée
constituante en 1946, promulgation de la Loi-
cadre en 1956, référendum constitutionnel en
1958. En 1960, tous les pays ont obtenu leur
« bon de sortie » sauf l’Algérie et Djibouti. En
1966, la foule scande « Indépendance, indé-
pendance !!! » face à un Général de Gaulle
médusé et fâché. L’organisation d’un référen-
dum l’année suivante ne changea pas grand-
chose à part le nom de CFS transformé en
Territoire Français des Afars et des Issas (TFAI).
Ce n’est qu’en 1977 que Djibouti obtint enn
son indépendance et Hassan Gouled Aptidon
devint Président de la République.
LES PREMIÈRES ANNÉES D’INDÉ-
PENDANCE
Ce pays de 850.000 habitants pour une su-
percie de 23.000 km² est gouverné comme
un sultanat. Le pouvoir est concentré entre les
mains des Issas au détriment des Afars. La dé-
limitation des frontières, tracées au moment du
protectorat, ne coïncidait nullement avec les
régions. Les Afars sont à cheval sur trois pays
différents ; l’Ethiopie et l’Erythrée et Djibouti.
Une guerre civile nit par éclater en 1991 me-
née par des rebelles Afars qui occupèrent la
moitié du territoire, obligeant ainsi le pouvoir
en place à s’engager vers une ouverture politi-
que que l’ancienne puissance coloniale appela
de ses vœux. Après trois années de conit, un
fragile cessez-le-feu clôt cet épisode tragique
et qui a valu l’expulsion hors des frontières de
18.000 Afars. Le Président Hassan Gouled
Aptidon n’ira pas au bout de son quatrième
mandat ; il transmet par décret son pouvoir à
son neveu : l’actuel Président en exercice, Is-
maël Omar Guelleh.
Malgré l’instauration du multipartisme, l’oppo-
sition est complètement atomisée par un mode
de scrutin proportionnel uninominal à un tour.
Ce sont des députés godillots qui siègent au
parlement. L’opposition a carrément boycotté
les élections législatives de 2008 pour dé-
noncer cet oukase. Aujourd’hui, Ismaël Omar
Guelleh « s’en remet à la volonté du Tout Puis-
sant, à la volonté du Peuple djiboutien » pour
briguer un troisième mandat en vue des élec-
tions présidentielles de l’année prochaine. Qui
pourrait l’en empêcher ? Les 59 députés de la
majorité présidentielle pour une assemblée de
63 élus, viennent de ratier à l’unanimité les
dizaines d’amendements susceptibles de fai-
re obstacle à cette candidature. Son dernier
discours sur le sujet est sans équivoque : « Ce
serait, pour moi, une source de erté et un im-
mense honneur de continuer à servir cette belle
Nation Djiboutienne sous quelle que forme que
ce soit ».
LES RELATIONS AVEC L’ANCIENNE
PUISSANCE COLONIALE
Pour octroyer l’indépendance en 1977, la
France a exigé et obtenu avec la République
de Djibouti des accords économiques et surtout
militaires, conformément à la tradition gaulliste
de la continuité. Dans le cadre d’un redéploie-
ment de ses forces, la France a fermé plusieurs
de ses bases militaires sur le continent. Pour
Dj i b o u t i :
Jamais État africain n’a fait l’objet de tant de prévenances par la planète entiè-
-
contre le terrorisme, lutte contre les pirates somaliens ne font que renchérir les
quasi minéral, la république djiboutienne ne
pouvait se prévaloir que d’une seule ressour-
ce. Elle vivait de la rente versée par l’ex-mé-
tropole. Les effets induits par la présence mili-
taire française représentaient la moitié du PIB
et au moins 30% des recettes budgétaires.
Surfant sur la mondialisation et la proximité
des pays du golfe arabo-persique, le TFAI
afche aujourd’hui une croissance économi-
que moyenne de 5% annuel, depuis 2003,
mais qu’il faut tout de même relativiser en
tenant compte d’une croissance démographi-
que galopante. De nouveaux acteurs écono-
miques n’hésitent plus à investir dans ce pays
où rien ne pousse mais qui possède plus de
350 km de côtes. Le gouvernement djiboutien
est plus que jamais décidé à faire de son port
une plaque tournante régionale d’échanges
de marchandises. Pour cela il en a coné la
gestion à l’Autorité des Ports de Dubaï (DPA).
Il a également lancé la construction d’un nou-
veau port en eau profonde avec un terminal à
containers de 400 ha à Doraleh.
La République de Djibouti est située géo-
graphiquement à un carrefour maritime. Son
principal atout est qu’il est le seul pays où la
présence occidentale, du fait de sa relation
séculaire avec la France, est tolérée dans une
région musulmane. Depuis les attentats des
ambassades américaines
de Nairobi et de Dar-El-
Salam en 1998 et 11 sep-
tembre 2001, les USA ont
décidé de reprendre pied
sur la corne de l’Afrique.
Echaudés par le cuisant
échec de l’opération Res-
tore Hope de 1993 en So-
malie où les cadavres de
GI’s ont été traînés dans
les rues de Mogadiscio, les
américains ont adopté une nouvelle stratégie
d’implantation. Dès 2002, George W Bush
décide de créer à Djibouti le Combined Joint
Task Force-Horn of Africa. Ils ont ainsi loué à
la France le camp Lemonier pour 30 millions
d’€uros annuels. Il servira de tête de pont pour
leur lutte contre le terrorisme en Somalie, au
Yémen en poussant jusqu’au Kenya.
Aujourd’hui la France semble devoir parta-
ger et cohabiter avec d’autres pays dans
ce qui était considéré autrefois comme son «
bac à sable ». Elle ne bénécie plus, de la
part des autorités Djiboutiennes, de relations
privilégiées. Devant tant de sollicitations, les
djiboutiens renchérissent. Ofciellement, lors
des raisons de géostratégie et les actualités
en témoignent, elle n’est pas prête à concéder
sa plus grande base à l’étranger qui compte
3.000 hommes. C’est un micro État cerné de
voisins (éthiopiens et somaliens) qui sont prêts
à tout moment à fondre sur cette proie tant
convoitée et qu’ils considèrent d’ailleurs com-
me une partie de leur terre. Chacun s’y retrou-
ve car la France dispose non seulement d’un
poste de contrôle stratégique sur une voie ma-
ritime importante où transite plus de 25% du
pétrole mondial mais également d’un centre
d’entraînement de ses troupes et aujourd’hui
un centre opérationnel pour lutter contre la pi-
raterie maritime.
Ces dix dernières années, les relations diplo-
matiques entre Djibouti et Paris se sont crispées
par l’affaire Bernard Borrel. Le magistrat
français, coopérant et rattaché au ministère
de la Justice Djiboutienne a été retrouvé sans
vie à 80 km de la Capitale, en octobre 1995.
Longtemps la thèse ofcielle a été celle du
suicide ; en tout cas c’est la version des deux
premiers juges français chargés de l’enquête.
Mais en 2000, le rapport de la brigade cri-
minelle de Paris, sous commission rogatoire du
juge remplaçant Jean-Baptiste Parlos conclut
à un assassinat. Un ancien ofcier de la garde
présidentielle, témoin-clé de l’affaire, met di-
rectement en cause le Prési-
dent Ismaël Omar Guelleh.
Il serait le commanditaire
du meurtre car ledit témoin
aurait vu cinq hommes venir
lui rendre compte de l’éli-
mination du magistrat fran-
çais. La mise en cause de
personnalités Djiboutien-
nes a irrité le pouvoir de
Djibouti qui a expulsé des
coopérants français et
fermé l’émetteur de Radio France Internatio-
nale en 2005. Aujourd’hui, la situation semble
se normaliser malgré la promesse de Nicolas
Sarkozy, fraîchement élu en 2007, de faire la
lumière sur cette affaire.
ET SI C’ÉTAIT ENFIN LE DÉCOLLAGE
ÉCONOMIQUE…
Djibouti a été longtemps victime d’un stéréo-
type : un désert en friche où des tribus noma-
des Afar et Issa élèvent des chèvres. Outre les
caravanes de sel et d’épices, de tout temps,
Djibouti fut le port de désenclavement des
produits d’exportation éthiopiens. Avec un sol
d'une visite à Djibouti le 20 janvier, le Prési-
dent Nicolas Sarkozy avait discuté avec son
homologue djiboutien d'un projet de nouvel
accord de partenariat de défense. Tout un
symbole : il y a deux semaines, dans le ca-
dre d’une manœuvre « Amitié Djibouti 2010
», le Chef d’Etat djiboutien a atterri d’un
hélicoptère sur le Tonnerre, un bâtiment de
guerre français croisant au large de Djibouti.
Malgré cette offensive de charme, l’ancienne
puissance coloniale sera quand même obligée
de renégocier ses redevances annuelles de 30
millions d’€uros pour la location de sa base
militaire.
Les ibustiers somaliens sont entrain de dé-
trôner leurs homologues du détroit de Ma-
lacca. En effet, la faillite de l’Etat de droit et
la guerre civile en Somalie ont développé un
phénomène de piraterie. Tous les navires mar-
chands naviguant dans cette zone sont mena-
cés d’être pris en otages et les pirates n’hési-
tent plus à aller de plus en plus loin ; jusqu’au
large des Seychelles. L’opération Atlante ini-
tiée par l’Union Européenne a pour objectif
de chasser les pirates de mer. Mais chaque
pays souhaite assurer la sécurité de ses pro-
pres bâtiments marchands. L’Espagne et l’Alle-
magne comptent respectivement actuellement
200 militaires sur zone. La lutte contre la pi-
raterie prend une proportion internationale
dont Djibouti devient le centre opérationnel.
Une grande première, Guido Westerwelle,
ministre allemand des Affaires étrangères a
fait le déplacement pour rencontrer le Prési-
dent Ismaël Omar Guelleh. Une dépêche de
l’AFP du 22 avril 2010 mentionne : « l'armée
japonaise a commencé à s'installer à Djibouti,
qui abrite déjà plusieurs bases étrangères, où
elle va construire un établissement permanent
pour participer à la lutte contre les pirates so-
maliens… » . Même la Chine et l’Inde sont en
pourparlers pour une implantation de part et
d’autre du Golfe d’Aden.
Alex ZAKA
DJIBOUTI, LA PLUS GRANDE BASE AÉRONA-
VALE MULTINATIONALE DU MONDE.

Politique
8
Di a s p o r a s
Ne w s
du pouvoir. Il faut une dose de pédagogie
pour expliquer profondément le travail, la
méthodologie et l’importance de la cour.
Selon Mme Sylvana Arbia, grefère de cette
juridiction : « la CPI ne juge que les person-
nes accusées des crimes les plus graves. Elle
est une cour indépendante permanente de-
vant laquelle sont jugées les personnes accu-
sées des crimes les plus graves qui touchent
la communauté internationale». Revenant
sur le fonctionnement de cette cour et de
l’inuence qu’elle subirait des grandes puis-
sances, Sylvana Arbia, renchérit ; « bien que
ses dépenses soient principalement nancées
par les contributions des États parties, la Cour
reçoit également des contributions volontaires
de gouvernements et d'autres entités. Elle n'ap-
partient pas au système des Nations et son ac-
tion est impartiale ». Ce même son de cloche
sonne du côté du bureau du procureur.
« Le procureur n’intervient pas lorsqu’une af-
faire fait l’objet d’une enquête ou de poursui-
tes dans un système judiciaire national, sauf si
ces procédures ne sont pas menées de bonne
foi, par exemple si elles ont été engagées of-
ciellement uniquement pour soustraire une
personne à sa responsabilité pénale », précise
Pascal Turlan, le conseiller du procureur.
LA CRÉATION DE LA CPI est un progrès et
une aubaine surtout pour l’Afrique, en terme
juridique.
Malheureusement, l'attitude de certaines
nations et la conduite des affaires instruites
à ce jour, ne peuvent que laisser pantois,
la communauté africaine. On a l’impression
d’être en face d’une justice qui apparaît dé-
mesurée aux yeux de l’opinion publique et
c’est difcile d’ôter cette impression surtout
aux Africains !
James Ngumbu
avril prochain. Tout se passerait comme si la
cour, surnommée «L’ENFER DES NÈGRES»
par ses détracteurs, serait déterminée à ne
poursuivre que des faibles ou des récalci-
trants à l’ordre établit.
Cette position est fermement soutenue par
le colonel Kadda et place en porte-à-faux
les 30 Etats africains ayant ratié les statuts
de la cour pénale internationale. Adversaire
déterminé de cette institution, Mouammar
Kadda, président en exercice de l'Union
Africaine (UA), considère la CPI comme un
instrument conçu par les Occidentaux pour
établir un «nouveau terrorisme mondial».
WASHINGTON, PÉKIN ET MOSCOU
Bon nombre des grands pays ont refusé
de ratier le traité de Rome. Les USA par
exemple, ont fait savoir depuis qu'ils n'ont
pas l'intention de le ratier et qu'ils ne se
considèrent plus liés d'aucune manière, aux
buts et objectifs de ce texte. C’est aussi le cas
de la Russie, de l’Inde et de la Chine qui ne
l’ont toujours pas ratié . Leur principal grief
porterait sur la compétence donnée à la
Cour de juger des ressortissants d'Etats non
parties, y compris des ofciels. Ce principe,
qu'ils estiment contraire au droit des traités,
permettrait à la Cour de poursuivre des fonc-
tionnaires ou des soldats américains, russe ou
autres. Du coup, plusieurs personnes fustigent
alors les méthodes de la CPI au rang des-
quels gurent des juristes renommés.
Cependant, au-delà de toutes les suspicions
et manoeuvres observées, la cour pénale in-
ternationale représente vraisemblablement
une alternative aux tribunaux nationaux,
dans des pays où la justice subie l’inuence
La co u r pé N a L e iN t e r N a t i o N a L e
UNE ALTERNATIVE AUX TRIBUNAUX
AFRICAINS OU UNE JUSTICE À DOUBLE
VITESSE ?
En effet, la CPI est une organisation
internationale indépendante, dont le
siège se trouve à La Haye, aux Pays
Bas. A ce jour, tous ses détenus sont
des Africains et quatre pays Etats africains
ont déferé leur situation à la cour. Parmi eux,
la RDC fournit le gros de son bataillon ex-
périmental.
Le 17 juillet 1998, la communauté interna-
tionale avait franchi un cap historique lors-
que 120 États ont adopté le statut de Rome,
fondement juridique de la création de la
Cour pénale internationale. Sur le continent
africain, plusieurs pays reprochent au procu-
reur LUIS MORENO OCAMPIO, d’appliquer
deux poids, deux mesures dans le traitement
des différentes affaires. Aux dires de nom-
breuses personnes, cela se traduit par des
contradictions ou des méthodes sélectives
utilisées par la justice internationale. Le cas
du président soudanais Oumar El-Bachir, té-
moigne aux yeux des Africains, «le mépris»
qu’a le procureur vis-à-vis de leurs chefs
d’Etats. On se rappellera que la délivran-
ce d’un mandat contre le président souda-
nais est contestée au sein même de la cour.
Dans sa décision rendue le 4 mars 2009,
la Chambre préliminaire I avait conclu que
les éléments présentés par l’accusation à
l’appui de sa requête aux ns de délivrance
d’un mandat d’arrêt contre Omar El Bashir,
ne fournissaient pas de motifs raisonnables
de croire qu’il avait une intention de détruire
les différents groupes ethniques. Pire encore,
le procès de Jean-Pierre Bemba a l’air em-
paillé. Toutes les personnes (Patassé, Meskine
etc..), citées par la cour au demeurant com-
me ses complices, tournent paisiblement sans
qu’elles ne soient inquiétées par le tribunal
de La Haye. Le procès Bemba aura lieu en
La création de la cour pénale internationale à travers la
convention de Rome, constituait une étape importante au dé-
veloppement de la justice internationale, après plusieurs an-
-
re mondiale. Mais à ce jour, qui connait son fonctionnement ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%