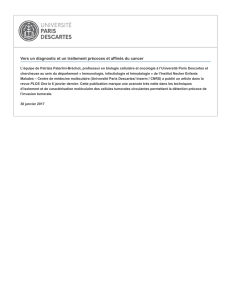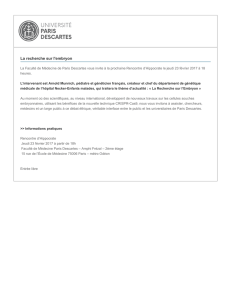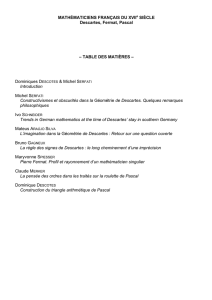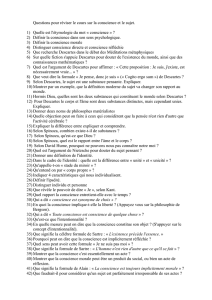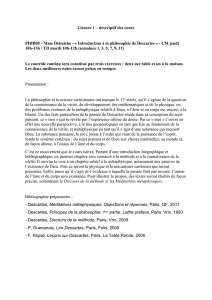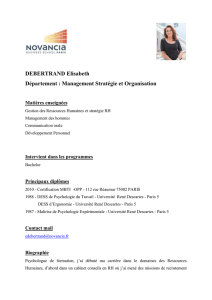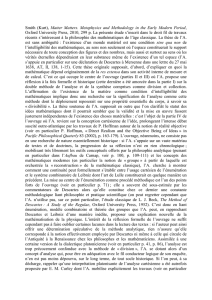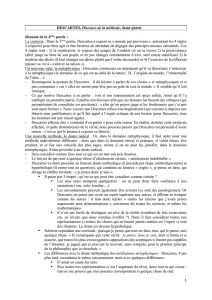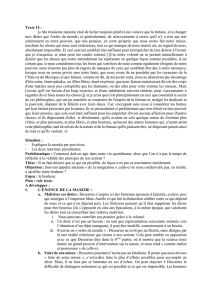DESCARTES_DM_analyse_3

PARTIE 3, DISCOURS DE LA METHODE : « En la troisième, quelques unes de la morale qu’il a tirée de cette méthode. »
Structure :
1) Une « morale par provision » : La méthode de Descartes a vocation à s’appliquer à tous les domaines du savoir mais aussi
de l’action. Mais, autant il est possible de mettre entre parenthèse tout ce qu’on sait dans le domaine des sciences, afin de
trouver des fondements certains , autant cela est impossible dans le domaine de l’action : l’homme doit continuer à agir
au quotidien. L’action impose une contrainte : celle du temps. En attendant de trouver une morale entièrement rationnelle,
dont les principes seraient absolument certains, Descartes va proposer quatre maximes « de bon sens », afin de guider
notre action en attendant.
a. Ce chapitre peut donner une impression de digression.
b. Le domaine de l’action n’a pas les mêmes exigences que le domaine théorique de la connaissance.
c. Descartes fait une comparaison avec un logement temporaire, où l’on habiterait en attendant la reconstruction
de sa maison.
d. Comme pour la méthode, Descartes donne peu de préceptes : mieux vaut peu mais bien.
e. L’opinion (en philosophie, savoir non justifié), qui est critiquée par Descartes dans le domaine des sciences, est
ici revalorisée (Descartes s’appuie ici sur l’opinion des plus sage).
f. La morale provisoire de Descartes permet d’agir bien (moralement), efficacement et d’être heureux.
2) Les quatre maximes :
a. « Obéir aux lois et aux coutumes de [son] pays », garder la religion de ses parents et n’adopter que des opinions
modérées, de façon à ne jamais être trop éloigné de la vérité si on se trompe. Il faut s’inspirer des opinions des
personnes sages.
i. Descartes affiche ici une certaine prudence. Il faut éviter les excès.
ii. Il pourrait même passer pour conformiste.
iii. Il faut se fier à ce que les gens font plutôt qu’à ce qu’ils disent (car ils ne font pas toujours ce qu’ils
disent).
iv. Cependant, il ne faut prendre ces opinions, même modérées, pour des vérités définitives.
b. « Être le plus ferme et le plus résolu en [ses] actions » : une fois une décision prise, il vaut mieux s’y tenir plutôt
que de changer de décision.
i. Cette maxime peut paraître en contradiction avec la première, qui incite à la modération. Mais ici
Descartes ne parle pas de la même chose : la 2ème maxime concerne nos décisions, et non nos opinions.
ii. Descartes, accusé de prôner une obstination inefficace, ménage néanmoins la possibilité de changer
de décision, mais à condition d’avoir de très bonnes raisons.
iii. Il vaut mieux s’en tenir à ses décisions car au moins, on sera « quelque part », et non pas perdu au
milieu de nulle part (image de la forêt) : on y verra plus clair, et on pourra prendre une meilleure
décision.
c. Changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde : il faut s’efforcer de ne désirer que ce qui est en notre pouvoir.
i. Ce qui est en notre pouvoir, ce sont nos pensées (Descartes s’inspire des philosophes stoïciens).
ii. Cela nous rend plus heureux, car nous ne nous torturons pas inutilement.
iii. Il faut que la volonté apprenne à écouter l’entendement (l’intelligence) : lorsque l’entendement lui
présente une chose comme possible, elle va naturellement vouloir cette chose, et ne pas vouloir ce qui
est impossible. Cela demande un long exercice.
d. La meilleure vie : cultiver sa raison : Descartes ajoute un dernier principe. La meilleure vie est celle qui est
consacrée à la recherche de la vérité, qui est donc un devoir.
i. Descartes affirme que sa méthode l’a rendu heureux grâce aux connaissances qu’il a acquises.
ii. Les trois maximes précédentes sont fondées sur ce désir de vérité.
iii. La raison étant un cadeau de Dieu, il de notre devoir de l’utiliser.
iv. C’est cette quête de la vérité qui permet à Descartes de contrôler ses désirs.
v. Il suffit de bien juger pour bien faire. En effet, la volonté (qui agit), choisit naturellement ce que
l’entendement lui présente être bien.
3) Après avoir découvert ces maximes, Descartes les met de côté avec les vérités religieuses (l’existence de dieu,
l’immortalité de l’âme…) dont il n’a jamais douté, et va douter de tout le reste.
a. Descartes fait attention à ne pas s’attirer les foudres de l’Eglise, et n’ose pas remettre en cause, même
provisoirement, les vérités religieuses.
b. Descartes pense se défaire de tous ses préjugés en recommençant à voyager, en discutant avec d’autres hommes,
et non « en demeurant plus longtemps renfermé dans le poêle où j’avais eu toutes ces pensées ». Descartes
voyage alors pendant neuf ans, en tâchant d’observer les hommes : « et en toutes les neuf années suivantes, je
ne fis autre chose que rouler çà et là dans le monde, tâchant d’y être spectateur plutôt qu’acteur en toutes les
comédies qui s’y jouent ».
i. Descartes ne rejette donc pas l’enseignement de l’expérience. Seulement, celle-ci n’est susceptible de
nous apprendre des choses qu’à partir du moment où l’on raisonne rigoureusement, avec méthode.
ii. Descartes se replonge donc à nouveau dans le monde, mais avec un esprit critique. Il regarde avec
détachement la « comédie » humaine.
iii. Descartes dit avoir ainsi déraciné de son esprit « toutes les erreurs qui s’y étaient pu glisser
auparavant ». Les voyages qui ont suivi sa découverte de sa méthode se sont donc révélés plus
fructueux que les voyages de sa jeunesse, qui l’avaient alors plongé dans le doute. La méthode
permet ainsi des progrès rapides.

iv. Descartes se distingue des sceptiques (qui doutent de l’existence de la vérité). Le but de Descartes est
de douter provisoirement afin de « rejeter la terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou l’argile »,
autrement dit une vérité certaine. Surtout, son doute n’est pas destructeur, mais constructif : « et
comme en abattant un vieux logis, on en réserve ordinairement les démolitions, pour servir à en bâtir
un nouveau ; ainsi, en détruisant toutes celles de mes opinions que je jugeais être mal fondées, je
faisais diverses observations, et acquérais plusieurs expériences qui m’ont servi depuis à en établir de
plus certaines. » De même qu’on peut utiliser les débris d’un bâtiment détruit, de même Descartes va
réutiliser ses anciennes opinions fausses pour en trouver de nouvelles.
c. Descartes continue à employer sa méthode, particulièrement dans le domaine des mathématiques. Il pense
pouvoir ramener beaucoup de problèmes scientifiques à des problèmes mathématiques (ce qui est une nouveauté
à son époque). C’est Galilée qui le premier tâchera de « mathématiser » la nature. Descartes dit continuer à
mener une vie « douve et innocente ».
d. Descartes n’a pas encore élaboré de philosophie. Il ne s’est pas encore attaqué aux problèmes qui opposent les
savants de son époque.
i. Pourtant, Descartes dit que le bruit court qu’il a déjà établi une philosophie.
ii. Descartes veut alors se rendre digne de sa réputation, et examiner ces questions. Par conséquent, il y
a 8 ans, Descartes décide de s’isoler en Hollande (un pays paisible, confortable dans lequel les
habitants mènent leur vie, sans le déranger) : tout en vivant dans une grande ville, Descartes dit : « j’ai
pu vivre aussi solitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés. »
Texte 13 :
[« La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu
m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant, en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées,
et les plus éloignées de l'excès, qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais
à vivre. Car, commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais remettre toutes à
l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés.]
[Et encore qu'il y en ait peut-être d'aussi bien sensés, parmi les Perses ou les Chinois, que parmi nous, il me semblait
que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre; et que, pour savoir quelles étaient véritablement
leurs opinions, je devais plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquaient qu'à ce qu'ils disaient; non seulement à cause qu'en la
corruption de nos mœurs il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs l'ignorent
eux-mêmes, car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose, étant différente de celle par laquelle on connaît qu'on la
croit, elles sont souvent l'une sans l'autre. Et entre plusieurs opinions également reçues, je ne choisissais que les plus modérées
: tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablement les meilleures, tous excès ayant
coutume d'être mauvais; comme aussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que je faillisse, que si, ayant choisi
l'un des extrêmes, c'eût été l'autre qu'il eût fallu suivre. Et, particulièrement, je mettais entre les excès toutes les promesses par
lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté.
Non que je désapprouvasse les lois qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, permettent, lorsqu'on a
quelque bon dessein, ou même, pour la sûreté du commerce, quelque dessein qui n'est qu'indifférent, qu'on fasse des vœux ou
des contrats qui obligent à y persévérer; mais à cause que je ne voyais au monde aucune chose qui demeurât toujours en même
état, et que, pour mon particulier, je me promettais de perfectionner de plus en plus mes jugements, et non point de les rendre
pires, j'eusse pensé commettre une grande faute contre le bon sens, si, parce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse
obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé de l'être, ou que j'aurais cessé de l'estimer telle. »]
Situation :
- Expliquer le projet de la « morale par provision ».
- Il s’agit ici de la première règle.
Problématique : Comment doit-on agir dans notre vie quotidienne, alors que l’on n’a pas le temps de réfléchir à la validité des
principes de nos actions ?
Thèse : Il faut pour cela agir en suivant les habitudes des gens autour de soi, en particulier les plus sages, et n’adopter que des
opinions modérées.
Objection : Descartes ne nous invite-t-il pas à un certain conformisme ?
Enjeu : Cette maxime vise l’action rationnelle (efficace) et raisonnable (morale). Elle nous permet aussi d’être heureux (pour
Descartes, la morale apporte le bonheur, comme chez les Grecs anciens, et contrairement à Kant, au 18ème siècle, qui pensera
que le devoir moral ne doit pas être accompli en vue du bonheur).
Plan : voir découpage du texte
A développer :
I. L’ENONCE DE LA MAXIME :
a. Une triple exigence :
i. obéir aux lois et coutumes de la société dans laquelle on vit (cela évite d’être marginalisé). Il s’agit
d’un conseil de prudence (ne pas s’attirer inutilement de problèmes de la part des autres).
ii. garder la religion de ses parents (sans doute pour conserver des liens avec sa famille). Encore une fois,
apparaît ce souci de ne pas être rejeté par les autres.
iii. n’adopter que des opinions modérées, « qui fussent les plus communément reçues en pratique par les
mieux sensés de ceux avec lesquels j’aurais à vivre » : il faut donc prendre exemple sur les personnes
autour de nousque l’on sait être sages, mais plus particulièrement sur leurs actions (plus que sur leurs
paroles) : reçues en pratique ». Ce souci de modération tranche avec la radicalité du premier précepte
de la méthode, qui invite à ne rien recevoir pour vrai qui ne soit absolument indiscutable.

b. S’en remettre à l’opinion des plus sensés : Ici Descartes change de méthode : puisqu’il doute de ses propres
idées, il ne sait plus rien, et décide de faire confiance aux hommes les plus sages.
II. POURQUOI IL FAUT ÊTRE CONFORMISTE :
a. Mieux vaut faire comme ceux avec qui on vit : Dans la seconde partie de son texte, Descartes va expliquer
certains points, et notamment l’intérêt de « faire comme les autres ». En effet, on pourrait penser qu’un
philosophe aurait intérêt à vivre différemment, comme un marginal, afin de mieux analyser le monde autour de
lui. Descartes, au contraire, prône une parfaite intégration à la société environnante, quitte à être conformiste.
i. Il y a peut-être des Perses et des Chinois très sensés, mais il est plus « utile » de faire comme les
hommes qui sont autour de nous.
ii. Pourquoi ? Descartes ne le dit pas : on peut bien en imaginer la raison : on évite le rejet, on peut mieux
réussir dans sa profession car on connaît les habitudes du pays, bref, on vit mieux. Il semble que
Descartes ne cherche pas uniquement le confort et veut surtout éviter les pertes de temps inutiles, et
les difficultés que rencontrerait un homme qui se piquerait d’originalité. Il ne veut pas vivre comme
le philosophe Diogène le cynique (Grecs anciens), qui méprisaient les conventions sociales et vivait
dans un tonneau. Le philosophe n’a pas vocation à être marginal pour Descartes. Pourquoi ? Avant
tout pour garantir une certaine tranquillité d’esprit, qui le rende disponible à l’étude.
b. Privilégier les actes aux paroles : Lorsqu’on décide de suivre les autres, il faut cependant prendre garde à ne
pas se fier à leurs déclarations, mais seulement à leurs actions.
i. D’une part, parce que les gens ne sont pas sincères : ils ne disent pas ce qu’ils pensent.
ii. D’autre part parce que les gens n’analysent pas leur conduite, et ne savent pas ce qu’ils font : ils ne
peuvent donc en parler correctement : « car l’action de la pensée par laquelle on croit une chose, étant
différente de celle par laquelle on connaît qu’on la croit », autrement dit, la croyance n’est pas la
connaissance : les gens peuvent croire agir selon certains principes, mais sans savoir quels sont ces
principes, et même sans prendre conscience de ce qu’ils croient. Du coup, il y a une discordance entre
les principes qu’ils affichent et ce qu’ils font effectivement.
c. Pourquoi il faut préférer la modération : On peut reprocher aux gens modérés d’être frileux, de ne pas vouloir
prendre de risque. Descartes explique pourquoi la modération est supérieure à l’excès.
i. Ces opinions sont les « plus commodes » : en effet, il semble bien qu’on évite de se faire des ennemis.
Nous retrouvons le souci cartésien d’éviter d’être dérangé par des controverses.
ii. Descartes refuse surtout, comme dans la partie 2, d’être considéré comme un révolutionnaire
susceptible de troubler l’ordre du pays. Il caraint la censure des autorités.
iii. Surtout, les opinions modérées sont « vraisemblablement les meilleures » - remarquons que Descartes
ne dit pas ici qu’elles sont vraies, mais seulement vraisemblables – car elles ont plus de chance
« statistiquement » d’être proches de la vérité, contrairement à une opinion excessive, qui peut
conduire à se tromper totalement, à se fourvoyer. Il faut trouver le point « équidistant » entre deux
opinions extrêmes : la vérité ne sera jamais très loin (remarquons la métaphore géométrique).
iv. Descartes s’oppose à Aristote et à son « juste milieu » qui représente l’excellence de la conduite : ici,
le juste milieu n’a qu’un intérêt purement pratique. Il n’est pas le signe de l’excellence morale.
v. Descartes considère comme un excès les promesses qui nous engagent, et donc limitent notre liberté
(par une obligation). Cela peut paraître étrange car la promesse peut sembler un exemple typique de
devoir moral. Kant y accorde beaucoup d’importance. Cela montre la capacité de l’individu à
s’imposer des règles, à s’engager, et donc à être autonome (forme la plus haute de liberté pour Kant,
Rousseau le siècle suivant). Pour Descartes, un homme a tort de se lier à un engagement, et doit
conserver la possibilité de changer de décision. Mais Descartes prône-t-il l’inconstance ? Fait-il
preuve, comme Machiavel (auteur italien du 16ème siècle, qui donne des conseils à un Prince pour
garder le pouvoir) d’un pragmatisme cynique ?
d. Dans le dernier paragraphe, Descartes va expliquer davantage ce dernier point : pourquoi il ne faut pas
s’engager : le fait de changer d’avis est, pour Descartes, le fait des « esprits faibles ». Ainsi, les contrats, par
lesquels on s’engage vis-à-vis d’autrui, sont nécessaires. Ils sont notamment utiles au commerce, et permettent
de persévérer (Descartes anticipe ici sa 2ème maxime). Les « vœux » font ici référence aux vœux monastiques
(s’engager dans les ordres).
i. Comme Machiavel avant lui, Descartes observe que tout change, rien n’est stable. Mais, ce n’est pas
parce que les hommes sont inconstants qu’il faut ne pas s’engager.
ii. En réalité, ce que veut dire Descartes, c’est que, tant qu’il n’a pas fini l’examen critique de ses pensées,
et donc tant qu’il doute de tout, il ne doit pas se lier d’une manière ou d’une autre, car le gênera dans
sa quête de la vérité. Les promesses risquent de nous pousser à transformer des opinions provisoires
en opinions définitives. Descartes n’est donc pas de manière générale contre les promesses qu’on fait
aux autres hommes, mais ne veut pas s’engager tant qu’il n’a pas les idées claires.
Texte 14 :
« Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas
moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très
assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant, tantôt d'un
côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même
côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui
les ait déterminés à le choisir : car, par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque
part, où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent

aucun délai, c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous
devons suivre les plus probables; et même, qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilité aux unes qu'aux
autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et les considérer après, non plus comme douteuses, en tant
qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines, à cause que la raison qui nous y a fait déterminer
se trouve telle. Et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentirs et les remords, qui ont coutume d'agiter les
consciences de ces esprits faibles et chancelants, qui se laissent aller inconstamment : à pratiquer, comme bonnes, les choses
qu'ils jugent après être mauvaises. »
VOIR L’EXEMPLE D’EXPLICATION DE TEXTE
Texte 15 :
[« Ma troisième maxime était de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre
du monde; et généralement, de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir, que nos pensées, en
sorte qu'après que nous avons fait notre mieux, touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir
est, au regard de nous, absolument impossible. Et ceci seul me semblait être suffisant pour m'empêcher de rien désirer à l'avenir
que je n'acquisse, et ainsi pour me rendre content.] [Car notre volonté ne se portant naturellement à désirer que les choses que
notre entendement lui représente en quelque façon comme possibles, il est certain que, si nous considérons tous les biens qui
sont hors de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regrets de manquer de ceux qui
semblent être dus à notre naissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous avons de ne posséder pas les
royaumes de la Chine ou du Mexique; et que faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désirerons pas davantage d'être
sains, étant malades, ou d'être libres, étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu
corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Mais j'avoue qu'il est besoin d'un long exercice, et
d'une méditation souvent réitérée, pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses;][ et je crois que c'est
principalement en ceci que consistait le secret de ces philosophes, qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et,
malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leurs dieux. Car, s'occupant sans cesse à considérer les bornes
qui leur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient si parfaitement que rien n'était en leur pouvoir que leurs pensées,
que cela seul était suffisant pour les empêcher d'avoir aucune affection pour d'autres choses; et ils disposaient d'elles si
absolument, qu'ils avaient en cela quelque raison de s'estimer plus riches, et plus puissants, et plus libres, et plus heureux,
qu'aucun des autres hommes qui, n'ayant point cette philosophie, tant favorisés de la nature et de la fortune qu'ils puissent être,
ne disposent jamais ainsi de tout ce qu'ils veulent. »]
Situation :
- Expliquer la morale par provision.
- Les deux maximes précédentes.
Problématique : Comment doit-on agir dans notre vie quotidienne, alors que l’on n’a pas le temps de réfléchir à la validité des
principes de nos actions ?
Thèse : Il ne faut désirer que ce qui est possible, de façon à ne pas se tourmenter inutilement.
Objection : Souvent appelée maxime « de la résignation », celle-ci ne nous conduit-elle pas, en réalité, à sacrifier notre
bonheur ?
Enjeu : le bonheur.
Plan : voir texte.
A développer :
I. L’ENONCE DE LA MAXIME :
a. Maîtriser ces désirs : Descartes s’inspire ici des Stoïciens (pensons à Epictète, esclave grec qui enseigna à
l’empereur Marc-Aurèle et qui fait la distinction célèbre entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas).
Les Stoïciens pensent qu’il faut supprimer les désirs pour être heureux (ils s’opposent en cela aux Epicuriens, à
la même époque, qui valorisent les désirs tout en conseillant leur relative maîtrise).
i. Nous pouvons contrôler nos pensées grâce à la volonté.
ii. Un désir n’est pas un besoin : en tant que représentation consciente orientée vers l’obtention d’un
objet manquant, il peut être modifié, contrairement à un besoin.
iii. Il existe un « ordre du monde » : Descartes ne croit pas au Destin, mais désigne par là une réalité
extérieure qui résiste à nos actions. Cela peut semble en opposition avec ce que Descartes dira dans la
6ème partie, où il montre que la science nous donne un grand pouvoir d’intervention sur la nature, et
nous rend « comme maître et possesseur » de celle-ci.
b. Faire de son mieux : Descartes pourtant n’invite pas au fatalisme. Il pense que nous devons « faire de notre
mieux », c’est-à-dire faire le plus d’efforts possibles pour accomplir un désir. Mais, il ne faut pas se lamenter
en cas d’échec. On peut objecter à Descartes la difficulté de distinguer nettement ce qui est possible et ce qui
est impossible. Les hommes n’ont-ils pas progressé grâce aux désirs impossibles, comme par exemple voler (qui
a donné l’avion)?
c. « Se rendre content » : Ce travail sur nos représentations (ne pas désirer ce qui ne dépend pas de nous) nous
permet de ne désirer que ce que nous pouvons obtenir, et d’être heureux. Om est facile de comprendre en quoi
des désirs réalistes sont plus susceptibles de nous rendre heureux: ils sont plus facilement obtenus, et donnent
plus de satisfaction. Les désirs irréalisables nous exposent à la frustration.
II. JUSTIFICATION :
a. La volonté suit l’entendement : plus qu’un effort de volonté, il faut faire un effort intellectuel afin de discerner
les choses possibles et les choses impossibles. La volonté s’incline « naturellement » devant l’entendement,
c’est-à-dire qu’elle choisit spontanément ce que ‘entendement lui représente être bien. Il faut donc bien réfléchir,
mais aussi ne pas aller trop vite : l’erreur est toujours le fait de la précipitation de la volonté sur l’entendement.

Il ne faut pas vouloir, et le désir est un vouloir encore incertain, imprécis, irréfléchi, avant d’avoir laissé le temps
à l’entendement de considérer les choses.
b. Éviter les regrets : Cela nous permettra d’éviter certains désirs vains, comme les désirs d’honneurs, de richesse
(« ceux qui semblent être dus à notre naissance ») car justement ils dépendant de notre statut social : nous ne
l’avons pas choisi (surtout à l’époque de Descartes).
i. Descartes compare significativement ces types de désirs à un désir absurde : posséder les royaumes
de Chine et du Mexique.
ii. Cela nous aidera à accepter la « fatalité » : la maladie, la prison, tout ce qui vient de l’extérieur. Il faut
donc bien apprendre à se résigner. Descartes reprend une comparaison avec des désirs absurdes : avoir
un corps en diamant (donc indestructible), avoir des ailes. Mais les hommes ne tendent-ils pas
naturellement à de tels désirs impossibles?
c. « Un long exercice », « une méditation souvent réitérée » : Descartes admet qu’une telle attitude demande
beaucoup d’efforts. Il reconnaît par là que nous tendons le plus ordinairement vers ce qui est, justement,
impossible. Or, faut-il vraiment enrayer cette tendance?
III. ENJEU : ATTEINDRE LE BONHEUR :
a. Un bonheur quasi divin : Savoir ne désirer que ce qui est possible conduit à un très grand bonheur, et non à un
bonheur médiocre, fait de résignation. Les Stoïciens (les « philosophes » auxquels pense ici Descartes) ont pu
ainsi « disputer de la féliciter avec les dieux », malgré la pauvreté et les coups du sort, car ils savaient se protéger
des revers de la fortune grâce à leur force d’esprit (la fameuse « forteresse intérieure » de Marc Aurèle).
b. La raison de ce bonheur : un jugement raisonnable. Les Stoïciens avaient une très grande force d’esprit : ils
savaient « se persuader », ils avaient un grand contrôle d’eux grâce au pouvoir qu’ils avaient sur leurs pensées.
La maîtrise des pensées permettait la maîtrise des « affections », c’est-à-dire des sentiments (à opposer à la
raison). Ils aveint plus de choses que les autres car ils avaient tout ce qu’ils voulaient, au contraire des éternels
insatisfaits. Ils sont plus libres car ils ne dépendent pas des choses qui leur sont extérieures. Ils sont plus heureux
car ils ne sont pas tourmentés par des désirs vains. Ils atteignent la fameuse « indifférence ».
Texte 15 :
[« Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisai de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en
cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure; et sans que je veuille rien dire de celles des autres, je pensai que je ne pouvais
mieux que de continuer en celle-là même où je me trouvais, c'est-à-dire, que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison, et
m'avancer, autant que je pourrais, en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite.]
[J'avais éprouvé de si extrêmes contentements, depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode, que je ne croyais
pas qu'on en pût recevoir de plus doux, ni de plus innocents, en cette vie; et découvrant tous les jours par son moyen quelques
vérités, qui me semblaient assez importantes, et communément ignorées des autres hommes, la satisfaction que j'en avais
remplissait tellement mon esprit que tout le reste ne me touchait point.] Outre que les trois maximes précédentes n'étaient
fondées que sur le dessein que j'avais de continuer à m'instruire : car Dieu nous ayant donné à chacun quelque lumière pour
discerner le vrai d'avec le faux, je n'eusse pas cru me devoir contenter des opinions d'autrui un seul moment, si je ne me fusse
proposé d'employer mon propre jugement à les examiner, lorsqu'il serait temps; et je n'eusse su m'exempter de scrupule, en les
suivant, si je n'eusse espéré de ne perdre pour cela aucune occasion d'en trouver de meilleures, en cas qu'il y en eût. Et enfin,
je n'eusse su borner mes désirs, ni être content, si je n'eusse suivi un chemin par lequel, pensant être assuré de l'acquisition de
toutes les connaissances dont je serais capable, je le pensais être, par même moyen, de celle de tous les vrais biens qui seraient
jamais en mon pouvoir, d'autant que, notre volonté ne se portant à suivre ni à fuir aucune chose, que selon que notre entendement
« la » lui représente bonne ou mauvaise, il suffit de bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi
tout son mieux, c'est-à-dire pour acquérir toutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu'on puisse acquérir; et lorsqu'on
est certain que cela est, on ne saurait manquer d'être content. »
Situation :
Rappeler ce qu’est la morale par provision.
Rappeler les trois maximes précédentes.
Indiquer que cette maxime est souvent oubliée : Descartes annonce lui-même « trois ou quatre maximes ». En réalité, c’est la
plus importante, car les trois autres reposent sur elle.
Problématique : Quelle est la meilleure vie ?
Thèse : La meilleure vie est celle passer à « cultiver sa raison », c’est-à-dire à rechercher la vérité.
Objection : Une vie consacrée à la recherche de la vérité n’est-elle pas une vie austère, pleine de sacrifices ?
Enjeu : développer la connaissance ; le bonheur.
Plan : voir texte.
Texte 16 :
« [Après m'être ainsi assuré de ces maximes, et les avoir mises à part, avec les vérités de la foi, qui ont toujours été les premières
en ma créance, je jugeai que, pour tout le reste de mes opinions, je pouvais librement entreprendre de m'en défaire. Et d'autant
que j'espérais en pouvoir mieux venir à bout, en conversant avec les hommes, qu'en demeurant plus longtemps renfermé dans
le poêle où j'avais eu toutes ces pensées, l'hiver n'était pas encore bien achevé que je me remis à voyager. Et en toutes les neuf
années suivantes, je ne fis autre chose que rouler çà et là dans le monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes
les comédies qui s'y jouent; et faisant particulièrement réflexion, en chaque matière, sur ce qui la pouvait rendre suspecte, et
nous donner occasion de nous méprendre, je déracinais cependant de mon esprit toutes les erreurs qui s'y étaient pu glisser
auparavant]. [Non que j'imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent que pour douter, et affectent d'être toujours irrésolus
: car, au contraire, tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer, et à rejeter la terre mouvante et le sable, pour trouver le roc ou
l'argile.
 6
6
1
/
6
100%