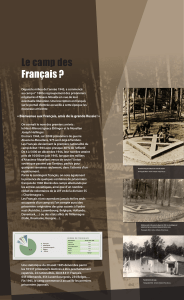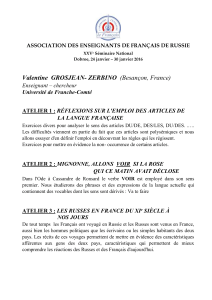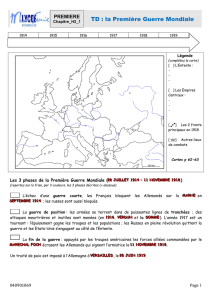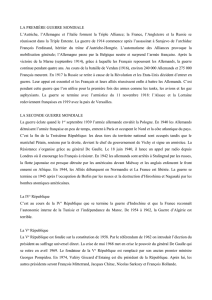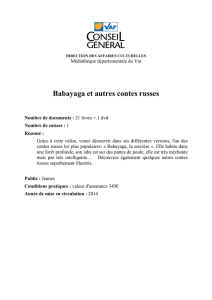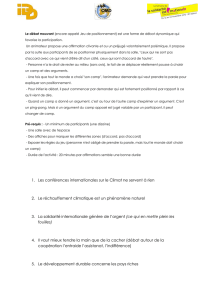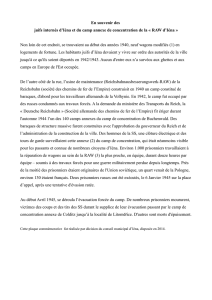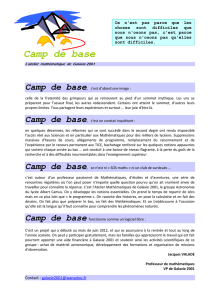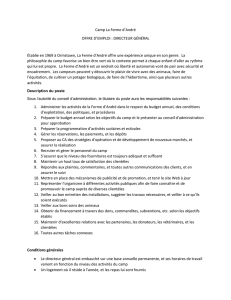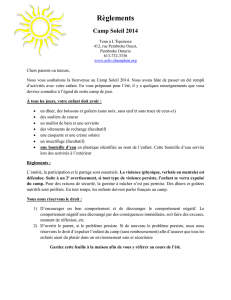doc PDF - Mémoire et Avenir

1
Georges EGRET
Mémoires
(extraits)
(10 mai 1940 – 15 juin 1945
Demain ne sera pas long à devenir hier (Proverbe lyonnais)
La capture
Le 10 mai 1940 avec l’enfoncement du front à Sedan, ce fut la fin de la « drôle de guerre » et
l’on connut les alertes aériennes. Lorsque le front fut stabilisé un moment en Champagne le
général Lestien revendiqua pour sa division l’honneur d’y être envoyée. Et c’est ainsi que
nous embarquâmes un beau soir à destination de Ciry Sermoise.
J’étais désigné pour assurer la défense antiaérienne du train, et j’ai passé la nuit sur un
wagon plat avec six troufions et deux mitrailleuses équipées pour tirer sur des avions. Dans
une halte près de Reims, le chauffeur de la locomotive me signala que c’était au petit jour et
dans ce secteur que les attaques avaient lieu en général, mais cette fois tout fut calme et
nous débarquâmes sans incident.
J’étais logé avec les officiers dans un petit château abandonné par ses propriétaires où je
trouvai une chambre, je m’étendis sur le lit tout habillé et je ne tardai pas à m’endormir
profondément. Des coups de feu me réveillèrent et après avoir songé à une attaque, je
constatai bien vite que mes cuisiniers avaient organisé une chasse aux cochons dans le
parc, ce qui allait procurer à la popote un ravitaillement inattendu et gratuit. En descendant à
la cuisine, je rencontrai des agents de liaison qui nous donnèrent des renseignements sur
l’emplacement de notre régiment, lequel venait d’entrer en contact avec les Allemands sur ce
qu’on a appelé pompeusement la « ligne Weygand » et qui dans notre esprit devait, comme
la Marne de 1914, marquer le début du redressement.
Hélas, il n’en fut rien et, par étapes, nous commençâmes à nous replier vers le Sud, c’est à
dire vers la Seine, et l’on trouvera dans la chronologie les étapes de cette longue marche.
C’est au cours de ce repli qu’Henri Pineau, avec qui je devais passer de longs mois, nous
rejoignit et que je rencontrai un petit matin René à Orbais l’Abbaye, où il faisait un
mouvement semblable au nôtre avec ses mulets et ses canons de montagne, dans les
espaces dénudés de la Champagne pouilleuse. Les avions d’observation allemands
n’avaient aucune peine à repérer les longues files de mulets et, une demi-heure après, nous
étions mitraillés avec de lourdes pertes en hommes et en bêtes. Ainsi, nous prîmes
l’habitude de nous camoufler le jour et de nous déplacer la nuit.

2
Cela n’empêcha pas qu’en plein jour le village de Péas où nous étions pour déjeuner fut
attaqué par un carrousel d’avions italiens, les balles entrant par les fenêtres au moment où
nous nous mettions à table, cassant de la vaisselle mais ne tuant personne.
Le 13 juin 1940, après une longue marche de nuit, nous parvenions à Saint-Quentin le
Verger à proximité de la Seine où nous espérions, dans notre naïveté, que le
commandement français avait établi la ligne principale de résistance. Je m’étendis vers deux
heures du matin sur le lit dans une petite villa qui avait été construite récemment. Faute de
place, je partageais la chambre avec un autre aspirant, appelé Provençal. A trois heures du
matin, une fusillade rapprochée nous réveille, mon camarade est pris d’une « courante » qui
le paralyse. Je vais aux nouvelles et le capitaine Marteau me donne l’ordre de m’établir dans
les granges situées sur une route d’accès. Une douzaine de tireurs enlèvent ce qu’il faut de
tuiles pour pouvoir observer et tirer et nous attendons sans rien voir, sinon des troupes
françaises qui se replient sans ordre et sans encadrement et à qui le commandant Webanck
demande de nous laisser leurs armes et leurs munitions. Pendant ce temps, avec le
capitaine, d’autres s’attaquaient à une auto-mitrailleuse allemande qui était au pied de
l’église et, au somment du clocher dans lequel des tireurs allemands s’étaient installés pour
créer la panique ; enfin une patrouille se dirigea vers un passage à niveau où un bref
accrochage eut lieu et où un jeune aspirant, qui me parlait la veille de son prochain mariage,
fut tué d’une balle en plein front.
Les blessés sont entassés dans les caves d’une ferme et un avion d’observation allemand
laisse présager une prochaine attaque du village par les Stukas.
Le capitaine me donne l’ordre, avec le Lieutenant Brionne, de rassembler les valides et de
nous diriger en disposition de combat vers le Sud, cependant que le commandant Webanck
prononce une parole historique « Quant à moi, il ne me reste plus qu’à trouver un coin pour
mourir ».
Nous partons à travers les blés verts et nous tirons sur des motocyclistes allemands qui se
dirigent vers Saint-Quentin-le- Verger.
Au bout d’une heure, nous apercevons une route avec une longue file d’auto-mitrailleuses et
nous nous demandons si ce ne serait pas les avant-gardes de la fameuse ligne de
résistance française. Mais en approchant et à la jumelle, nous reconnaissons la croix de fer
allemande, une série de jeunes soldats verts se précipitent vers nous en agitant leurs
grenades à manche. Je consulte mon aîné, le lieutenant Brionne et je lui demande s’il faut
faire tirer, auquel cas aucun d’entre nous n’en réchappera, car nous n’avions que de
malheureux fusils face à des blindés. Nous tombons d’accord pour nous rendre. Je cache
mon revolver dans un trou et je jette ostensiblement sur le sol le fusil que je m’étais procuré
en supplément. Tous les autres en font autant.
Les Allemands nous apprennent que Paris est pris et que nous serons bientôt libérés. A bout
de fatigue et de nerfs, je m’assoies et ne peux m’empêcher de pleurer.
On nous rassemble dans de grands prés et je m’accuse d’avoir manqué de courage en me
rendant si facilement et le me remémore les mâles paroles du commandant.
Mais peu à peu, dans l’immensité du campement, je retrouve le capitaine Marteau, Pineau,
la plupart des autres officiers et même le commandant qui n’a rien perdu de sa grande allure
mais qui n’a pas trouvé de coin pour mourir, sans doute parce Saint-Quentin-le-Verger était
rond.
Rassuré sur mon comportement, je bande toute mon énergie pour survivre. Je pense à
l’évasion qui serait facilitée par la pagaille qui règne et le débordement des Allemands
devant le nombre de prisonniers, mais le capitaine Marteau m’en détourne car l’armistice est
demandé par le Maréchal Pétain et la libération ne saurait tarder. En prenant la solution de
facilité, je commis une erreur qui devait me coûter cinq ans de liberté.
La longue marche continue cette fois vers le Nord avec parfois deux sardines pour 40
kilomètres et quelques verres d’eau. J’ai mon bidon de deux litres plein de marc de
champagne dont je n’ose pas me défaire et il m’arrive d’échanger un verre d’eau contre une
goulée de gnole.

3
Nous prenons enfin le train pour Beauraing et pour Trèves d’où nous serons dirigés sur la
Poméranie. Nous débarquons à Gross Born, lieu de l’OFLAG IID où je suis immatriculé n°
2351. La photo que j’ai pu récupérer cinq ans plus tard me montre particulièrement amaigri.
La captivité
La captivité, cinq années « jour pour jour, 14 juin 1940, 14 juin 1945, de 22 à 27 ans, cinq
années dans la crasse, le froid et l’inconfort, les cinq années qui m’ont le plus marqué. Elles
m’ont fait connaître les homme et leur petitesse, le « pantin humain » selon l’expression que
mes enfants ont souvent entendue, mais aussi l’amitié, je devrais dire la fraternité que
l’existence ordinaire ne suscite guère.
La petitesse : ce sont ces commandants et ces colonels que j’ai vu se battre comme des
clochards pour conquérir des boîtes de conserves incomplètement vidées et que je regardais
avec un mépris que je m’efforçais d’exprimer dans une attitude hostile de dédain.
La fraternité : c’est Pineau, bien pourvu en colis opulents qui les partageait avec les miens
qui contenaient plus de biscuits que de rôtis.
Ma captivité comporte trois périodes : une année d’OFLAG et de Kommandos, trois années
au camp des aspirants de Stablack et, enfin, le retour vers l’Ouest et la libération par les
Russes.
1 L’OFLAG et les Kommandos
Au moment de la déclaration de guerre, les pays qui ont signé la convention de Genève
échangent un document qui mentionne les équivalences de grades. Le grade d’aspirant,
créé très peu de temps avant la guerre pour les élèves sortant des écoles militaires, avait
simplement pour but de réaliser des économies budgétaires en retardant la nomination au
grade de sous-lieutenant. Or l’aspirant ne figurait semble-t-il pas dans les documents
échangés entre la France et l’Allemagne au moment de l’entrée en guerre en 1939. Dans
l’armée française, nous étions assimilés aux officiers, c’est pourquoi je suivis ceux de mon
régiment jusque dans les sables poméraniens de l’OFLAG IID. La jeunesse des aspirants en
fit rapidement des trublions qui tentaient de s’évader ou qui étaient plus habiles que les vieux
officiers pour être les premiers « au rab », si bien qu’en septembre et semble-t-il d’un
commun accord avec l’Allemagne et les officiers prisonniers, nous étions dirigés vers les
Stalags.
Gross Born m’avait familiarisé avec la vie des camps, les baraques où nous étions entassés
dans des châlits à trois étages, les lavabos où nous nous retrouvions vingt autour d’un
robinet, les rassemblements du matin et du soir où nous étions comptés par « zinc » et où
les comptes n’étaient jamais exacts ; la queue pour la soupe au rutabagas où parfois
flottaient de petits cubes de viande, le partage du pain de seigle compact au millimètre près,
la cuisine en plein air sur des cubilots faits à partir de boîtes de conserves encastrées, avec
une grille au fond et des trous sur les côtés de la boîte intérieure, qui permettaient de faire
bouillir un litre d’eau avec une feuille de journal mise en boulettes. Et puis encore, le
désoeuvrement et ces discussions recommencées indéfiniment sur les causes de la défaite.
L’attente souvent déçue d’une lettre ou d’un colis …
Le nouveau camp vers lequel on nous dirigea était le Stalag IIB, lui-aussi en Poméranie. Dès
notre arrivée, Pineau, qui avait plus d’expérience de la vie que moi, me dit avoir découvert
des gens sympathiques qui avaient été interprètes auprès de l’armée britannique et qui
étaient en général de famille aisée, donc susceptibles d’avoir de beaux colis. Et c’est ainsi
que nous avons formé avec Kamir, de Gourcuff et Curtis un groupe décidé à se tenir les
coudes. Après une certaine résistance, mais tenaillés par la faim, nous acceptons d’être
envoyés dans la vaste plaine poméranienne pour ramasser des pommes de terre.
Ce fut dur car, depuis quatre mois, nous ne faisions guère d’exercice ; et de 8 heures du
matin à 7 heures du soir, il fallait, répartis sur une longue ligne, attendre le passage de
l’arracheuse de pommes de terre, puis remplir, en se baissant cent fois, nos paniers et les
porter aux tombereaux où on les vidait.

4
Mais c’était aussi la possibilité de revoir des civils et des femmes parfois jolies, comme cette
jeune Polonaise que nous imaginions dans le rôle d’Esmeralda. Et nous étions étonnés que
les paysans allemands, avec lesquels nous échangions quelques paroles, fussent plus
proches des paysans français que les caricatures d’Hansi que nous avions tous en mémoire.
Enfin, des soupes confortables avec de la vraie viande nous permettaient de reprendre des
joues et des forces.
C’est pourquoi, lorsqu’on nous proposa d’aller à Zanow à l’Ostmark Fabrik d’Ernst Schwartz,
nous décidâmes de tenter l’expérience. Ernst était un ancien instituteur que son
appartenance au parti nazi avait propulsé dans les affaires. Il avait une scierie et une petite
entreprise qui fabriquait avec des planches de sapin des « wagons » plats avec quatre roues
à pneus qui pouvaient être tirés par deux chevaux. Sa demeure était près de l’usine et nous
logions à l’intérieur de l’enceinte, dans un ancien atelier désaffecté. Nous étions une
quinzaine et chacun avait un lit individuel fait de planches mal rabotées avec une paillasse et
deux couvertures. Un gros poêle qui ne manquait jamais de bois nous tenait chaud. Le matin
et le soir, nous prenions notre repas dans une cuisine attenante où une brave femme nous
faisait un rata convenable. La pomme de terre poméranienne cuite à l’eau tenait la première
place mais elle était souvent accompagnée d’une « gute sauce » qui déclenchait un chœur
de « Danke Schoën » suivi d’un inévitable « Bitte Schöen » et le chœur reprenait dans les
rires « Grosse Bitte ».
Mon travail consistait essentiellement à empiler des planches avec mon camarade Curtis,
directeur d’une agence du Crédit du Nord à Lille. Ce garçon distingué et cultivé devait avoir
une douzaine d’années de plus que moi et nous passions des journées agréables, lorsqu’il
ne faisait pas trop froid, sur nos tas de planches à parler littérature ou à réciter des vers de
Verlaine que nous apprenions dans un petit recueil qui nous était parvenu dans un colis.
Pineau, plus adroit, participait avec Kamir directement au sciage de gros troncs de sapin. Un
jour que je travaillais avec des moufles à une mortaiseuse, le gant fut happé par la machine
qui m’écrasa l’index de la main droite malgré sa protection. Un médecin me soigna
correctement et cela me valut un mois de repos, où je lisais auprès du feu une partie de la
Comédie Humaine de Balzac.
De ces 10 mois passés à Zanow me reviennent quelques anecdotes :
La veille de Noël, le vicomte de Gourcuff, descendant d’une vieille famille bretonne, qui
parlait couramment l’allemand et l’anglais, ayant reçu dans un colis un magnifique uniforme
de chasseur, décida d’aller offrir ses vœux en notre nom à la famille Schwartz pour la
remercier de la façon correcte dont nous étions traités et avec aussi, il faut bien le dire,
l’arrière-pensée que nous aurions une contre-partie le lendemain. Effectivement, à midi, le
jour de Noël, nous voyons arriver Ernst, avec l’air avantageux d’un Goering bienveillant,
accompagné de sa femme et de ses filles, nous apportant un plat de cerf en sauce et un
dessert. Il prononça quelques mots, souhaitant que ce Noël soit le dernier que nous
passions loin de nos familles. Mais l’affaire n’en resta pas là. La sentinelle, surnommée
Dudule, fit un rapport à l’autorité supérieure comme quoi il n’avait pas pu empêcher des
personnes du sexe féminin de pénétrer dans la chambre des prisonniers, ce qui était bien
entendu « Strengst Verboten ». Des enquêtes eurent lieu, mais le combat Dudule contre
Ernst n’était pas égal et Dudule se retrouva sur le front de l’Est d’où il y a fort peu de chance
qu’il soit revenu.
La seconde anecdote que je voudrais raconter est celle de mon départ de Zanow. La voici
telle que je l’écrivais aussitôt à ma famille :
Samedi 23 Août 1941
« Il y a une demi-heure, une sentinelle est arrivée : demain matin, à 8h30, mes deux
meilleurs camarades et moi-même nous partons pour le camp et, de là, « Nach Frankreich
nach Paris » nous assure le Wachtmann (sentinelle) avec insistance. Inutile de vous dire que
c’est avec le plus grand scepticisme que nous accueillons cette annonce de libération suivie,
paraît-il, d’une nouvelle mobilisation. Mais n’allons-nous pas plutôt être acheminés vers un
camp d’officiers (car nous sommes trois aspirants) ? Quoi qu’il en soit, soirée d’émotion. En
quittant cette chambre, cette usine, cette scierie où nous sommes attachés par dix mois de

5
souvenirs, nous ne pouvons pas nous empêcher d’être pris d’une certaine tristesse ; et moi
qui croyais devant une semblable nouvelle sauter au plafond, être pris d’une joie délirante !
Il n’empêche, si dans une quinzaine de jours, à l’arrivée de cette lettre, je pouvais tous vous
embrasser dans notre vieux Chasselay, ce serait bien un instant de joie pure, compensation
à bien des peines. Mais je déparle. »
Effectivement, je « déparlais ». Quatre jours plus tard, les trois aspirants aboutissaient en
Prusse orientale au camp de Stablack près d’Eylau, célèbre par la bataille gagnée par
Napoléon. Pineau et moi trouvions deux places à la baraque 10 du camp des aspirants, en
formation depuis deux mois et où les Allemands avaient décidé de regrouper tous les
aspirants répartis dans les divers « Stalags » pour les placer sous le commandement du
Général Didelet, ancien attaché militaire auprès de l’ambassade de France à Berlin. Le
regroupement avait pour but de soumettre les aspirants à une propagande en faveur de la
« Révolution Nationale » et de la collaboration avec l’Allemagne. Stablack était une
conséquence lointaine de la poignée de main de Montoire entre Hitler et Pétain.
2 Le camp des Aspirants de Stablack
Le camp comprenait plusieurs « Blocks » et, à côté du Block des Aspirants s’en trouvait un
certain nombre d’autres avec des sous-officiers et des hommes de troupe français, belges,
polonais ou russes.
Dès mon arrivée, je demandai des nouvelles de René à un sous-officier français qui, par
hasard, le connaissait. René, atteint d’une sorte de diphtérie, avait quitté son Kommando de
travaux publics où il travaillait très durement à la construction de bases de départ de l’armée
allemande en vue de l’attaque contre la Russie. Et il était venu au camp juste deux jours
avant mon arrivée. Dans l’heure qui suivit, nous tombions dans les bras l’un de l’autre,
quatorze mois après la brève rencontre d’Orbais l’Abbaye, à deux jours de ma capture. Je le
trouvai amaigri ; mais devenu chef de la baraque des rapatriés, il ne tarda pas à reprendre
du poids ; et durant les vingt-deux mois que nous avons passés à quelques centaines de
mètres l’un de l’autre, nous vécûmes fraternellement, comme nous ne l’avions jamais fait
dans le passé en raison des huit ans qui nous séparaient.
René disposait d’un ravitaillement plus abondant que le mien car il avait des contacts
journaliers avec ceux qui revenaient des Kommandos pour être rapatriés (anciens
combattants, chargés de famille, malades, etc …) et qui rapportaient des vivres. D’autre part,
les effectifs de sa baraque étant fluctuants, il pouvait facilement se procurer du pain ou de la
margarine en supplément avec laquelle il faisait du troc. C’est ainsi que pour la Chandeleur
de 1943, il apporta à la popote un grand plat de « bugnes » lyonnaises et que pour la fête de
Noël de 1941 et celle de 1942, il vint fêter le réveillon avec ma popote dans notre baraque où
il paya son écot en produits alimentaires et en dessinant les menus.
Durant les vingt-deux mois où René fut au camp, je connus un grand équilibre.
Mais revenons à l’Aspilag, voici comme je le décrivais dans une lettre à mon frère aîné : « le
camp de Stablack n’est pas un camp comme les autres, nous sommes sous la direction d’un
général français et la discipline est organisée par nous-mêmes, il y a un cinéma où nous
pouvons voir les actualités, un terrain de sport sur lequel chaque jour nous faisons une demi-
heure de gymnastique. Enfin, une université a été créée avec des cours de lettres, sciences
et droit. J’ai retrouvé de nombreux camarades de Lyon, de faculté et de Saint Maixent ».
Il ne faudrait cependant pas croire que c’était un hôtel trois étoiles.
Songez que nous étions plus de cent par chambrée, cent conversations, cent paires de
sabots, ne parlons pas des méridionaux joueurs de bridge, ni du maniaque du marteau, ni
des énervés qui font du catch. Songez enfin que certaines nuits d’hiver, la température
extérieure atteignait – 33° et que le malheureux poêle de briques n’empêchait pas l’eau de
geler dans les bidons. Malgré cela, quelques héros réussissaient à s’abstraire dans les
maths ou la philosophie thomiste. Je travaillais le droit et l’économie politique dans François
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%