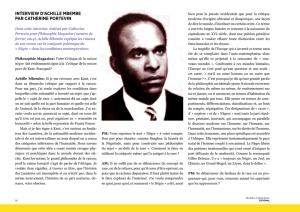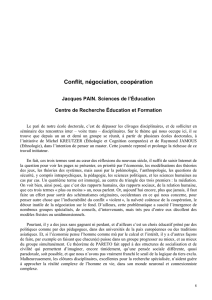De la montée en humanité. Violence et responsabilité chez Achille

Norman Ajari, «De la montée en humanité», Revue Ubuntou, no 1, 2013, pp. 20-31.
revue-ubuntou.org
20
De la montée en humanité. Violence et responsabilité
chez Achille Mbembe
Norman Ajari
1
Résumé
Cet article examine la notion de montée en humanité développée par le penseur camerounais Achille Mbembe. À
partir d’un examen de la violence d’État ainsi qu’elle s’est exercée dans les colonies et d’une attention à ses
mutations postcoloniales, il tâche de dégager les modalités de la déshumanisation, comprise comme
l’installation d’une indistinction entre vie et mort. Si l’extraction de cette situation exige une contre-violence, ce
n’est que si elle est assortie d’une responsabilité pour les victimes, les morts, les déshumanisés déjà disparus,
que peut s’effectuer une véritable montée en humanité. C’est-à-dire l’invention collective de nouveaux modes de
vie.
Abstract
The article examines the notion of rise in humanity developed by Cameroonian thinker Achille Mbembe.
Bringing into consideration the state violence as it has been exerted in the colonies and paying attention to its
postcolonial alterations, the article tries to deliver the modalities of the dehumanization conceived as
establishing a zone of indistinction between life and death. If the withdrawal from this situation necessitates a
counter violence, the latter has to be provided with a responsibility for the dead and already disappeared victims
of dehumanization, so that a true rising to humanity be possible. In other words, a collective invention of new
life modes is required.
Mots clés
Achille Mbembe – Colonialisme – Postcolonial – Violence – Humanisme – Responsabilité.
Keywords
Achille Mbembe - Colonialism - Postcolonial - Violence - Humanism - Responsibility - Africa – Mourning.
1
Doctorant contractuel à l’université de Toulouse le Mirail (France) où il prépare une thèse sur la pensée
politique de Frantz Fanon.

Norman Ajari, «De la montée en humanité», Revue Ubuntou, no 1, 2013, pp. 20-31.
revue-ubuntou.org
21
Je t’offre ce dossier afin que nul ne meure, ni les morts d’hier ni les
ressuscités d’aujourd’hui.
Je veux ma voix brutale, je ne la veux pas belle, ne la veux pas pure,
je ne la veux pas de toutes dimensions.
Je la veux de part en part déchirée, je ne veux qu’elle s’amuse car
enfin, je parle de l’homme et de son refus, de la quotidienne pourriture
de l’homme, de son épouvantable démission.
Frantz FANON, « Lettre à un Français »
2
.
Introduction
Il est difficile de ne pas donner raison à Alain Badiou lorsqu’il écrit qu’aujourd’hui, « la
philosophie politique n’est que la servante érudite du capitalo-parlementarisme
3
», tant il est
vrai que la réaction humaniste des années 80 et 90 dirigée conjointement contre le
poststructuralisme et le marxisme semble ne pas avoir su développer un discours capable de
se démarquer d’une autocongratulation vulgaire de l’Occident libéral. Pour autant, il n’est pas
certain que la voie la plus volontiers privilégiée par certains théoriciens radicaux
contemporains, qui consiste en une soumission des questions de la théorie politique et sociale
à des constructions métaphysiques ou à quelque investigation ontologique, soit la plus
judicieuse. Ces recours à la spéculation théorétique, dont les travaux de Slavoj Žižek ou
d’Alain Badiou fournissent de bons exemples, témoignent d’une incapacité, au demeurant très
largement partagée, à penser les modifications contemporaines de l’économie politique ou de
la structure du pouvoir d’État. Demeure pourtant, comme un legs laissé en déshérence,
l’enseignement par Marx de l’inféodation de la théorie à la base, aux conditions matérielles de
production des idées. Les sciences sociales, tout au long du XXe siècle, ont pu concourir à
raffiner et à préciser cette conception d’une interdépendance de la philosophie, de la politique
et de l’économie, faisant de la compréhension de leurs relations l’indispensable préalable à
toute élaboration théorique. Est dès lors devenue suspecte toute prétention à la détention de
« vérités éternelles ». Il n’est pas certain que la partie du champ philosophique encore
soucieuse d’émancipation ait plus à gagner qu’à perdre en enjambant ces conclusions.
L’un des enjeux de ce texte, et qui n’est pas celui de l’auteur dont il traite, consistera
donc en une interrogation sur les conditions de possibilité et la pertinence d’une pensée
critique qui ne tenterait pas de combler les lacunes de sa compréhension sociale en troquant
l’étude des rapports de force réels contre un idéalisme dont la vogue, on commence à le voir,
n’a contribué qu’à une dépolitisation du questionnement philosophique universitaire. Le
« tournant ontologique » des diverses formes de réalisme spéculatif se caractérisent par
l’abandon du projet communiste qui était pourtant le motif fondamental des investigations
d’un Badiou. Le présent texte suggère donc, à partir de la prise en compte de cette
conjoncture de la pensée contemporaine, que les concepts élaborés par le politologue
camerounais Achille Mbembe sont susceptibles de contribuer à la reformulation d’une
philosophie pratique non sujette aux justes critiques du type de celles qu’émet Badiou. Et ils
le font en reposant la question, tantôt abandonnée, tantôt mal posée, de l’homme. Il s’agit
d’affirmer qu’une autre voie était possible, à partir d’une autre remise en cause de l’idéologie
humaniste :
L’avènement de la pensée postcoloniale au cours du dernier quart du XXe siècle
coïncide donc avec la tentative, en France, de sortie des marxismes (officiels ou
2
Frantz Fanon, « Lettre à un Français », Pour La Révolution africaine, Paris, La Découverte, 2006, p. 57.
3
Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, Paris, Lignes, 2009, p. 32.

Norman Ajari, «De la montée en humanité», Revue Ubuntou, no 1, 2013, pp. 20-31.
revue-ubuntou.org
22
d’opposition) et l’arraisonnement de la pensée par le projet antitotalitaire.
Contrairement aux intuitions de Hannah Arendt, la plupart des théories françaises du
totalitarisme sont cependant oublieuses non seulement du fascisme et du nazisme, mais
aussi du colonialisme et de l’impérialisme. C’est que, pauvre théoriquement, le concept
de « totalitarisme » fonctionne avant tout, et à quelques exceptions près, à la manière
d’une matraque. Son élaboration est subordonnée aux impératifs de politique intérieure
française, et on l’utilise d’abord pour instruire le procès du marxisme.
4
Ces intellectuels français, tout à leur entreprise massive de délégitimation du
socialisme, en ont oublié un phénomène « totalitaire » qui s’est déroulé à la périphérie de leur
propre nation : l’expérience coloniale. En schématisant, on pourrait dire que là où la réaction
humaniste et libérale à la « pensée 68 » avait entretenu un bien peu kantien confusionnisme
entre homme et sujet (transcendantal, de droit, politique, le tout mêlé), le communisme
lacanien (Badiou et Slavoj Žižek notamment) a abandonné la première catégorie pour adopter
la seconde en en infléchissant radicalement le sens. Or, c’est bien la question de l’homme que
la pensée de la décolonisation a, pour sa part, eu besoin de reposer à nouveaux frais. Selon
cette pensée, le danger essentiel de l’humanisme moderne, ce n’est pas que, selon une ligne
heideggérienne dont l’influence fut longtemps surestimée, il participerait à quelque
déploiement métaphysique de l’arraisonnement et de la violence totalitaire qui le
retourneraient en son contraire
5
; c’est le fait que son opération fondamentale consiste en un
traçage à même la vie entre l’humanité authentique et son déchet. Pour Mbembe, « la
souveraineté, est la capacité à définir qui a une importance et qui n’en a pas, qui est dénué de
valeur et aisément remplaçable, et qui ne l’est pas
6
». L’importance des définitions normatives
et prétendument universelles de la nature humaine réside dans la formulation du projet qu’elle
vise à légitimer. Pour la pensée de la décolonisation, le danger demeure la détention par une
fraction de la population de la capacité à décider de la définition positive de l’humanité.
Privilégiant cette troisième voie, il s’est agi pour Achille Mbembe de faire jouer, contre
l’humanisme ranci du sujet libéral, une pensée de la montée en humanité, c’est-à-dire du
mouvement interminable d’arrachement à la violence comme fabrication de l’homme. S’il
s’agit là d’une proposition importante pour la philosophie politique et sociale contemporaine,
c’est à trois titres. Tout d’abord, elle offre une clef de lecture nouvelle et édifiante qui invite à
parcourir l’histoire des idées de l’Afrique et de sa diaspora comme une histoire d’efforts
athlétiques d’humanisation, formulés sous des formes diverses en fonction des conjonctures.
Ensuite, elle ouvre la voie à un réinvestissement des études postcoloniales, parfois négligentes
des rapports agonistiques, des violences et des contradictions, non seulement au sein des
systèmes représentationnels, mais aussi dans la société réelle. Enfin, elle rend possible, à
partir de Frantz Fanon et en vue de la formulation d’une pensée politique nouvelle, une
réappropriation de la notion d’humanité dont on vient, bien trop grossièrement, de rappeler
quelques récentes aventures françaises. On se situera ici en-deçà de ce triple objectif dont il
s’agit pourtant de faciliter la mise en œuvre, puisqu’on se contentera de proposer une
définition du concept, ainsi qu’il s’affirme dans les travaux récents d’Achille Mbembe.
Rompant avec le strict point de vue de l’histoire et des sciences politiques qui marquait ses
premiers travaux, il y affirme courageusement la nécessité d’« interroger la vie et le politique
différemment, à partir de catégories dont la valeur heuristique découle avant tout de leur plus-
4
Achille Mbembe, Sortir De La Grande Nuit, Paris, La Découverte, 2010, p. 130.
5
Luc Ferry et Alain Renaut, La Pensée 68, Paris, Gallimard, 1985, pp. 33-34.
6
Achille Mbembe, « Nécropolitique », in : Raisons politiques, n° 21, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 43.

Norman Ajari, «De la montée en humanité», Revue Ubuntou, no 1, 2013, pp. 20-31.
revue-ubuntou.org
23
value philosophique, littéraire, artistique, esthétique et stylistique
7
». C’est ce chemin, qui
reste encore à frayer, qu’on aura ici à explorer.
La triple violence coloniale
Le trait essentiel qui sépare les vues d’Achille Mbembe de celles des humanistes
libéraux précédemment évoqués, c’est que ce dernier s’inscrit consciemment dans la tradition
d’une « pensée de la décolonisation », pour laquelle « l’humanité n’existe pas a priori. Elle
est à faire surgir
8
» selon la guise de ce qu’il appelle une montée en humanité.
L’anthropologie politique n’est donc pas, comme dans la tradition libérale, le préalable à
quelque prescription quant à l’organisation de la vie sociale. Il s’agit plutôt de formuler « une
pensée de la vie et de la responsabilité, mais à travers le prisme de ce qui dément les deux
9
».
C’est-à-dire que penser la question de l’homme revient avant tout à définir les réseaux de
pouvoir qui sont à l’œuvre pour que certains individus soient empêchés de se définir eux-
mêmes comme des êtres humains. Par conséquent, poser cette question revient à poser celle
de la violence.
Mbembe identifie chez Frantz Fanon, qu’il tient pour l’un de ses plus importants
prédécesseurs au sein du paradigme philosophique de la décolonisation, trois formes de la
violence coloniale qu’il s’est lui-même réappropriées. La compréhension de ces trois types de
violence est importante en cela qu’elles rendent possible une définition d’un milieu
spécifique, celui de la colonisation
10
, qui fut vécu comme une radicale dénégation de leur
l’humanité par de très nombreux penseurs politiques noirs, dont Mbembe capte consciemment
l’héritage aux fins de proposer une reformulation de la théorie politique. « Cette récusation
originaire de l’humain dans l’africain […] cette tentative de confinement dans la différence
brute, ce ravalement primitif du signe africain, c’est ce que Senghor, Césaire, Fanon et les
autres se sont efforcés de contredire, parfois vaille que vaille, en fonction des moyens de leur
temps.
11
» C’est dans cette lignée que s’inscrit le travail de Mbembe sur la violence, qui
entend la réinvestir à partir de la réflexion philosophique et éthique contemporaine ainsi que
des acquis des sciences sociales.
La première forme de violence de la typologie fanonienne dégagée par Mbembe, c’est
la violence « instauratrice »
12
, ou « fondatrice »
13
: celle qui rend possible la colonie en y
posant une organisation inédite de la souveraineté et du monopole de la violence. Il s’agit
d’une perversion juridique, qui emprunte au contractualisme aussi bien qu’à un monstrueux
surgeon du jusnaturalisme : « cette forme de souveraineté, faite de possessivité, d’injustice et
de cruauté, se conçoit elle-même comme investie d’un “fardeau” qui n’est cependant pas un
contrat.
14
» La fiction fondatrice de l’origine de droit colonial réside ainsi dans un imaginaire
du fardeau supporté par une certaine race, ce qui pose évidemment le problème de la
responsabilité. Ce point fut notamment examiné dans l’œuvre du juriste Arthur Girault :
7
Achille Mbembe, De La Postcolonie, Paris, Karthala, 2005, p. XXXII.
8
Achille Mbembe, Sortir De La Grande Nuit, op. cit., p. 69.
9
Ibid., pp. 85-86.
10
Mais également de la traite et de l’esclavage, qui ne pourront malheureusement pas être abordées dans ce bref
essai.
11
Achille Mbembe, De La Postcolonie, op. cit., pp. XI-XII.
12
Achille Mbembe, « La pensée métamorphique. À propos des Œuvres de Frantz Fanon », in : Fondation Frantz
Fanon (dir.), Frantz Fanon par les textes de l’époque, Paris, Les Petits Matins, 2012, p. 17.
13
Achille Mbembe, De La Postcolonie, op. cit., p. 42.
14
Ibid., p. 56.

Norman Ajari, «De la montée en humanité», Revue Ubuntou, no 1, 2013, pp. 20-31.
revue-ubuntou.org
24
La colonisation se conçoit donc [chez Girault] comme l’action tutélaire exercée par les
populations civilisées pour prendre en charge le retard des groupes humains les plus
faibles. […] La colonisation est l’acte par lequel les sociétés plus évoluées se font sujets
actifs et conscients du procédé éducatif qu’est la civilisation du monde, en prenant en
charge les responsabilités dérivant directement de leur degré supérieur d’évolution.
15
La nation colonisatrice ne se représente pas seulement comme responsable d’elle-même,
mais aussi comme responsable de cette colonie peuplée d’indigènes « mi-démons mi-
enfants » (Rudyard Kipling). Elle se rêve le père sévère, mais juste, de ce peuple-là. Les races
européennes portent avec d’autant plus de douleur cette responsabilité qu’elle n’est pas la
leur, mais celle, aussi fragile qu’erratique, de sauvages qu’il leur appartient d’éduquer avant
de leur restituer leur majorité juridique. Cette première forme de violence est donc, pour
employer un vocable marxiste, purement superstructurelle. Elle impose une recomposition de
la souveraineté au moyen d’une réactivation de l’état de nature qui assure la séparation du
colonisé d’avec sa propre responsabilité. Il convient d’être attentif à ce dernier syntagme,
« réactivation de l’état de nature », où l’importance du premier terme n’est pas à mésestimer.
Pour le préciser, il est indispensable d’examiner une seconde forme de violence.
« La violence coloniale était, ensuite, une violence empirique. Elle enserrait la vie
quotidienne du peuple colonisé sur un mode à la fois réticulaire et moléculaire. »
16
Ici aussi, il
faut compléter cette théorie en recourant aux arguments de De La Postcolonie, qui font état
d’une violence permanente, intégrée. S’il semble légitime, à propos de cette situation, de
parler d’état de nature réactivé, c’est que comme dans la fiction hobbesienne, le droit de tuer
est partout consacré. Ainsi qu’on vient de le souligner, « la souveraineté en colonie relève,
non du droit, mais du fait accompli »
17
. Mais le milieu, le développement technologique et le
partage des forces ne sont pas ceux qu’envisageait la philosophie politique classique : une
partie de ces hommes est armée de fusils, retranchée dans certaines zones construites à cet
effet, dispose de moyens de communication sophistiqués. L’état de nature réactivé l’est dans
un contexte où les détenteurs de la souveraineté disposent des moyens modernes de tuer et
d’éviter de se faire tuer. La technique ne cesse de faire irruption dans la situation pseudo-
naturelle, la parasitant de l’intérieur et en infléchissant radicalement les conséquences. Cette
situation se double de ce que, pervertissant une notion foucaldienne, on pourrait appeler une
microphysique du pouvoir souverain : violence de détail qui passe par l’abolition de la
moderne frontière entre le public et le privé. « Les agents de la colonie pouvaient, à tout
moment, se saisir de la loi et de son excédent et, au nom du pouvoir souverain de l’État,
l’exercer aux fins d’un profit purement privé. »
18
Le corps du colonisé devient ainsi la surface
d’inscription d’un pouvoir à même d’agir sur lui à tout moment, l’insérant virtuellement dans
une multitude de rapports de répression ou d’expropriation, tels que l’exploitation sans
contrepartie de sa force de travail, la confiscation de ses biens, la reconfiguration forcée de
ses appartenances sociales, familiales ou religieuses, etc. Ce que signifie cette violence
empirique ou permanente, et c’est cela même qui rend possible ce que Frantz Fanon appelle le
« complexe d’infériorité » du colonisé, c’est que le pouvoir souverain et le corps du colonisé
semblent à ce point coextensifs que c’est la « nature » même de l’indigène qui passe pour la
cause légitime des sévices subis. C’est l’un des effets du colonialisme : l’ordre réel des causes
et des effets se renverse, le colonisé considère que son appartenance ethnique et culturelle est
15
Dino Costantini, Mission civilisatrice. Le rôle de l’histoire coloniale dans la construction de l’identité
politique française, Paris, La Découverte, 2008, p. 100.
16
Achille Mbembe, « La pensée métamorphique. À propos des Œuvres de Frantz Fanon », art. cit., p. 17.
Italiques dans l’original.
17
Achille Mbembe, De La Postcolonie, op. cit., p. 232.
18
Ibid., p. 47.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%