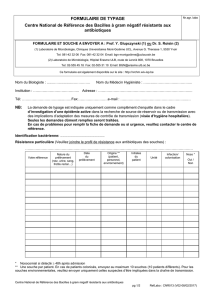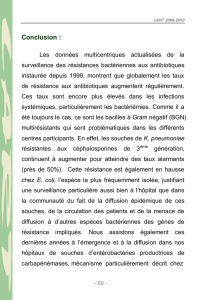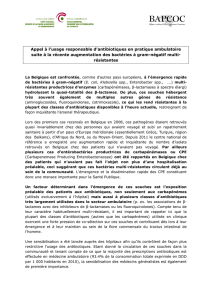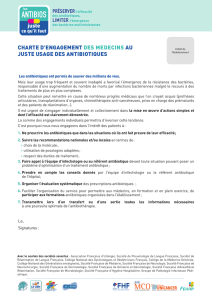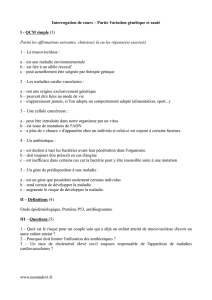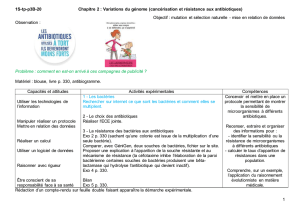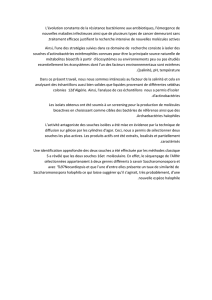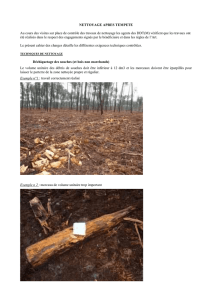introduction

1
INTRODUCTION
INTRODUCTIONINTRODUCTION
INTRODUCTION
En dépit de l'essor de la synthèse des antibiotiques, médicaments "miracles" du
20
ème
siècle, l'idée d'avoir vaincu toutes les maladies infectieuses est aujourd'hui
révolue.
Une telle situation serait assurément due à l'évolution de la résistance aux
antibiotiques des espèces bactériennes surtout celles habituellement sensibles aux
molécules classiques telles que les pneumocoques et les haemophilus (14, 36).
La découverte et la synthèse de différents types d'antibiotiques avec des modes
d'administration de plus en plus aisés, ont favorisé leur abus entraînant l'apparition
fréquente d'une antibiorésistance.
Ainsi, aujourd'hui la surveillance de la résistance aux antibiotiques des
souches des espèces les plus fréquemment isolées à Dakar paraît une nécessité. La
pathologie infectieuse y reste en effet extrêmement fréquente et l'antibiothérapie
constitue l'essentiel de la thérapeutique en médecine curative et parfois préventive
(3).
Afin d'aider les cliniciens dans le choix d'une antibiothérapie de première
intention adaptée aux données épidémiologiques locales et de réduire la pression de
sélection exercée par les antibiotiques, nous avons jugé indispensable d'analyser les
antibiogrammes réalisés au laboratoire de bactériologie de l'HALD.
En effet, la prescription d'antibiotiques presque exclusivement probabiliste en
médecine de ville, doit se baser sur les fréquences d'isolement des bactéries dans la
pathologie concernée et sur leur profil antibiotique dans l'environnement considéré.

2
Durant la période du 13 Novembre 1995 au 31 Mai 1996, nous avons procédé
à l'étude qualitative et quantitative des isolements bactériens et de leur profil
antibiotique.
Mais auparavant une première partie donnera quelques généralités sur les
antibiotiques.

3
GENERALITES SUR LES ANTIBIOTIQUES
HISTORIQUE (47)
La chimiothérapie prit son véritable essor en 1909 lorsque EHRLICH formula
le principe de base suivant : pour être utilisable par voie générale dans le traitement
des maladies infectieuses, une substance doit être nuisible pour le micro-organisme
parasite mais inoffensive pour les cellules hôtes. Elle doit être douée de "toxicité
sélective". Les antibiotiques et les sulfamides ont cette qualité.
L'étude systématique des composés organiques de synthèse conduisit
EHRLICH à la découverte des arsphénamines, dérivés arsenicaux actifs dans le
traitement de la syphilis, leur chef de file étant le Salvarsan. C'était la première
grande victoire de la chimiothérapie.
Une deuxième étape fût franchie en 1935, lorsque DOMAGK démontre qu'un
colorant diazoïque, la parasulfamidochrysoïdine Prontosil, était capable de guérir
les infections streptococciques expérimentales de la souris. Les travaux de l'Institut
Pasteur démontrèrent que la partie active est le sulfamide.
La troisième étape fût celle des antibiotiques. L'ère véritable des antibiotiques
commença en 1929 lorsque Sir Alexander FLEMMING fit cette observation : sur un
boîte de Pétri ensemencée avec des staphylocoques, la présence de quelques colonies
d'une moisissure du genre Penicillium, un contaminant, provoque une inhibition de
la croissance des bactéries mises en culture. Il en déduisit que ce champignon
sécrétait une substance bactériostatique. En cultivant en masse le Penicillium, il
montra que les filtrats obtenus étaient bactéricides sans être toxiques pour les
cellules animales. Il proposa d’appeler « pénicilline » le principe actif de ces filtrats.

4
Cette découverte serait probablement tombée dans l'oubli si, en 1939, deux
chercheurs FLOREY et CHAIN, n'avaient entrepris d'extraire et de purifier la
pénicilline.
Les résultats furent spectaculaires. On parla de drogue miracle.
A partir de 1939, des centaines d'antibiotiques furent isolés, sélectionnés et
soumis aux essais thérapeutiques. C’est l’âge d'or des antibiotiques qui s'étend
pendant une vingtaine d'années.
Depuis 1965, une nouvelle période semble prolonger cette époque glorieuse.
Elle est caractérisée par les antibiotiques semi-synthétipues, en particulier les β-
lactamines.
I- DEFINITION
.
Au sens strict, les antibiotiques sont des agents antibactériens naturels
d'origine biologique ; ils sont élaborés par des micro-organismes, champignons et
diverses bactéries. Cependant quelques uns sont maintenant produits par synthèse, et
beaucoup parmi les produits employés actuellement, sont des dérivés semi-
synthétiques préparés par modification de produits de base naturels. D'autres
médicaments antibactériens, tels les sulfamides, les quinolones ou les furanes sont
des substances chimiques de synthèse mais leurs propriètés ne les distinguent pas des
antibiotiques ; ce sont, d'un point de vue pratique, des antibiotiques à part entière, ce
qui justifie leur étude conjointe.

5
Leurs propriétés communes sont les suivantes : les antibiotiques, bien que
souvent non dépourvus d'effets secondaires pour les cellules eucaryotes, se
distinguent essentiellement par leur toxicité sélectivement dirigée contre les
bactéries. Ceci permet, pour la plupart d'entre eux, de les administrer par voie
générale et fait d’eux les médicaments des infections systémiques. Cette toxicité
sélective est directement liée à leur mécanisme d'action : la plupart des antibiotiques
agissent par inhibition spécifique d'une étape précise de certaines chaînes
métaboliques chez les bactéries qui constituent leur site d'action, ou cible
moléculaire.
Les réactions inhibées sont essentiellement des réactions de synthèse :
synthèse protéique, synthèse du peptidoglycane, des acides nucléiques, des folates.
L'effet antibactérien des antibiotiques s'exerce à de faibles concentrations, ce
qui contribue aussi à leur tolérance par l'organisme, de l'ordre du mg par litre et
parfois beaucoup moins ; il est relativement lent, demandant souvent quelques heures
; il peut être bactériostatique ou bactéricide selon la concentration et le temps de
contact. (25)
Un antibiotique est donc une substance naturelle, semi-synthétique ou
synthétique, douée d'une activité antibactérienne à l'échelon moléculaire, s'exerçant
au niveau d'une ou de plusieurs étapes métaboliques ou d'un équilibre physico-
chimique (47).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
1
/
163
100%