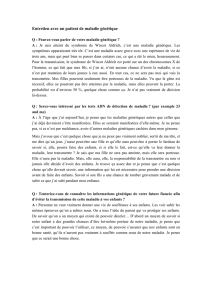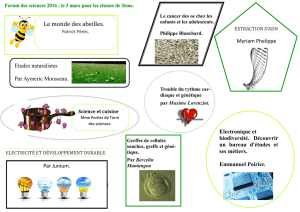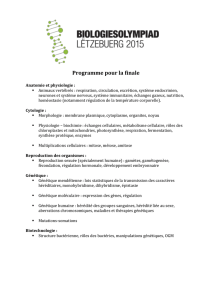Possibilités actuelles et implications des analyses génétiques du

Introduction
Les formidables progrès de la recherche génétique
ont permis d’introduire un nombre croissant de
tests diagnostiques de routine dans la pratique cli-
nique. Le décryptage du génome humain, qui a
entre-temps fait le tour du monde, permet de diffé-
rencier et de préciser toujours davantage les prédis-
positions individuelles à certaines maladies hérédi-
taires [1, 2]. Cette évolution a pour effet de nous
placer de plus en plus souvent dans notre activité
quotidienne face à des cas de maladie génétique
avec ce que cela implique en matière de conseil
aux patients et à leurs parents (cf. remarque du tab.
1 p). La Loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH)
a été adoptée en Suisse par les Chambres fédérales
en octobre 2004. En attendant la promulgation de
l’ordonnance d’application (cela devrait être chose
faite dans le courant de cette année), la réalisation
des tests génétiques se réfère à la formulation pro-
prement dite des articles de la loi.
En cas de suspicion de maladie d’origine génétique,
une série de réflexions s’impose avec la prise en
considération d’intérêts divers, ceux du médecin
traitant, mais aussi et surtout ceux du patient et de
ses proches parents, notamment dans l’optique
de leurs projets de vie. Dès la demande d’analyse
génétique, le praticien devrait être conscient des
conséquences éventuelles que pourrait avoir pour
l’intéressé le fait de savoir qu’il souffre d’une ma-
ladie potentiellement fatale. La décision de procé-
der à une telle analyse implique pour chaque pa-
tient le risque d’être confronté à un diagnostic lourd
de conséquences. Cet article a pour objectif de
donner un bref aperçu du rôle que peut jouer au-
jourd’hui l’analyse génétique dans la pratique cli-
nique quotidienne et de montrer comment l’utiliser
judicieusement. Les différents aspects du conseil
génétique en médecine de l’adulte seront discutés
dans le cadre d’une clinique psychogériatrique.
Exemple de la pratique
clinique quotidienne
Une femme de 53 ans s’est présentée dans notre
centre de recherche ambulatoire de psychogéria-
trie avec un tableau psychiatrique évoluant depuis
quelque temps et suggestif d’une démence débu-
tante. Plusieurs consultations neurologiques et
psychiatriques, motivées par des symptômes dé-
pressifs et des troubles de la personnalité, avaient
déjà eu lieu, mais sans qu’un diagnostic de certi-
tude ait pu être posé. Les différents traitements
entrepris jusque-là n’avaient pas pu empêcher la
progression de la maladie. Les investigations fai-
tes précédemment, soit les examens de labora-
toire classiques dans les cas de démence, une IRM
du cerveau et même un PET scan, n’avaient pas
permis de tirer la situation au clair; en revanche,
les troubles neuropsychologiques avaient fait
conclure à la présence d’une démence. Les dé-
marches entreprises à la recherche d’une éven-
tuelle chorée de Huntington avaient été abandon-
nées auparavant à la demande de la famille, bien
qu’une parente directe de la patiente présentait
elle aussi une maladie neuropsychiatrique d’étio-
logie incertaine, mais faisant penser à une affec-
tion dégénérative du système nerveux. L’anam-
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:172–176 172
Possibilités actuelles et implications des
analyses génétiques du point de vue du clinicien
Alkis Yannakopoulos Salili
Clinique psychogériatrique, Centre de psychogériatrie de Hegibach, Zurich
Quintessence
쎲Les analyses génétiques occupent une place de plus en plus importante dans
la pratique clinique de tous les jours.
쎲Le bon emploi des tests génétiques requiert une appréciation soigneuse
des bénéfices potentiels et des conséquences éventuelles non seulement pour
le patient, mais aussi pour ses proches parents.
쎲La Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) a été votée en octobre
2004 et règle les questions relatives au traitement des informations génétiques.
쎲Une analyse génétique ne devrait être effectuée en médecine humaine que
si elle peut entraîner des conséquences diagnostiques, thérapeutiques et/ou
préventives significatives pour le patient et sa proche parenté et si la question
a fait l’objet d’une discussion approfondie avec tous les intéressés.
Summary
Possibilities and implications of current genetic
diagnosis in everyday clinical practice
쎲Genetic investigations are assuming a growing importance in everyday clin-
ical practice.
쎲The use of genetic tests requires careful weighing of the anticipated benefit
and implications for the patient, and also for his family.
쎲In October 2004 Switzerland passed a “Federal Law on Genetic Testing of
Humans (GUMG)” which regulates the use of genetic information.
쎲Genetic tests should be performed in medicine only if the diagnostic, thera-
peutic or preventive implications are acceptable to the patient or his family
and if they are fully informed after an extended discussion.
Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article à la page 159 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.

Tableau 1. Aperçu des maladies génétiques évoquées dans l’article.
Maladie, syndrome
1.1 Early-onset familial
Alzheimer’s disease
(EOFAD)
1.2 Chorea Huntington
1.3 Polypose adénomateuse
familiale du côlon (FAP)
1.4 Hereditary nonpolyposis
colorectal cancer (HNPCC)
1.5 Cancer du sein familial
(hereditary breast cancer)
Remarque: Comme chacun le sait, la recherche génétique est en constante mutation. Les indications sur la signification clinique des différents
tests génétiques (par ex. importance prédictive des tests) n’ont qu’une valeur indicative à un moment donné. Pour obtenir des informations précises
sur l’opportunité de réaliser telle ou telle analyse génétique, il convient donc de demander conseil dans chaque cas, après une anamnèse familiale
très soigneuse, auprès de l’un des instituts de génétique médicale.
Le fait de connaître l’existence d’une maladie hé-
réditaire charge l’intéressé d’une grande responsa-
bilité: il va devoir décider de transmettre ou non la
nouvelle qu’il vient d’apprendre à ses proches. Or,
il se trouve précisément que, dans le domaine de la
psychogériatrie, les patients ont souvent perdu
toute ou partie de leur capacité de jugement. Dans
le cas présent, les proches, donc le ou la partenaire
et les enfants en âge adulte, sont appelés à par-
ticiper directement, en qualité de représentants
légaux, aux investigations et à la transmission
d’un diagnostic qui ne manquera pas d’avoir des
conséquences directes sur leur propre existence.
Ces réflexions illustrent déjà à elles seules tous les
aspects pratiques, éthiques et juridiques à consi-
dérer lorsqu’on songe à demander une analyse
génétique. Une collaboration étroite entre spécia-
listes est donc hautement souhaitable, de manière
à ne pas uniquement se focaliser sur le diagnos-
tic et le traitement éventuel, mais de prendre aussi
en compte le conseil aux patients et leur suivi
ultérieur. Cela concerne tout particulièrement le
conseil présymptomatique, i.e. l’information des
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:172–176 173
nèse familiale détaillée (analyse de l’arbre généa-
logique), effectuée dans le cadre du réexamen de
la situation, a conduit à renouveler la recomman-
dation de recherche d’une chorée. La patiente et
ses proches parents ont fini par accepter de se
soumettre à une analyse qui a effectivement
confirmé la présence d’une chorée de Huntington.
La patiente et ses proches (époux et filles) ont été
informés, au cours d’un entretien approfondi, des
implications de ce diagnostic, puis adressés à
l’Institut de génétique de l’Université de Zurich.
Cet exemple montre que des éléments nouveaux,
souvent dramatiques, peuvent parfois apparaître
et justifier un conseil spécialisé, alors même que
la maladie évolue depuis longtemps. Le fait de
poser un «vrai diagnostic» (à substrat organique)
dans des situations fréquemment taxées précé-
demment de «maladie psychiatrique» peut certes
apporter un soulagement, mais peut aussi et
surtout placer le patient face à une réalité autre-
ment lourde de conséquence, celle d’une maladie
héréditaire susceptible d’impliquer ses propres
enfants.
Particularités de l’analyse génétique
Test possible en cas d’indices en faveur
d’un Alzheimer familial (début avant l’âge
de 65 ans; seulement 3% des cas sont
avant 55 ans et avec plus d’un cas dans
la famille) mais test sans conséquences
thérapeutiques
Diagnostic en cas d’anamnèse familiale
positive, de clinique typique et
d’expansion du triplet CAG
Importantes implications pour le planning
familial, mais pas d’indications pré-
cliniques sur l’évolution de la maladie
au niveau individuel
Implications dans l’optique des examens
préventifs et du traitement (colectomie),
en particulier en cas de clinique douteuse
(par ex. moins de 100 polypes adénoma-
teux avec une anamnèse familiale positive)
En association avec une analyse de l’arbre
généalogique, implications importantes
dans le sens d’examens préventifs!
Importance pour les tests préventifs en
raison de l’hétérogénéité du mécanisme
uniquement avec un examen détaillé
de l’arbre généalogique et une analyse
des mutations chez les sujets concernés!
Informations complémentaires sous
www.alzforum.org
Alzheimer Research Forum –
Homepage et forum internet pour
la recherche, la base de données
génétique, les drug news, notam-
ment en relation avec la maladie
d’Alzheimer
www.geneclinics.org
(gene reviews, Alzheimer)
www.ncbi.nlm.nih.gov
(OMIM, Huntington)
www.geneclinics.org
(gene reviews, Huntington)
www.ncbi.nlm.nih.gov
(OMIM, polyposis)
www.geneclinics.org
(gene reviews, polyposis)
www.ncbi.nlm.nih.gov
(OMIM, HNPCC)
www.geneclinics.org
(gene reviews, HNPCC)
www.ncbi.nlm.nih.gov
(OMIM, breast cancer)
www.geneclinics.org
(gene reviews, breast cancer)
Mécanisme génétique
Mutation des gènes
PSEN-1
,
PSEN-2
et
APP
Dominante autosomale.
Haute pénétrance pour
PSEN-1
et
PSEN-2
Expansion du triplet CAG
dans le gène de
Huntington
(4p16.3)
Dominante autosomale
La pénétrance augmente en
fonction du nombre de triplets
(>36 repeats = significatif)
Autosomale dominante.
Mutation du gène
APC
(5q21-q22) avec genèse
tumorale consécutive
Pénétrance élevée,
mais expression variable
Mutation d’un gène de répa-
ration du DNA erroné (mis-
match), la plupart du temps
des gènes
MSH2
et
MSH1
Surtout mutation des gènes
BRCA 1
et
BRCA 2
Pénétrance augmentée,
mais difficilement
prédictible
au niveau individuel
Ovaire également touché

différences considérables entre les différentes
maladies en ce qui concerne le diagnostic pré-
symptomatique, surtout dans l’optique des consé-
quences thérapeutiques (cf. tab. 1). Dans tous les
cas de tests présymptomatiques, il est essentiel
que le résultat ait une haute valeur prédictive et
qu’il soit susceptible de conduire à des mesures
thérapeutiques utiles [3]. Une autre condition im-
portante est que toute analyse soit précédée d’une
anamnèse familiale approfondie, puisque c’est le
seul moyen de donner des indications quant à une
prédisposition familiale (cf. tab. 1). Il est par
exemple assez simple, en cas d’HNPCC, de faire
pratiquer des examens préventifs adéquats, soit
des coloscopies. Mais que dire des cas où les exa-
mens préventifs n’ont aucune conséquence sur
l’évolution de la maladie, comme par ex. les ma-
ladies dégénératives du système nerveux? Ainsi,
dans un cas de chorée de Huntington, la batterie
de tests présymptomatiques permettra aux in-
téressés d’adapter leur plan de vie, ainsi que
leurs objectifs familiaux et professionnels, en pré-
vision des événements éventuellement à venir.
Dans la maladie d’Alzheimer, le fait de connaître
une telle prédisposition pourrait être utile au début
de l’affection, lorsqu’il s’agit de prendre les me-
sures indiquées pour le maintien de la qualité
de vie de l’intéressé et de son entourage. Ici, l’ana-
lyse génétique n’est en revanche pas une condi-
tion nécessaire et est donc sans grande significa-
tion pratique. Pour les tests effectués dans le cadre
des études cliniques et montrant l’existence
d’un risque génétique, on s’en tient au principe
de l’anonymisation. Les résultats ne sont trans-
mis que lorsqu’ils impliquent des conséquences
directes sur le plan préventif et thérapeutique [3].
Les maladies neurodégénératives d’origine géné-
tique (ou génétiquement déterminées) constituent
un bon exemple de l’intérêt que revêt d’une manière
générale la recherche sur les mécanismes molécu-
laires et biochimiques en médecine. La connais-
sance de la présence de certaines mutations géni-
ques et de gènes à risque joue ainsi un rôle
prépondérant dans l’optique de la classification des
différents phénotypes des maladies à prions (mala-
die de Creutzfeldt-Jakob familiale [fCJD], pour n’en
citer qu’une) [4]. La recherche sur les mécanismes
génétiques moléculaires a également apporté des
éclaircissements sur la pathogenèse de la maladie
d’Alzheimer [5]. La connaissance des mécanismes
génétiques ne donne pas seulement des indications
précieuses sur le diagnostic proprement dit, mais
constitue aussi le point de départ des mesures pré-
ventives et de la démarche thérapeutique [6].
Questions importantes en relation
avec l’utilisation clinique des données
génétiques
Dans le contexte d’une analyse génétique, on
n’oubliera pas que la recherche dans ce domaine
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:172–176 174
adultes en bonne santé qui ont une anamnèse
familiale positive pour une maladie héréditaire
(LAGH, art. 13).
Dans le cas qui nous occupe, les filles de la pa-
tiente ont été adressées à l’Institut de génétique
de l’Université de Zurich pour une consultation
génétique. Il est possible, lors d’une chorée de
Huntington, de mettre en évidence une mutation
génétique pathogène, en l’occurrence une expan-
sion du triplet CAG, avant même les premiers si-
gnes de la maladie. Le résultat du test ne permet
cependant pas de tirer de conclusions précises
sur le moment d’apparition de la maladie, ni sur
son évolution. Il existe par contre une certaine cor-
rélation entre le nombre de répétitions de la
séquence et l’âge d’apparition des signes de la
maladie. Ainsi, un résultat indiquant jusqu’à
26 répétitions (de la séquence CAG) est considéré
comme normal, 27–35 répétitions parlent en
faveur d’une prédisposition à la mutation, 36–39
signent une pénétrance faible et plus de 40 une
pénétrance complète. La forme juvénile sévère de
la chorée est la plupart du temps caractérisée par
85 répétitions ou plus. Ces chiffres ne permettent
toutefois pas d’avancer un pronostic définitif dans
un cas donné. De plus, il n’existe à l’heure actuelle
aucun traitement, ni aucune mesure préventive
efficace (cf. tab. 1, sous 1.2).
En règle générale, les réactions des patients et des
proches susceptibles d’être soumis à une analyse
génétique motivée médicalement (à distinguer des
examens indiqués dans le domaine professionnel,
assécurologique ou en responsabilité civile – cf.
LAGH) sont très variables. De nombreuses person-
nes concernées ne désirent pas poursuivre les in-
vestigations une fois que le diagnostic de suspicion
a été posé. Ils en ont parfaitement le droit en vertu
de l’art. 18 de la LAGH. Un patient a également le
droit de ne pas informer ses proches de l’existence
d’un diagnostic de suspicion, ni même d’un diag-
nostic confirmé. En revanche, si un résultat de test
positif confirme la suspicion, chaque membre de la
famille qui a été informé a le droit ou le devoir de
décider lui-même s’il souhaite une analyse de son
propre risque. Les expériences faites en Suisse ont
montré, dans les cas de chorée de Huntington, qu’un
membre de la famille sur deux qui a été informé
décide ensuite de renoncer à une telle analyse [3].
Aperçu des maladies génétiques
les plus fréquentes dans la pratique
clinique quotidienne
A part la chorée de Huntington évoquée précé-
demment, les maladies héréditaires manifestes
chez l’adulte comprennent également les formes
familiales de la maladie d’Alzheimer, la forme hé-
réditaire du carcinome du côlon (hereditary non-
polyposis colorectal cancer – HNPCC), la polypose
adénomateuse colique familiale et les formes fa-
miliales de cancer du sein. Il existe cependant des

lyse génétique puissent avoir des conséquences
immédiates sur le plan préventif et/ou thérapeu-
tique [3].
Un article d’E. Wright Clayton [7] brosse un ex-
cellent tableau de l’état actuel de la discussion sur
les implications éthiques, sociales et légales de la
médecine génomique.
Bases juridiques et
recommandations de l’ASSM
La Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine
(LAGH), adoptée en octobre 2004, englobe, outre
un certain nombre de principes généraux, des
directives concernant l’utilisation de l’analyse
génétique dans le domaine de la médecine et
fixe les sanctions, par ex. en cas de tests effectués
sans accord préalable. La loi comporte aussi des
dispositions claires réglant les domaines du tra-
vail, des assurances et de la responsabilité civile.
Ces dispositions sont censées protéger les in-
dividus vis-à-vis des assureurs et des employeurs,
mais la seule connaissance de l’existence d’une
hérédité constitue en réalité déjà en soi un facteur
limitant la conclusion d’une assurance-vie ou
d’une assurance privée, puisque les assureurs po-
sent habituellement des questions sur l’existence
ou non de maladies héréditaires/familiales avant
la signature du contrat. Les assurances de base ne
sont par contre autorisées à demander ni des ana-
lyses génétiques, ni des informations sur d’éven-
tuelles prédispositions familiales (LAGH, sec-
tion 5). Les contrats d’assurance déjà existants
ne peuvent pas être annulés, ni réduits, à la suite
d’un résultat de test positif.
Contrairement à ce qui précède, les personnes
touchées n’ont aucune obligation d’information
vis-à-vis de leurs proches. Un individu porteur
d’une prédisposition familiale prouvée peut par
exemple se marier et concevoir des enfants sans
devoir informer son ou sa partenaire de l’exis-
tence de cette hérédité. Un médecin n’est pas non
plus autorisé à informer les proches parents sans
le consentement du patient. Si le patient n’a pas
toute sa capacité de jugement, ses représentants
seront par contre automatiquement informés des
résultats des tests.
Les coûts d’une analyse génétique sont pris en
charge, pour autant qu’ils figurent dans la liste
des indications. En cas de refus de prise en
charge de la part d’une caisse, il convient donc
d’insister pour qu’elle reconsidère la situation.
Chez les individus symptomatiques et présymp-
tomatiques, l’analyse génétique recherchant
la présence du gène de Huntington fait par exem-
ple partie des prestations obligatoirement rem-
boursées. Par mesure de sécurité, on vérifiera
cependant toujours, surtout pour les tests
demandés pour un patient présymptomatique,
si la caisse accepte bien la prise en charge (cf.
tab. 3 p, sous 3.2).
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:172–176 175
est en progrès constant. L’utilité finale d’une ana-
lyse génétique dépend en définitive toujours for-
tement de l’anamnèse familiale et de la signifi-
cation de chacun des tests chez un patient donné.
C’est la raison pour laquelle il importe de rediscu-
ter toutes les situations avec les spécialistes de
l’institut de génétique concerné avant de deman-
der l’analyse (cf. tab. 2 p).
Un médecin confronté à un patient chez qui il
suspecte une maladie héréditaire devra par ail-
leurs intégrer dans son conseil toutes les implica-
tions médicales, formelles, juridiques et éthiques
que sa démarche implique. Cela inclut les ques-
tions relatives aux conséquences immédiates pour
le patient: quels sont les moyens thérapeutiques
et symptomatiques disponibles? Le patient est-il
simplement à même de supporter un tel diagnos-
tic sur le plan psychique? Comment va-t-il gérer
la situation par rapport à ses proches? Le diag-
nostic a-t-il des conséquences sur sa capacité de
travail? Quelles seront les implications sur le plan
des assurances? (par ex. la caisse maladie prendra-
t-elle en charge le coût de l’analyse génétique?)
L’intéressé lui-même se demandera s’il va doré-
navant être dépendant d’un traitement, s’il va
devenir une charge ou même un danger potentiel
pour son entourage (par exemple en transmettant
la «tare héréditaire» à ses enfants) et s’il va pou-
voir conserver ses droits vis-à-vis de son em-
ployeur et des assurances en dépit de la maladie.
Lorsqu’un patient peut tirer d’une analyse géné-
tique spécifique un bénéfice immédiat, par exem-
ple thérapeutique, la majorité de ces préoccu-
pations passera évidemment dans un premier
temps au second plan. Mais lorsque la démarche
concerne des individus asymptomatiques, ces
divers aspects prendront une tout autre dimen-
sion et devront être abordés en détail dans le
cadre d’entretiens souvent multiples. On ajoutera
que le patient conserve toujours son «droit de ne
pas savoir», même après la réalisation de l’ana-
lyse génétique. Autrement dit, il a toujours le
droit de ne pas prendre connaissance du résultat.
Pour les enfants, le consensus actuel est de ne
pas les tester, à moins que les données d’une ana-
Tableau 2. Sites Internet des Instituts universitaires de génétique médicale en Suisse.
2.1 www.medgen.unizh.ch Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich
2.2 www.ukbb.ch/genetik.cfm Abteilung Medizinische Genetik des Universitäts-
Kinderspitals beider Basel
2.3 www.dkf.unibe.ch Departement Klinische Forschung der Medizinischen
Fakultät der Universität Bern
2.4 www.unil.ch/dgm Département de génétique médicale Faculté de
Biologie et de Médecine Université de Lausanne
2.5 www.chuv.ch/dml/dml_home/ Laboratoire du Service de Génétique Médicale (SGM)
dml_lge_home.htm du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de
Lausanne (CHUV)
2.6 www.medgen.unige.ch Division of Medical Genetics of the University of Geneva
Medical School and University Hospitals of Geneva
Tous ces sites proposent d’autres liens intéressants vers des domaines spécifiques
de la génétique.

res agréés (cf. aussi tab. 3, sous 3.8). On mentionnera
à ce propos que la sécurité des tests dans le domaine
de l’analyse génétique est en règle générale très éle-
vée. Les faux résultats sont véritablement exception-
nels, étant entendu que le contexte clinique peut
conduire à une vérification et éventuellement à une
révision du résultat. Normalement, un test n’a donc
besoin d’être effectué qu’une seule fois [8].
Résumé
La prise en charge des patients présentant une ma-
ladie héréditaire et de leurs proches exige de la part
du médecin consulté des compétences particulières
et rend préférable l’inclusion dans les discussions
d’un centre spécialisé au fait des recommandations
actuelles et des dispositions légales en vigueur. La
marche à suivre proposée par l’Académie Suisse des
Sciences Médicales est publiée sous forme de bro-
chure intitulée «Analyses génétiques dans la pra-
tique de tous les jours» (voir réf. [3], qui donne de
nombreuses informations utiles à ce sujet et peut
être obtenue par e-mail à l’adresse mail@samw.ch).
Cette publication contient les recommandations gé-
nérales faites par l’ASSM, ainsi que des renseigne-
ments détaillés sur certains domaines particuliers
du diagnostic génétique, notamment le diagnostic
prénatal et le planning familial. Elle contient égale-
ment le texte complet de la Loi fédérale sur l’ana-
lyse génétique humaine (LAGH) d’octobre 2004,
ainsi que quelques adresses importantes, par exem-
ple des institutions spécialisées dans le conseil
génétique, des organisations d’entraide, et une série
de sites internet sur la génétique en général et sur
certaines maladies héréditaires en particulier.
Remerciements
Je tiens à remercier tout spécialement le Prof.
A. Schinzel et le Dr D. Bartholdi de l’Institut de mé-
decine génétique de l’Université de Zurich pour leur
patience et leur disponibilité à répondre à mes ques-
tions concernant le conseil génétique, de même que
le Prof. Hansjakob Müller de l’Université de Bâle
pour ses précieux compléments d’informations. Je
remercie également mes collègues, les Dr J. Streffer
et U. Fischer, et surtout le Prof. Ch. Hock pour leurs
conseils avisés dans le domaine de l’analyse géné-
tique dans la pratique quotidienne.
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:172–176 176
Offres de conseils médicaux
et psychologiques
Les instituts de génétique sont non seulement en
mesure de fournir des informations détaillées, mais
offrent aussi un suivi psychologique externe. Ils dis-
posent par ailleurs des adresses des différentes or-
ganisations d’entraide à même de donner des
conseils pratiques, par exemple sur la façon de gérer
les questions d’assurances (cf. tab. 3, sous 3.9).
Dans les situations présymptomatiques ou prénata-
les, ainsi que dans le domaine du planning familial,
les dispositions légales en vigueur imposent le re-
cours à un conseil spécialisé que l’on trouvera plus
particulièrement dans les centres universitaires.
S’ajoute le problème de la capacité technique à réa-
liser l’analyse génétique. De nombreuses maladies
héréditaires sont extrêmement rares, si bien que les
laboratoires accrédités pour la réalisation de ces tests
sont eux aussi très peu nombreux. Dans le doute, les
instituts de génétique donneront les informations né-
cessaires quant aux tests à effectuer et aux laboratoi-
Tableau 3. Choix d’adresses utiles sur le thème du diagnostic génétique.
3.1 www.samw.ch Homepage de l’Académie Suisse des Sciences Médica-
les: directives sur l’analyse génétique humaine (1993).
3.2 www.bag.admin.ch/kv/ Office fédéral de la santé publique: prestations
gesetze/d/index.htm obligatoirement à charge des caisses maladie en
Suisse 3Liste des analyses.
3.3 www.sgmg.ch Société suisse de médecine génétique.
3.4 www.orphanet.org Site international sur des maladies rares, des activités
de recherche et des laboratoires de génétique.
3.5 www.geneclinics.org Site US contenant des informations détaillées sur
les maladies génétiques (3Gene Reviews),
les laboratoires de test et les institutions spécialisées
dans le conseil génétique.
3.6 www.ncbi.nlm.nih.gov Homepage du National Institute for Biotechnology
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim Information avec lien vers la base de données
«Mendelian Inheritance of Men» (OMIM): tout sur
le projet du génome humain, les mutations et
leur conséquences.
3.7 www.hgqn.org Homepage de l’association professionnelle des
spécialistes en génétique humaine d’Allemagne.
Propose aussi d’excellents liens vers les institutions
de génétique suisses et autrichiennes.
3.8 www.eddnal.com Homepage de l’UE: informations sur les diagnostics
génétiques spécifiques et les laboratoires habilités.
3.9 www.kosch.ch Informations sur les adresses de contact de groupes
d’entraide régionaux de Suisse et du Liechtenstein.
Pour d’autres adresses utiles, cf. [3].
Correspondance:
Dr A. Yannakopoulos Salili
Centre de psychogériatrie
de Hegibach
Clinique psychogériatrique
Minervastrasse 145
CH-8032 Zurich
Références
1 Bosshard G. Genommedizin – eine Standortbestimmung,
Schweiz Med Forum 2005;5:199–204.
2 Miny P. Medizinische Genetik: Visionen zur Zukunft der
Genommedizin und Frustrationen im Hier und Jetzt. Schweiz
Med Forum 2004;4:7–9.
3 Müller H, Imhasli P, Leuthold M. Genetische Untersuchungen
im medizinischen Alltag, Ein Leitfaden für die Praxis. Basel:
Schweizerische Akademie der Wissenschaften; 2004. Ce
guide peut être commandé sous mail@samw.ch.
4 Une vue d’ensemble détaillée sur les mutations du prion
se trouve sur Internet sous www.mad-cow.org/prion_point_
mutations.html.
5 Informations générales et spécifiques sur la recherche sur la
maladie d’Alzheimer sur Internet sous www.alzforum.org.
Les indications pour des traitements médicamenteux peu-
vent être intéressantes pour les praticiens.
6 Bertram L, Tanzi RE. The genetic epidemiology of neuro-
degenerative disease. Review series. J Clin Invest 2005;115:
1449–57.
7 Wright Clayton E. Ethical, legal and social implications of
genomic medicine. NEJM 2003;349:562–9.
8 Renseignements donnés par le Prof. Dr. A. Schinzel; voir
aussi sous www.medgen.unizh.ch.
9 Müller H. Gentests – Antworten zu Fragen aus der medizini-
schen Praxis. Basel: Karger; 2005. Ce guide contient de pré-
cieuses indications pour les patients concernés et leurs
proches mais aussi pour les médecins.
1
/
5
100%