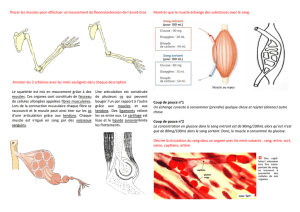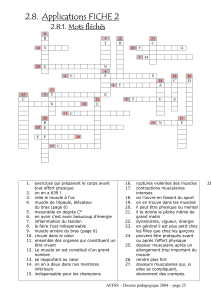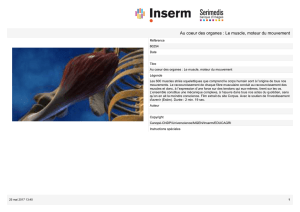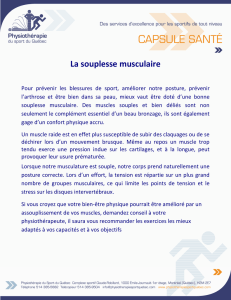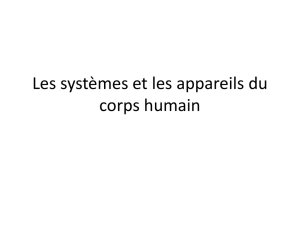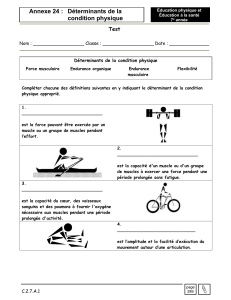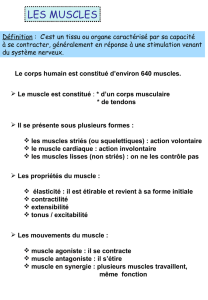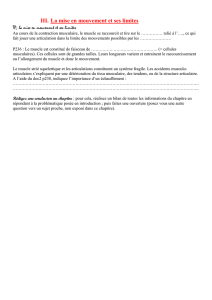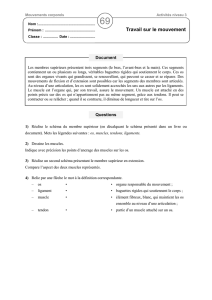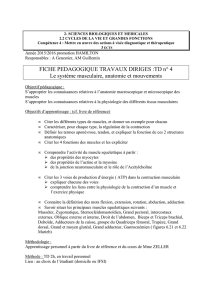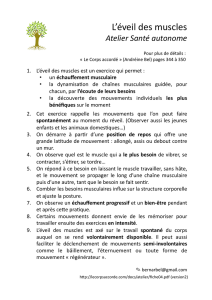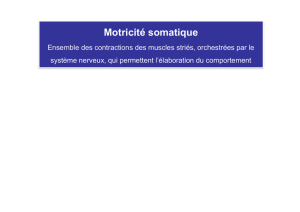comment faire marcher les patients sans danger après

COMMENT FAIRE MARCHER LES
PATIENTS SANS DANGER APRÈS
UN BLOC DU MEMBRE INFÉRIEUR ?
Denis Jochum
Service d’anesthésie, hôpital Albert Schweitzer, 201 avenue d’Alsace BP
20129, 68003 Colmar cedex, France. E-mail : joc[email protected]
INTRODUCTION
La marche est définie comme le déplacement de l’ensemble du corps par
une action alternée des membres inférieurs. C’est un mode de locomotion
naturel constitué par une suite de pas. Elle est caractérisée par une succession
de doubles appuis et d’appuis unipodaux, avec un contact permanent avec le
sol par au moins un appui unilatéral.
Une intervention chirurgicale au niveau du membre inférieur peut menacer
ou compromettre la sûreté de la marche du patient. L’anesthésie ou l’analgésie
par la réalisation d’un ou de plusieurs blocs du membre inférieur peut également
majorer ce risque.
1. PHYSIOLOGIE DE LA MARCHE
Le cycle de la marche est composé d’une phase d’appui et d’une phase
oscillante. La phase d’appui qui représente 60 % du cycle de la marche débute
par le contact du talon avec le sol et se termine par le décollement des orteils.
La phase oscillante d’une durée de 40 % du cycle correspond à la phase où le
pied n’est plus en contact avec le sol. Le cycle complet de la marche (Figure 1)
comprend deux phases de double appui (20 % du cycle), une phase d’appui
unipodal (40 % du cycle) et une phase oscillante (40 % du cycle). Ce cycle
comprend huit événements, cinq durant la phase d’appui (contact initial, réponse
à la charge, début d’appui, milieu d’appui, pré-phase oscillante) et trois durant la
phase oscillante (début, milieu et fin de phase oscillante).
Pendant la phase d’appui, le poids du corps repose sur un seul pied ce qui
implique une activité musculaire importante. Lors de l’oscillation, les articulations
de la hanche et du genou sont fléchies et les muscles sont presque inactifs, seuls
les muscles de la loge antérieure de la jambe travaillent en relevant l’avant-pied.

MAPAR 2014
54
Figure 1 : les différentes phases du cycle de marche [1].
Pour une marche normale, il faut une attaque par le talon avec le genou en
extension quasi complète, puis un appui plantigrade et un genou stable, ensuite
pendant la phase oscillante une flexion des articulations du membre inférieur
pour un passage libre du pied. La progression vers l’avant se fait avec une
longueur appropriée du pas qui implique d’une part une extension correcte de
la hanche et du genou et d’autre part un appui controlatéral stable. La présence
d’une douleur, d’une atteinte de l’amplitude articulaire, d’une diminution de
la force ou du tonus musculaire, d’une atteinte de la sensibilité au niveau du
membre inférieur va occasionner un trouble de la marche. Toute atteinte motrice
a une répercussion sur la marche. Cinq groupes musculaires sont impliqués
principalement dans la marche. Il s’agit des muscles glutéaux avec en particulier
le muscle moyen glutéal, du muscle quadriceps fémoral, des muscles ischio-
jambiers, du muscle tibial antérieur et du muscle triceps sural.
Lors du contact du talon avec le sol, les principaux muscles en action sont
les muscles glutéaux, le muscle quadriceps fémoral, les muscles ischio-jambiers
et le muscle tibial antérieur (Figure 2.1). La mise en charge lors de la réponse
à l’appui nécessite l’action des muscles moyen glutéal, quadriceps fémoral et
triceps sural (Figure 2.2). Lors de la phase d’appui avec le pied à plat, le muscle
triceps sural est sollicité (Figure 2.3).
L’action du muscle grand glutéal est l’extension de la cuisse. Le muscle
moyen glutéal maintient le bassin en station debout. Le muscle quadriceps
fémoral assure l’extension de la jambe et l’un de ses quatre muscles, le muscle
droit de la cuisse aide le muscle iliopsoas dans la flexion de la cuisse. Il est
important de préciser que le muscle quadriceps fémoral est peu utilisé durant
la marche et se retrouve sans activité pendant une grande partie de la phase
d’appui, au-delà de 20 % du cycle de la marche. Lors de la marche en terrain plat,
le muscle quadriceps fémoral est utilisé épisodiquement. Par contre, ce muscle
est nécessaire pour se lever et s’asseoir, pour monter et descendre les escaliers.

Anesthésie locorégionale - douleur 55
Figure 2 : Action des muscles (en gris foncé) lors du contact talon/sol (1), à la
mise en charge (2) et à la phase d’appui (3).
Tableau I
Activité musculaire des membres inférieurs lors du cycle de la marche (les
symboles , ✚, correspondent respectivement aux muscles agissant sur
la hanche, sur le genou et sur la cheville, les rectangles noirs correspondent à
l’activité musculaire principale).
Groupes musculaires
Phase d’appui
Phase oscillante
Attaque
du talon
Pied à
plat
Décollement
talon Début Milieu Fin
Grand glutéal
Moyen glutéal
Petit glutéal
Tenseur du fascia
lata
Iliopsoas
Quadriceps fémoral
✚
✚
✚
Sartorius
✚
✚
Gracile
✚
Grand adducteur
Long adducteur
Ischio-jambiers
✚
✚
Tibial antérieur
Long extenseur des
orteils
Long extenseur de
l’hallux
Long et court
fibulaires
Triceps sural
✚
✚
Long fléchisseur
des orteils
Long fléchisseur de
l’hallux
Tibial postérieur

MAPAR 2014
56
Les muscles ischio-jambiers constitués du semi-tendineux, semi-membra-
neux et biceps fémoral sont des fléchisseurs de la jambe, et au démarrage de la
marche des extenseurs de la cuisse. Le muscle tibial antérieur permet la flexion
dorsale du pied pour le contact du talon avec le sol ce qui permet d’amortir le choc.
Le muscle triceps sural assure la stabilité du genou puis la flexion plantaire. Une
fois le pied en appui au sol, le muscle triceps sural agit comme un stabilisateur
du genou en extension, de 20 % à 40 % du cycle de la marche. C’est la tension
de ce muscle qui est essentielle pour assurer la stabilité du genou.
2. POSTURE, ÉQUILIBRE ET LOCOMOTION
Avant de marcher, il faut se tenir debout. La posture est le maintien actif
du corps dans l’espace, en relation avec les stimulations du monde extérieur.
Le tonus postural correspond à la tension des muscles antigravitaires avec
une action combinée des agonistes et antagonistes. L’équilibre doit se faire
lors de la station debout mais également lors du mouvement. Les récepteurs
labyrinthiques, visuels et somato-proprioceptifs transmettent les informations
à l’organisme pour le maintien de l’équilibre. En cas de déficit de l’un de ces
moyens, le système nerveux peut s’adapter du fait de la multitude d’information.
Par les afférences cutanées et proprioceptives de la voûte plantaire, le rôle des
forces d’appui au sol est essentiel pour le maintien de l’équilibre. L’initiation de
la marche correspond à une véritable chute, due à une inhibition de la posture.
L’intégrité du système nerveux périphérique et des muscles qu’il innerve permet
d’obtenir une marche équilibrée. Il existe deux modes d’action dans la locomotion,
un mode automatique et un mode volontaire. Ce dernier entre en jeu lorsque la
marche nécessite une plus grande précision.
3. BLOCS DU MEMBRE INFÉRIEUR ET RÉPERCUSSIONS SUR LA
MARCHE
3.1. BLOC DU PLEXUS LOMBAL
3.1.1. Bloc du nerf fémoral
L’absence de contraction quadricipitale consécutive au bloc du nerf fémoral
ne permet pas l’extension de la jambe au début de la phase d’appui et entraîne
une instabilité du genou. Après la phase de mise en charge du membre, au-delà
de 20 % du cycle de la marche, le bloc moteur n’interfère plus car ce muscle
est inactif. Une autre conséquence de cette atteinte motrice est l’impossibilité
de se lever, de s’asseoir et d’utiliser les escaliers.
3.1.2. Bloc au canal des adducteurs
Ce bloc est réalisé au tiers moyen de la cuisse pour l’analgésie de la chirurgie
du genou et dans le but de limiter le bloc quadricipital. Cependant, une diffusion
proximale de l’anesthésique local peut entraîner au minimum un bloc du muscle
vaste médial voire une véritable parésie quadricipitale et dans ce cas, un risque
semblable au bloc du nerf fémoral.
3.1.3. Bloc du nerf oBturateur
L’atteinte motrice des muscles adducteurs est d’importance moindre pour la
marche. Ces muscles agissent lors de la phase oscillante du cycle de la marche
ce qui correspond à la phase où les muscles sont peu actifs.

Anesthésie locorégionale - douleur 57
3.1.4. Bloc du plexus lomBal par voie postérieure
Ce bloc intéresse sur le plan moteur les nerfs fémoral, obturateur et
éventuellement le tronc lombosacral. Le risque lié au bloc du nerf fémoral est
essentiellement en rapport avec l’atteinte du muscle quadriceps fémoral qui
intervient lors du contact talon/sol et lors de la mise en charge du membre en
appui monopodal. Le bloc moteur des muscles adducteurs innervés par le nerf
obturateur a peu de conséquences. L’atteinte du tronc lombosacral (L4, L5)
peut se traduire par un bloc moteur du muscle moyen glutéal et également du
muscle tibial antérieur. Les répercussions lors de la marche sont doubles. Pour
l’atteinte du muscle moyen glutéal, c’est une perte du maintien du bassin lors
de la phase d’appui. Pour l’atteinte du muscle tibial antérieur, c’est une perte de
la flexion dorsale du pied avec l’impossibilité d’une attaque du talon avec le sol
au début de la phase d’appui et également une incapacité de passage libre du
pied lors de la phase oscillante.
3.2. BLOC DU PLEXUS SACRAL
3.2.1. Bloc proximal du nerf sciatique
L’ensemble de la phase d’appui de 0 à 40 % est hautement perturbé. Le bloc
du muscle moyen glutéal en cas d’atteinte du nerf glutéal supérieur provoque
une instabilité du bassin au début de la phase d’appui. L’absence de flexion
dorsale du pied (muscle tibial antérieur) empêche le contact du talon au sol.
Au démarrage de la marche, l’extension de la cuisse n’est pas mise en jeu en
raison de l’inaction des muscles grand glutéal et ischio-jambiers. Puis à la phase
d’appui pied à plat, l’absence de contraction du muscle triceps sural supprime
l’action stabilisatrice essentielle pour le genou. A la phase oscillante, le bloc des
releveurs du pied conduit au steppage.
3.2.2. Bloc du nerf sciatique au niveau poplité
Pour le nerf fibulaire commun, c’est le bloc des muscles releveurs du pied
avec les conséquences déjà décrites ci-dessus qui sont l’absence d’attaque du
talon et la présence d’un pied tombant. Pour le nerf tibial, c’est l’instabilité du
genou quand le pied est à plat en raison de l’inaction du muscle triceps sural.
3.2.3. Bloc à la cheville du nerf sciatique
C’est essentiellement l’absence de sensation cutanée et de sensibilité
profonde ou proprioceptive au niveau de la voûte plantaire qui peut aboutir à un
déséquilibre de la marche. Le réflexe médioplantaire est aboli et par conséquent
la pression de la plante du pied n’entraîne pas de contraction musculaire du
triceps sural.
4. RISQUE DE CHUTE
Le risque d’un ou plusieurs blocs du membre inférieur est la chute du patient
lors de l’appui sur le membre insensibilisé. L’instabilité du membre inférieur
peut être également due à la douleur qui agit en inhibant l’action des muscles
stabilisateurs du genou (réflexe nociceptif en flexion). En chirurgie orthopédique,
sans aucune précision des techniques anesthésiques, le taux de chute était
de 0,9 % soit 2 chutes pour 1000 jours d’hospitalisation (868 chutes sur une
période de 10 ans) [2]. Pour les patients opérés d’une prothèse articulaire de
hanche ou de genou, cela représentait 0,85 % soit 2,1 chutes pour 1000 jours
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%