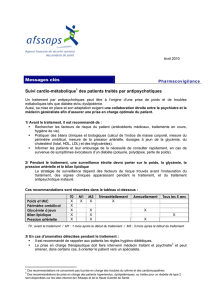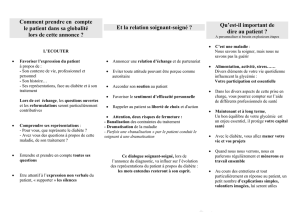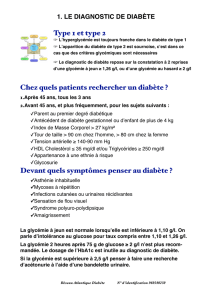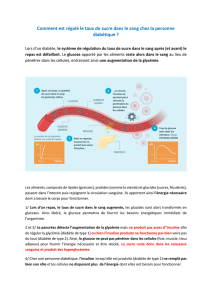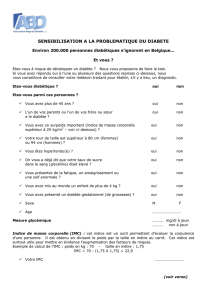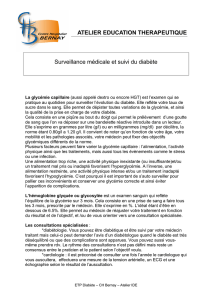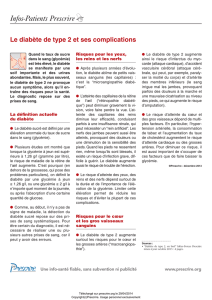Critères diagnostiques du diabète

FORMATION
LE CONCOURS MEDICAL
Henri GIN, Vincent RIGALLEAU,
Vincent VERGNOT
Serv. nutr. diabétol., hôp. Haut-Lévêque, Pessac
Les critères diagnostiques du diabète que nous
avons utilisés jusqu’en 1998 étaient fondés sur les
propositions faites en 1980 par l’OMS, à partir
d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée à 75 g de glu-
cose: soit la glycémie à jeun (G0) était supérieure ou
égale à 1,40 g/l et/ou la glycémie deux heures après
charge (G2) supérieure à 2 g/l, et le diagnostic de diabète
était porté; soit la glycémie à deux heures se trouvait
entre 1,40 et 2 g/l et l’on proposait alors le diagnostic d’in-
tolérance au glucose. Mais l’expérience des uns et des
autres nous apprend que 30 % des patients classés
comme intolérants au glucose sont susceptibles de deve-
nir diabétiques et qu’un certain nombre de patients into-
lérants au glucose et non classés diabétiques auront
pourtant les complications dégénératives micro-angio-
pathiques du diabète.
Par ailleurs, si 100 % des patients qui ont une glycémie
à jeun supérieure à 1,40 g/l ont aussi une glycémie à
deux heures pathologique, 25 % des patients qui ont une
glycémie à deux heures pathologique ont une glycémie
à jeun inférieure à 1,40 g/l; en quelque sorte, les deux
critères, glycémie à jeun et glycémie post-charge, ne sont
pas concordants. Cela peut s’exprimer d’une façon dif-
férente, consistant à dire que l’hyperglycémie chronique
est beaucoup
plus importante
dès que le cri-
tère 1,40 g/l à
jeun est atteint ;
or il apparaît que la pratique de la glycémie à jeun est
plus fréquente que la glycémie post-charge, il fallait donc
Nouveaux critères
diagnostiques
du diabète
Pourquoi? Pour quoi faire?
POURQUOI AVOIR ABAISSÉ LE CHIFFRE DE
GLYCÉMIE CORRESPONDANT À LA DÉFINITION
DU DIABÈTE ? POUR DIMINUER LE RISQUE DE
COMPLICATIONS MICROVASCULAIRES.
238
Tome 123-04 03-02-2001
Le risque de rétinopathie
à dix ans existe dès que
la glycémie à jeun
atteint 1,26 g/l.
KOKEL/BSIP

LE CONCOURS➔FORMATION
donner un poids et une valeur prédictive plus importante
et moins tardive à la glycémie à jeun.
BASE DES NOUVEAUX CRITÈRES
Trois études ont été conduites chez les Indiens Pimas,
dans une population égyptienne, et dans la population
américaine. Ces trois études, menées séparément, ont pu
montrer, chacune de leur côté, que le risque de voir appa-
raître une rétinopathie de type micro-angiopathique exis-
tait dès que la glycémie deux heures après charge était
supérieure à 2 g/l mais aussi dès que la glycémie à jeun
était supérieure à 1,26 g/l. Ces trois études, parfaitement
concordantes, ont donc amené un comité d’experts à pro-
poser comme nouveau critère le seuil glycémique de
1,26 g/l à jeun pour le diagnostic de diabète. Il est à noter
que l’Étude prospective des policiers parisiens a, de son
côté, montré que le risque de mortalité coronaire com-
mence à apparaître pour un seuil de glycémie à 1,25 g/l.
Il apparaît donc qu’une glycémie à jeun à 1,26 g/l est cer-
tainement un marqueur de risque de complications.
Un comité d’experts réuni par l’American Diabetes Asso-
ciation (ADA) a proposé de retenir comme seul élément
diagnostique la glycémie à jeun pour pouvoir porter le
diagnostic de diabète; il recommande l’abandon de
l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, sauf
dans quelques situations particulières, et particulière-
ment le diabète gestationnel; il fait par ailleurs remar-
quer que de toute façon l’épreuve d’hyperglycémie pro-
voquée par voie orale est peu prescrite, parce que
coûteuse en temps (immobilisant le patient pendant trois
heures), alors que la glycémie à jeun se fait de manière
extemporanée. Dès 1997, ces experts ont proposé de nou-
veaux critères diagnostiques, repris dans l’encadré 1; ces
critères permettent le diagnostic de diabète dès que la gly-
cémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g/l (7 mmol/l),
et cela, bien sûr, mesuré à deux reprises. Le diagnostic
peut aussi être fait lorsqu’une glycémie deux heures
après charge est supérieure à 2 g/l, mais ce critère n’est
pas un critère obligatoire, la glycémie à jeun étant le seul
critère obligatoire. Les experts font remarquer que le dia-
gnostic de diabète peut aussi être établi lorsqu’une gly-
cémie mesurée à n’importe quel moment de la journée,
associée à des signes cliniques, est supérieure à 2 g/l.
Entre le seuil de 1,10 g/l et celui de 1,26 g/l, les experts
proposent un nouveau groupe appelé IFG (impaired fas-
ting glucose). Le devenir de cette nouvelle classe com-
prise entre la normalité stricte (G0 < 1,10 g/l) et la mala-
die diabétique (G0 > 1,26 g/l) est encore hypothétique.
Pour les experts, la signification de ce nouveau seuil de
glycémie à jeun est corrélée d’une part au risque de dia-
bète, d’autre part au risque de micro-angiopathie, et cela
de façon certaine.
À partir de la publication de ces nouveaux critères, une
controverse s’est installée; un certain nombre d’auteurs
ont repris d’anciennes séries pour discuter l’abandon ou
non de l’épreuve d’hyperglycémie provoquée. Une des
études faisant actuellement référence est l’étude
DECODE (1).
Il s’agit d’une analyse globale par cumul de seize études
totalisant 25219 patients; l’ensemble de ces patients a pu,
de manière rétrospective, être analysé soit en fonction des
anciens critères, soit en fonction des nouveaux critères.
La concordance des anciens résultats et des nouveaux
critères est importante, puisque 95,7 % des patients sont
facilement classés, en sujets normaux pour 23702 d’entre
eux et en diabétiques pour 431; cependant, il existe 4,3 %
de diagnostics discordants; c’est ainsi que 613 patients
sont classés comme diabétiques par la glycémie à jeun,
mais ne le seraient pas par l’épreuve d’hyperglycémie
provoquée, et 473 patients seraient classés diabétiques
par l’épreuve d’hyperglycémie provoquée et ne le sont
pas par une glycémie à jeun à 1,26 g/l. Bien sûr, cela
montre qu’aucun critère n’est parfait, mais qu’il y a peut-
être moins de laissés-pour-compte avec les nouveaux cri-
tères qu’avec les anciens. De nombreuses autres publi-
cations sont venues alimenter le flot de la controverse,
mais aujourd’hui les nouveaux critères sont dans l’en-
semble reconnus par l’ensemble des autorités sanitaires
des différents pays.
Pour compléter le débat, une étude récemment publiée a
pu montrer, sur 8737 sujets âgés de 40 à 74 ans, et suivis
pendant neuf ans, qu’un critère diagnostique fondé sur
une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l per-
met, en général, de porter le diagnostic de diabète sept ans
plus tôt qu’il ne le serait avec une épreuve d’hyperglycé-
mie provoquée (3).
Cependant, les dernières études de suivi des patients
ayant une glycémie à jeun normale (< 1,10 g/l) et une gly-
cémie post-charge supérieure à 2 g/l semblent montrer
que ces patients sont peut-être à l’abri des complications
micro-angiopathiques, mais, en revanche, ils sont
exposés au risque de macro-angiopathie. Cependant, ce
Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète
239
Tome 123-04 03-02-2001
1/Nouveaux critères du diabète
Diabète
• Glycémie à jeun (G0) ≥1,26 g/l (7 mmol/l)
et/ou
• Glycémie à n’importe quel moment de la journée
≥2 g/l avec signes cliniques de diabète
Trouble régulation glycémique (IFG)
(Impaired fasting glycemia)
G0 ≥1,10 g/l et < 1,26 g/l

LE CONCOURS➔FORMATION
groupe de patients (glycémie à jeun normale, glycémie
post-charge supérieure à 2 g/l) ne concerne certainement
qu’un tout petit nombre d’entre eux, qui ne doit pas être
confondu avec le grand nombre de patients dont les gly-
cémies à jeun sont supérieures à 1,26 g/l.
Au total, la valeur de 1,26 g/l est justifiée par différentes
enquêtes de population.
• Une glycémie à jeun au-delà de 1,26 g/l donne la même
prévalence de diabète qu’une glycémie deux heures après
charge à 2 g/l.
• À partir d’un seuil glycémique de 1,26 g/l, il existe une
augmentation nette de la prévalence de la rétinopathie.
• Une glycémie à jeun à 1,26 g/l a la même sensibilité et
la même spécificité qu’une glycémie deux heures après
charge égale à 2 g/l pour définir le risque de rétinopathie.
• Une glycémie à jeun égale à 1,25 g/l permet de définir
un même risque de mortalité coronaire qu’une glycémie
deux heures après charge égale à 2 g/l.
L’ensemble de ces données sont celles qui ont certaine-
ment présidé à la décision des experts.
NOUVELLE CLASSIFICATION
Définir un seuil glycémique à 1,26 g/l consiste à définir
un symptôme biologique et non pas un diagnostic cli-
nique. Il importe en effet d’aller au-delà, et, grâce à une
démarche clinique, de porter un « diagnostic vrai » afin
de donner un pronostic et d’arriver éventuellement à une
prescription. Cela veut dire que, derrière les nouveaux
critères, il existe aussi une nouvelle classification.
L’ancienne classification des différents types de diabètes
du NDDG (National Diabetes Data Group, 1979) propo-
sait une classification qui mélangeait les considérations
thérapeutiques et les considérations pathogéniques; les
diabètes étaient classés en diabète insulino-dépendant
(DID), diabète non insulino-dépendant (DNID), diabète
gestationnel, diabète par malnutrition et autres variétés.
De toute évidence, une confusion entre la physiopatho-
logie et le choix thérapeutique était faite; on sait aujour-
d’hui qu’un certain nombre de patients diabétiques dits
non insulino-dépendants finissent par recevoir un jour
de l’insuline, et que d’autres diabétiques dits insulino-
dépendants peuvent au début de leur diabète être traités
sans insuline. C’est pourquoi les nouveaux critères sont
associés à une nouvelle classification. Cette nouvelle clas-
sification se propose d’abandonner la classification phé-
notypique DID/DNID, et propose une classification phy-
sio-pathologique. Elle part du principe qu’un diabète dont
on comprend mieux les mécanismes est un diabète que
l’on traitera probablement mieux, et surtout pour lequel
la thérapeutique sera mieux définie et la surveillance
mieux adaptée. La nouvelle classification (encadré 2) pro-
pose d’opposer le diabète de type 1 au diabète de type 2.
La physiopathologie du diabète de type 1 est une des-
truction des cellules bêta, soit par un processus immuno-
logique, soit par un processus idiopathique. La cause
essentielle du diabète de type 2 est une insulino-résistance
associée à une carence insulinique relative. À ces deux
types de diabète s’ajoutent toute une série d’autres dia-
bètes, les uns par déficit génétique de la cellule bêta (dia-
bètes de type MODY ou diabètes mitochondriaux), les
autres par déficit génétique de l’action de l’insuline par
carence du pancréas endocrine et exocrine, comme on
peut le rencontrer dans les pancréatites chroniques, les
hémochromatoses, les néoplasies et autres pathologies
liées aux endocrinopathies, aux médicaments, allant de
la pentamidine aux thiazidiques, et enfin toute une série
d’autres pathologies. Cette classification impose donc,
devant un patient chez lequel le « symptôme diabète » a
été retenu en raison d’une glycémie à 1,26 g/l, de se
demander s’il est de type 1, de type 2 ou d’un autre type.
D’une manière générale, le diabète de type 1 survient plu-
tôt chez un sujet jeune, sans surcharge pondérale, et chez
qui une légère diminution des masses musculaires est le
témoin d’un début de diminution de la fonction pancréa-
tique. Un certain nombre de patients diabétiques de type 1
auront besoin d’insuline tout de suite, d’autres un peu plus
tard; on les qualifiera alors de diabètes de type 1 à marche
lente. Il importe cependant de porter ce diagnostic dès le
début, même si on propose au patient de le traiter initia-
lement avec des comprimés. L’insulinothérapie est une
échéance obligatoire, que le médecin doit savoir identi-
fier tout de suite et dont le patient doit être prévenu afin
d’éviter des désillusions ultérieures, d’assurer une
meilleure adhésion à la thérapeutique et d’éviter un épui-
sement progressif des masses musculaires par un traite-
ment mal orienté.
Le diabète de type 2 survient chez des patients ayant plu-
tôt atteint la maturité, la plupart du temps avec une sur-
charge pondérale à caractère androïde, des antécédents
familiaux de diabète de type 2 et chez les femmes des
antécédents d’enfants macrosomes, le tout associé
Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète
240
Tome 123-04 03-02-2001
2/Nouvelle classification
Type 1: destruction des cellules bêta
Type 2: insulino-résistance avec déficit relatif
en insuline
Autres types: déficit génétique de la cellule bêta
(MODY, diabète mitochondrial)
— Autres anomalies génétiques, (diabètes
lipoatrophiques, lepréchaunisme)
— Diabète par maladie du pancréas exocrine
— Diabète par endocrinopathies
— Diabète induit par les médicaments
— Diabète gestationnel

LE CONCOURS➔FORMATION
généralement à de bonnes masses musculaires.
Parmi les diabètes secondaires, il importe de ne pas
oublier ceux qui sont liés aux pancréatites chroniques, à
l’hémochromatose, aux pathologies endocriniennes (syn-
drome de Cushing, acromégalie…) ou associés à des
pathologies intercurrentes telles que les états infectieux
ou les pathologies néoplasiques. La pancréatite chronique
est évoquée en interrogeant le patient sur le nombre de
ses selles et non pas sur le fait qu’il existe ou pas une diar-
rhée; l’hémochromatose est suspectée devant une pig-
mentation ou un coefficient de saturation de la sidéro-
philine supérieur à 60 %; les pathologies endocriniennes,
tels le syndrome de Cushing ou l’acromégalie, doivent
être présentes à l’esprit, mais sont généralement évi-
dentes. Plus difficiles sont les troubles de la glycorégula-
tion en rapport avec une pathologie intercurrente. Il ne
faut pas interpréter une élévation de la glycémie dans un
contexte fébrile, il faut savoir rechercher une pathologie
néoplasique (hépatique, pancréatique ou autre) lorsque
le tableau clinique est surprenant par sa rapidité d’évo-
lution à un âge où le diabète de type 1 s’installe plutôt avec
une certaine lenteur.
NOUVEAUX CRITÈRES, NOUVELLE CLASSIFI-
CATION: POUR QUOI FAIRE?
Comme toute démarche médicale, la démarche diabéto-
logique cherche à définir les critères décisionnels per-
mettant d’orienter la thérapeutique.
En cas de diabète de type 1, on sait que l’insuline est une
échéance obligatoire, soit immédiate s’il existe des signes
cliniques francs, soit plus tardive si le diagnostic de
type 1 à marche lente a été porté. Les critères de mise en
route de l’insuline sont alors définis par une élévation des
glycémies et/ou une perte de poids, et/ou une perte des
masses musculaires, et/ou une asthénie. Un seul de ces
critères est suffisant pour pousser le patient à accepter
l’insulinothérapie; en effet, en cas de diabète de type 1, il
faut savoir ne pas tirer sur « la corde de l’organisme » et
ne pas attendre une fonte des masses musculaires ou un
amaigrissement important pour penser que l’heure de
l’insuline est arrivée ou pour la faire accepter au patient.
Dans le cadre d’un diagnostic de type 2, les outils théra-
peutiques consistent essentiellement à lutter contre les
facteurs d’insulino-résistance, source d’aggravation de la
glycémie. Il faut donc lutter contre l’obésité, la sédenta-
rité, le déséquilibre alimentaire. En effet, en cas d’ali-
mentation trop riche en lipides et en protéines, une
entrave à l’action de l’insuline existe, il faut donc absolu-
ment avoir un régime équilibré avec un respect de la
ration glucidique utile. Chez le patient diabétique de
type 2 avec surcharge androïde, l’amaigrissement
devient un objectif obligatoire.
Enfin, le contexte glycémique ne doit jamais être négligé;
une glycémie atteignant le seuil de 1,26 g alors qu’il existe
un syndrome fébrile ou une anorexie d’apparition récente
ou une prescription médicamenteuse associée doit faire
évoquer le diagnostic de diabète de type secondaire et
conduire au traitement des pathologies sous-jacentes à la
fièvre, à la perte d’appétit, plutôt que se lancer dans le trai-
tement d’un diabète pour lequel on n’aurait pas établi de
diagnostic étiologique.
L’orientation thérapeutique va donc être fonction du type
de diabète; l’interrogatoire et l’examen clinique doivent
permettre d’appréhender ce diagnostic: l’interrogatoire
apprécie l’état pondéral (le patient n’a jamais eu de sur-
charge, a une surcharge, ou a eu une surcharge), l’exa-
men clinique précise l’état du tissu adipeux (ventre et
fesses), et surtout l’état des masses musculaires (les
masses crurales sont les plus sensibles). Par ailleurs,
l’examen clinique recherche l’éventualité d’un foyer
infectieux (température, examen des dents, examen pul-
monaire), n’oublie pas de s’enquérir de l’état général
(asthénie, anorexie) mais aussi du nombre de selles, véri-
fie la pigmentation des mains et n’omet pas la palpation
du foie…
Au total, les nouveaux critères du diabète ont donc pour
but de simplifier la pratique médicale, limitant les exa-
mens à visée diagnostique à la seule glycémie à jeun, mais
bien sûr avec un outil plus sensible et plus spécifique, en
ramenant le niveau seuil au chiffre de 1,26 g/l. Derrière
ce symptôme biologique, une démarche clinique est obli-
gatoire pour arriver à déterminer le type de diabète avant
toute décision thérapeutique. La diabétologie reste donc
une démarche médicale classique allant du symptôme au
diagnostic et du diagnostic à la thérapeutique. Dans le cas
présent, le symptôme est un symptôme biologique, le dia-
gnostic est un diagnostic étiopathogénique, et la théra-
peutique restera diverse et multiple.■ 401870
AUTEURS
H. Gin, Pr univ.-prat. hosp. (PU-PH), V. Rigalleau, prat. hosp. univ.
(PHU), V. Vergnot, chef clin.-ass.
Serv. nutrition-diabétol., hôp. Haut-Lévêque, 33604 Pessac
RÉFÉRENCES
1. DECODE Study Group on behalf of the European Diabetes Epide-
miology Study Group. Will new diagnostic criteria for diabetes mellitus
change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European
epidemiological data. BMJ 1998; 317: 371-375.
2. The Expert Commitee on the Diagnosis and Classification of Dia-
betes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and
Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20: 7.
3. Harris MI, Eastman RC, Cowie CC, Flegal KM, Eberhardt MS. Compa-
rison of diabetes diagnostic categories in the U.S. population according to
the 1997 American Diabetes Association and 1980-1985 World Health
Organization diagnostic criteria. Diabetes Care 1997; 20: 1859-1862.
4. National Diabetes Data Group: Classification and diagnosis of dia-
betes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes
1979; 28: 1039-1057.
5. World Health Organization: diabetes mellitus: report of a WHO
study group. Genève, 1985 (Tech Rep Ser, no 727).
Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète
241
Tome 123-04 03-02-2001
1
/
4
100%