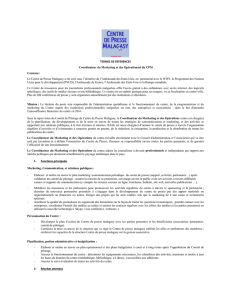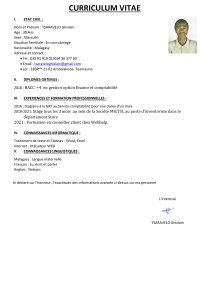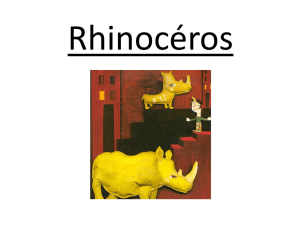Le Famadihana Betsimisaraka : Analyse Philosophique d'Eugène Régis Mangalaza
Telechargé par
twokibou

LE FAMADIHANA BETSIMISARAKA
Travail écrit
Pour le cours de Philosophie Malagasy
Fianarantsoa, a.a 2024/2025

1
INTRODUCTION
La pensée africaine et malagasy traditionnelle doit encore être reformulée en langage
philosophique scientifique, et ce qui est sûr et certain c’est que cette pensée a des choses à dire,
à révéler à la culture universelle. La question qui se pose souvent c’est est-ce qu’il y a une
philosophie malagasy ? La plupart des chercheurs a répondu que c’est de l’ethnophilosophie.
Le Famadihana ou exhumation est parmi les concepts centraux de la philosophie malagasy.
Son origine peut être retracée à deux grandes influences culturelles, les premiers habitants de
Madagascar, les peuples austronésiens (Bornéo, Sumatra, Philippines) possèdent une
cérémonie similaire au Famadihana. Egalement, Madagascar est influencé par les cultures
bantous, qui ont des traditions basées sur le culte des ancêtres. Il faut tenir compte aussi que
chez plusieurs sociétés africaines, les morts restent des membres actifs de la communauté.
Ainsi, à Madagascar le Famadihana varie d’une ethnie à l’autre. Notre travail se porte alors sur
le Famadihana Betsimisaraka
1
chez Eugène Régis MANGALAZA. Ce thème nous amène à
poser la question : comment les Betsimisaraka conçoivent-ils le Famadihana ? Pour pouvoir
apporter une réponse à cette question, il est pertinent d’établir un plan. Notre travail comporte
trois parties. Dans la première partie nous présenterons notre auteur. Puis dans la deuxième
partie, nous expliquons le Famadihana Betsimisaraka d’après notre auteur. Et enfin, nous
apportons l’apport critique.
1. Présentation de l’auteur
1.1 Biographie
Eugène Régis MANGALAZA est né le 13 juillet 1950 à Ambodivoanio, Vatomandry,
dans la partie nord de Madagascar. Il est un philosophe, anthropologue et homme d’Etat
malagasy. Il a un bon parcours académique et professionnel. Eugène Régis poursuit ses études
en philosophie après avoir terminé ses études secondaires. Quand il a eu son diplôme de
doctorat en philosophie, il devient professeur à l’université de Toamasina en 1980, et il a donné
le cours de philosophie et d’anthropologie.
Mangalaza s’engage aussi dans le domaine politique et pendant le crise politique très
chaud à Madagascar en 2009 il est nommé premier ministre par le président de la Haute Autorité
de la transition Andry Rajoelina. Son mandat n’était qu’entre le 10 octobre jusqu’au 20
1
Betsimisaraka signifie nombreux inséparable, Be : nombreux ; tsy misaraka : qui ne sépare point. Les
Betsimisaraka vivent sur la frange orientale de l’île, sur une étendu longue de 800 km, allant du fleuve Bemarivo
jusqu’au nord du fleuve Mananjary. Les Betsimisaraka comprenaient quatre groupes : les Antavaratra (ceux du
Nord), les Tsitambala (des gens qu’aucune palissade ne peut arrêter), les Varimo (les gens de sous bambous) et les
Antatsimo (ceux du sud).

2
décembre, mais ce mandat est marqué par la préparation des peuples malagasy à des élections
démocratiques, et les efforts pour remettre en ordre les problèmes politiques.
1.2 Œuvres
Voici quelques ouvrages et publications d’Eugène Régis : l’ouvrage intitulé Concevoir
et réaliser son mémoire de Master I et Mastère II en sciences humaines et sociales, publié en
2011 offre aux étudiants supérieurs des conseils pour les aider à la rédaction. Le concept de
Fihavanana dans la société malgache est un ouvrage qui approfondit le concept de Fihavanana
malagasy. Tradition et modernité à Madagascar est un ouvrage qui examine les interactions
entre les traditions culturelles malagasy et les influences de la modernité. Il a publié a publié
aussi l’Essai de philosophie Betsimisaraka qui analyse le Famadihana en particulier chez
l’ethnie Betsimisaraka. Il est bon de noter que ces travaux donnent une unique vision sur la
manière dont les sociétés africaines peuvent intégrer les valeurs traditionnelles dans le contexte
contemporain.
2. La conception du Famadihana Betsimisaraka chez Eugène Régis
Dans cette deuxième partie de notre travail, nous abordons la conception du
Famadihana Betsimisaraka selon notre auteur. Pour les Betsimisaraka, le Famadihana reflète
une conception du temps. Les occidentaux considèrent la mort comme une rupture définitive,
mais les Betsimisaraka ont sa propre philosophie et leur sagesse sur la conception de la mort.
Pour eux, les morts continuent d’exister mais sous une autre forme comme des esprits ou
Fanahy, et qui sont toujours en relation avec les vivants. En effet, le Famadihana favorise les
liens entre les générations. Alors cela revient à une philosophie que la mort et la vie n’est pas
en opposition mais deux étapes du même processus, c’est pourquoi Eugène Régis affirme que :
« La mort n’est que l’envers de la vie au même titre que la nuit est l’envers du jour »
(Mangalaza, 1980, p. 1).
De plus, notre auteur parle du concept Ngatra qui est une force vitale circulant entre les
générations ou les membres d’une lignée. A travers le Famadihana, cette énergie sera
revitalisée et distribuée au sein de la famille et de la communauté. Il est mieux de souligner que
le concept Ngatra a des nuances avec les idées philosophiques africaines sur l’ontologie
relationnelle, qui signifie que l’individu n’existe qu’en lien avec les autres. Les ancêtres sont
des intermédiaires spirituels qui assurent le bon équilibre de la société.
D’ailleurs, le Famadihana évoque aussi un des concepts centraux de la philosophie
malagasy le Fihavanana, qui désigne les liens de parenté, d’amitié et de solidarité. Ainsi, le
Famadihana est un moment de rassemblement, de renforcement des liens sociaux et familiaux,

3
de partage et convivialité, de transmission culturelle. Le Famadihana permet aussi de souder la
communauté et de réaffirmer la primauté du collectif sur l’individu, un principe fondamental
dans la pensée Betsimisaraka. Et ici, notre auteur affirme que : « La véritable solidarité, celle
basée sur le Fihavanana, conduit nécessairement à l’ouverture vers l’autre, à la rencontre »
(Mangalaza, 1980, p. 19).
Enfin, le Famadihana confirme l’identité et l’appartenance à un lignage, à une famille
et à une culture bien déterminé, plus précisément le Famadihana possède alors une dimension
existentielle et identitaire. Pour Eugène Régis, à part sa conception du Famadihana comme une
tradition ancestrale, ce concept permet aux Betsimisaraka de rester à leur culture devant les
influences extérieures et les transformations sociales.
3. Apport critique
3.1 Mérite
Notre auteur Eugène Régis a le mérite sur la volonté de remettre les traditions malagasy
dans un perspective philosophique universelle. En explorant la profondeur existentielle du
Famadihana, il a montré qu’il ne s’agit pas d’un simple rituel superstitieux, mais c’est un
système de pensée cohérent qui mérite d’être étudié vraiment avec sérieux. Cette perspective
fait écho aux idées de Siméon Rajaona, qui dénonce l’habitude des occidentaux de déformer la
conception malagasy du monde en y insérant des concepts occidentaux, négligeant ainsi les
traits authentiques de la pensée malagasy.
Puis, Eugène Régis aussi est félicité d’avoir mis le Famadihana comme un acte de
résistance culturelle parce que quand les missionnaires chrétiens et les colonisateurs sont arrivés
à Madagascar, ils ont critiqué et tenté de supprimer cette culture malagasy en le qualifiant de
païenne ou archaïque.
Enfin, il a montré la diversité de la pensée culturelle malagasy en choisissant d’exploiter
la philosophie d’une ethnie le Betsimisaraka, mais non pas la philosophie malagasy en général.
3.2 Limite
Notre auteur a présenté seulement le Famdihana comme un élément qui constitue
l’identité Betsimisaraka, sans rendre compte de la transformation actuelle de cette pratique. Une
partie de la population malagasy qui devient chrétien a rejeté le Famadihana parce qu’elle le
considère comme un pratique non chrétien. En effet, cela renvoie à la question de la pérennité
du Famadihana face aux évolutions religieuses.
Eugène Régis adopte une approche philosophique et spirituelle mais il a oublié certains
aspects problématiques du Famadihana, comme l’inégalité sociale dans l’accès au rituel.

4
Certaines familles Ampañarivo (riche) peuvent organiser des Famadihana somptueux, tandis
que les Vaita (pauvres) doivent se contenter de cérémonies plus modestes. Il a oublié aussi la
question de la santé car l’ouverture fréquente des tombes peut poser des problèmes sur
l’éparpillement de certains virus comme la peste.
Même si notre auteur a insisté sur la valeur philosophique et sociale du Famadihana, il
a négligé la réalité économique et les possibles tensions qu’elle génère. Ces enjeux, bien que
secondaires dans une lecture purement philosophique, sont des défis concrets pour l’avenir du
rituel.
Le professeur Razafimampionona, un enseignant de l’école normale supérieur de
Tuléar, aussi a apporté son critique sur le Famadihana qui est considéré comme une pratique
religieuse, mais c’est une illusion prétendant à sauver l’espoir.
CONCLUSION
Bref, nous venons d’analyser que le Famadihana est un évènement d’une importance
capitale tant pour les vivants que pour les morts chez les Betsimisaraka, et ils croient à la
pérennité de la vie dans le sens que la mort n’est pas une cessation de la vie, mais plus
exactement une modalité d’être. Ce qui est essentielle à retenir c’est que Eugène Régis a porté
un éclairage précieux sur la dimension philosophique du Famadihana chez les Betsimisaraka.
Il a montré comment ce pratique structure la pensée Betsimisaraka en termes de continuité entre
les générations, de transmission de l’énergie vitale et de cohésion sociale. Cependant, une
approche plus critique permettrait d’examiner les limites et les évolutions possibles du
Famadihana aux réalités actuelles. Aujourd’hui, malgré les diverses influences de l’évolution
technologique et de la modernité, le Famadihana reste un élément fondamental de la culture
malagasy, notamment la culture Betsimisaraka, témoignant de la résilience des traditions
ancestrales.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%