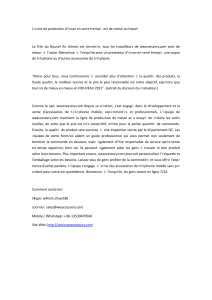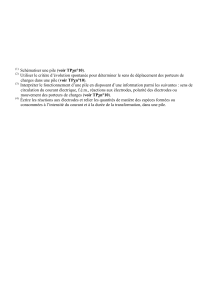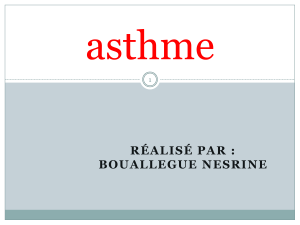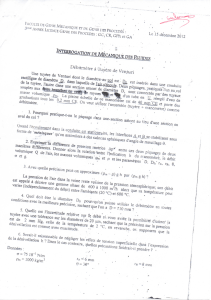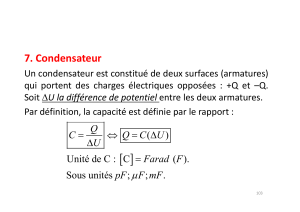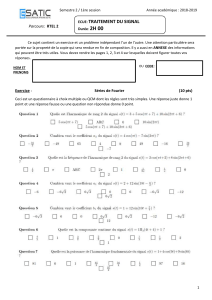MAURICE
GARÇON
Q
ui
était Maurice Garçon
? Le silence
qu'il
a
voulu
sur sa tombe
après
une vie
vouée
à la pratique, à l'art, à l'enseignement et
jusqu'à
l'histoire de
l'éloquence,
n'a pas permis à ses amis et à
ses
confrères
de dresser ce monument provisoire du souvenir
qu'on
appelle un
éloge funèbre.
C'est
dans
la salle de la
bibliothè-
que de l'Ordre des
Avocats,
à l'occasion
d'une
de ces
rentrées
solennelles au cours desquelles le barreau honore ses anciens
bâtonniers
et les plus grands des siens que sera
donné
la mesure
exacte de
celui
qui fut avant tout un avocat. En effet, quel que soit
le prix qu'il
ait
accordé
à son
élection
à
l'Académie Française
et
le
temps
qu'il
ait
consacré
aux
séances
du dictionnaire et à la
pré-
sidence des
prix
de vertu, quelle qu'ait été la place
qu'il réservait
au théâtre,
à l'histoire, à la sorcellerie, à
l'amitié,
quelque impor-
tance qu'ait pu avoir pour lui la vie
littéraire
et la vie mondaine
qu'il
aimait presque excessivement, il fut d'abord un avocat ; un
avocat d'assises et un avocat d'affaires, un avocat
lettré
et l'avocat
des lettres et plus encore, selon le mot de Jean-Marc
Théolleyre,
«
une
manière d'être
avocat.
»
TVTé
à
Lille
en 1889,
Maurice Garçon
est le
fils
d'un professeur de
"
droit,
Emile Garçon,
savant modeste dont les connaissances
étaient étendues
et dont le Code
Pénal annoté
constitue encore un
recueil
consulté.
Son influence est
décisive
:
c'est
de son
père qu'il
reçoit
la passion qui fut celle de
toute
sa vie et
auprès
de laquelle
les
autres
ne sont qu'anecdotes : la
défense
du droit et de la justice.
Il
en faisait volontiers la confidence à ses amis ; « Mon
père:
je lui dois tout » ; il la renouvellera
dans
son discours de
réception
à l'Académie Française
: « Tandis que j'entrais, il y a quelques ins-
tants
dans
cette
salle et que
j'étais
troublé
par la pompe de votre
réception,
mon esprit est
allé
vers
celui
qui fut le guide de ma

MAURICE
GARÇON
535
vie.
Les morts
restent
vivants lorsqu'ils demeurent
présents
dans
notre souvenir. Il m'a
semblé qu'il
me
précédait
et me conduisait
comme
un parrain
invisible,
heureux de son
œuvre.
Ma
pensée
qui
est le reflet de la sienne, m'a
obligé
à faire un retour sur moi-
même
et m'a
rappelé
à la modestie en
m'empêchant
d'oublier que,
si
je ne portais en moi la flamme
qu'il
m'a transmise, je n'eusse,
sans
doute, jamais
mérité d'être reçu ici.
»
Ce qu'il
disait de son
père,
il le disait aussi de cet
autre
maître
et
témoin
de sa vie d'avocat :
Labori.
«
Labori
m'a fait. »
Celui-là
en
effet lui donnera la
leçon décisive
qui
allait
encourager et pour
une part
déterminer
sa vocation. En 1912, l'ancien
défenseur
de
Dreyfus
n'est
plus le paria dont ses
confrères s'étaient détournés,
que ses clients avaient
déserté.
Ses adversaires d'autrefois l'ont élu
Bâtonnier
d'un consentement presque unanime, non pas
malgré
le
souvenir
de
Dreyfus,
mais à cause de ce souvenir, lé Barreau ayant
voulu
garder l'honneur de
l'Affaire
dont
d'autres
avaient eu le
profit
et montrer comment on pouvait encore
être
quelque chose
quelque part,
sans
s'être renié.
«
Vous
avez été la
Défense
», lui
dit
Busson
Billault
en accueillant son successeur à la
tête
de
l'Ordre.
C'est devant ce
Bâtonnier
prestigieux,
présidant
les tra-
vaux
de la
Conférence
du Stage, que
Maurice Garçon
fit ses
débuts.
Il
dira
plus tard les
réserves très
graves qu'appelle ce concours
bizarre
: la
Conférence
du Stage, le
caractère
fictif
du
débat
qui le
constitue, le tour
artificiel qu'il
fait prendre à
l'éloquence
— « Le
discours
tend à gagner un
Tribunal
inexistant en faveur d'une
thèse généralement
absurde ou d'une situation
théorique
sans
rap-
port avec la vie
réelle
» — les
déclamations
vaines et ostentatoires,
souvent sentencieuses ou obscures et qui ne laissent
rien
au ha-
sard
d'un mouvement du
cœur
ou d'un emportement de
l'âme
préférées
à la rigueur du raisonnement, à la
préoccupation
de
logi-
que constructive. — « L'esprit est
chatouillé,
mais la raison
n'est
point
touchée
» —
Mais,
ce
jour-là, Maurice Garçon
est tout à son sujet — sujet
si
quelconque ou saugrenu
qu'il
l'oubliera — et tout au
désir
de
convaincre
et de plaire. Il parle avec un parfait naturel, une
sim-
plicité
qui pouvait passer pour du
sans-gêne,
ce que lui dit son
principal
auditeur en le recevant, selon l'usage,
après
ce premier
discours.
Et le tutoyant
d'emblée
: « Qui te crois-tu mon petit ?
pour
parler avec
cette
aisance de routier quand tu n'es qu'un
blanc-bec
? Te moquerais-tu de nous ? »
Mais
il ajoute : «
Ceci
dit,
c'était très
bien. Tu es
doué,
continue, et du
reste
pour te donner
un
coup de
main,
je vais te passer quelques affaires. »
C'est
ainsi
que
sans
avoir
été
Secrétaire
de la
Conférence, Mau-
rice
Garçon
est commis par le
Bâtonnier
dans sa
première
affaire

536
MAURICE
GARÇON
d'assises, et que sa
carrière
se trouve
décidée.
En effet, le jour
de l'audience, alors que
l'Avocat Général
requiert et que le
débu-
tant
mobilise intérieurement
toutes
ses
facultés
pour se
préparer
à plaider, il
voit
entrer
Labori
— le
Bâtonnier lui-même
— qui
vient
s'asseoir à
côté
de lui : « Je suis venu
voir
comment tu t'en
tires ». Le trac devient
déroute
quand le
Bâtonnier
s'empare
de
son
dossier et en
brouille
les
pages
en le parcourant : «
c'est
par-
fait,
bonne
présentation,
excellente
préparation
», puis les
déchire
et les
jette
sous la
banquette
au moment
même
où l'avocat
général
ayant
terminé,
la parole est
donnée
à la
défense,
— « Maintenant,
débrouille-toi
». Il
fallut
se jeter à l'eau, improviser, composer ses
explications
sur l'impression lue
dans
le regard des
jurés,
s'expri-
mer librement sur un dossier connu. Rude et salutaire
leçon.
Réformé
en raison de son mauvais
état
de
santé, Maurice Gar-
çon
commence sa
carrière
devant les Tribunaux
Militaires
au cours
des
années
1916-1917. Ces circonstances
difficiles
lui donnent la
mesure de son
métier,
mais lui valent la rancune de beaucoup
d'anciens combattants qui lui barreront
l'entrée
du
Conseil
de
l'Ordre,
lorsque son âge ayant rejoint son
mérite,
il
sollicitera
les
suffrages de ses
confrères.
Dès la fin de la guerre,
l'expérience qu'il
a
acquise, la
réputation qu'il
a
méritée,
le
zèle qu'il
a
apporté
à
s'occuper à la demande du
Bâtonnier Henri
Robert des affaires de
plusieurs de ses
confrères mobilisés
lui donnent un cabinet impor-
tant.
Le
piétinement
des apprentissages lui fut
épargné.
"Pace aux grands avocats d'assises de l'entre deux guerres,
César
Campinchi, Vincent
de
Moro-Giafferri,
Henry
Torrès,
dans
la
fameuse affaire Mestorino ou en
défenseur
du jeune
Mouvault,
il
affirme
et il confirme son talent ; s'il
n'est
pas encore le plus
grand — il faudra
attendre
les affaires
Henri Girard,
Bernardy de
Sigoyer,
René Hardy, Gérard Dupriez,
Marguerite
Marty,
Denise
Labbé
— il est
déjà
unique. Peut-on le cataloguer ?
Dire
quelle
était
sa «
manière
» ? «
Vous
classerai-je.
Monsieur
? lui demandait
André Siegfried
en le recevant en 1948 à
l'Académie Française.
Ce
serait
difficile. Vous êtes
de ceux qui convainquent et de ceux qui
renseignent, mais la magie de la parole ne vous est pas inconnue
ni
même
certains de ses
sortilèges...
» S'il connaissait tous les
genres
qu'il
a
décrits
dans
son
Essai
sur
l'Eloquence
Judiciaire,
il
savait en refuser certains.
Connaissance approfondie du dossier,
préparation
minutieuse,
voire
maniaque, logique caustique
éprise d'idées
claires, heureuse
élocution, l'élocution étant
prise
dans
son
sens
exact,
c'est-à-dire
art de
choisir
les mots et de les assembler,
simplicité
de ton dont

MAURICE
GARÇON
537
l'inoffensive
apparence donne
à son
propos
une
grande
autorité,
sont
les
dominantes
de ce que l'on
appelle
le
talent
et
qu'il
vaut
mieux
appeler
sa
présence.
Maurice
Garçon
avait
à la
barre
une
présence
imposante jusque
dans
ses
silences dont
il
avait
le don
de savoir jouer
et
qu'il
faisait durer comme
à
plaisir,
jusque
dans
sa
manière
de ne pas
achever
une
pensée
;
imposante
et
redoutable
pour l'autre,
fût-il
le
confrère
ou le
ministère
public,
et,
laissons
Madeleine
Jacob
le
dire,
«
fût-il
au
besoin
le
magistrat
présidant
l'audience
».
Il
n'était
pas un
tribun
; il
n'avait
ni le
physique
de
Danton,
ni
les saillies
de
Tixier.
D'une
élégance
à la
fois
présente
et
invisible,
d'une
nonchalance
appliquée,
il
était
toujours
maître
de
lui.
Hau-
tain,
lointain,
il
était
d'un
grand sang-froid
qui
n'était
pas
sans
procédé
: il
tendait
à
intimider l'auditeur. Au besoin,
à
l'audience
il
feignait
de
somnoler
ou
brossait
de
rapides aquarelles sous
le
regard
navré
du
Président
pour
«
casser
» les
effets
de
l'adver-
saire. Tandis
qu'il
se
réservait
ainsi,
rien
ne
lui
échappait
; il
était
prêt
à
déployer
brusquement
sa
longue
et
mince silhouette pour
laisser
tomber
une
ironique
ou
dédaigneuse
intervention, dont bien
des
officiers
de
police
et
bien
des
experts
ont
fait
les
frais
et
qu'il
terminait parfois
d'un «
sortez, Monsieur
!
» qui
chassait
le
témoin
de
la
barre.
Mais
ses
apostrophes
n'étaient
jamais
des
incartades
incontrôlées
ou des
imprécations
vaniteuses,
car
lui n'oubliait
pas
que
la
personne
du
défenseur
est
secondaire
dans
un
procès
et
qu'il
doit
se
sacrifier
plutôt
que de
chercher
un
succès
aux
dépens
de
son
client.
Il a
fait
lui-même
la
théorie
de ce
procédé
oratoire
qu'on
appelle
en
langage d'avocat
un incident :
«
L'orateur
n'a
jamais droit qu'à
une
colère
feinte
ou à une
violence
dont
il
restera capable
d'apprécier
la
portée
et
d'arrêter
le
cours.
La
colère
est une
faiblesse,
la
colère
feinte
une
habileté
et le
calme
une
force.
L'incident
bien
mené
peut
revêtir
les
apparences
de la
colère,
mais
ne
doit
pas
amener
à
perdre
le
contrôle
de la
raison.
Aussi,
est-ce
une erreur
de
croire
qu'il
est
possible
de
créer
un
incident
sans
avoir,
fût-ce
dans
un
éclair, apprécié
son
opportunité,
compris
ce
qu'on
en
tirera,
et
déterminé
la
limite
qu'on
ne
dépassera
pas. Un
incident
est
nuisible
pour
celui
qui le
provoque, lorsque l'adversaire conserve
son
sang-froid,
aperçoit immédiatement
la
faiblesse
de
l'aboutissement,
laisse
passer l'orage,
et
observe
sèchement,
lorsque l'avocat
est
exténué,
que
toutes
ces
clameurs
étaient
inutiles
et
ridicules.
»
«
Inexorable
», dit
encore Madeleine Jacob
en
cherchant
l'épi-
thète
lui
convenant
le
mieux quand
il
étalait
les
expressions
de
son mépris
:
plaidant pendant l'occupation allemande contre
un
collaborateur notoire, plagiaire d'occasion,
il
avait
lancé
: « Cer-
taines
gens,
comme
celui-ci,
qui
croient
recouvrer leur honneur à
la
faveur
des
malheurs
de la
patrie.
»

538
MAURICE GARÇON
Plaidant
pour Marguerite
Marty, répondant
devant
les
assises
de Perpignan
de
l'empoisonnement
de
son
mari,
dans
une
audience
dramatique
où la
défense
devait
s'attaquer
à une
coalition
locale
qui
couvrait
les
brutalités policières
dont
l'accusée
avait
été la
victime,
il
avait pour contradicteur,
au
banc
de la
partie
civile,
une nouvelle
fois, René Floriot. Floriot
avait
plaidé,
terrible
d'effi-
cacité
comme
à
l'ordinaire.
Appelé
dans
le
Nord,
il
n'avait
pu
écouter Maurice Garçon,
mais il avait
annoncé qu'il
reviendrait pour
lui
répondre. Cela
n'est
pas
dans
les
usages.
Quand
il eut
terminé,
on
vit
Maurice Garçon
se
lever, frapper
la
table devant
lui de son
dossier
fermé,
et ce fut,
dans
un
silence
qui est la
récompense
de
l'avocat, l'apostrophe vengeresse qui
précéda
l'acquittement
: «
Cin-
quante
ans de
carrière,
je
n'avais
encore
jamais vu ça
!
Or ça, pour
qui
vous
prenez-vous
donc
?
pour le
collaborateur
de
l'exécuteur
des hautes
œuvres
?
»
On
pourrait
multiplier
les
exemples,
dans
les
petites
comme
dans
les
grandes
causes,
de
cette
façon sèche
ou
ironique d'humi-
lier
l'adversaire
et
dont
l'efficacité
n'est
plus
à
démontrer.
Plaidant
pour Jacques Boulenger qui, pour avoir
donné
la
liste
approximative
des
amants
de
George Sand, baronne Dudevant,
celle
que
Sainte-Beuve appelait
une
Christine
de
Suède
de
l'esta-
minet, avait été
assigné
en
diffamation envers
la
mémoire
de
l'aïeule
par
sa
petite-fille,
il
feint d'avoir
dû
réconforter
son
client fort
ému
parce
que
«
savant chartiste
et
scrupuleux historien,
il
n'imaginait
pas,
qu'at-
tribuant
un
fait historiquement
vrai
à un
personnage illustre,
il pût
être
poursuivi
par le
téméraire héritier
de ce
personnage sous
le
pré-
texte
que
l'histoire vraie
ne
peut
être
dite,
et que
l'inexactitude
est un
devoir
de la
critique
littéraire
» ...
«
En
vérité, l'émotion
de
monsieur Jacques Boulenger venait
de ce
qu'il
a
une
telle
opinion
de la
justice,
qu'il
n'imagine
pas
qu'un plaideur
peut
être
assez audacieux pour
présenter
devant
un
Tribunal
une
récla-
mation
impossible.
Il
pensait donc
que son
adversaire avait
établi
son
assignation
sur des
bases
solides,
et
invoquait contre
lui
des
principes
juridiques
et
sérieux.
Je l'ai
rassuré
en lui
expliquant
que
nombreux
sont,
hélas !
les
procès insensés
qui
vous sont soumis.
N'est-il
pas
vrai
que certains plaideurs manquent assez
de
jugement pour prendre leurs
rêveries
pour
des
réalités,
et que
d'autres,
ennemis
de
l'obscurité,
pen-
sent
qu'un
procès
perdu fait encore assez
de
bruit pour forcer l'atten-
tion
de la
foule
?
Votre barre procure
la
publicité
la
moins
coûteuse
de
toutes,
en
dépit
de
l'augmentation
des
tarifs judiciaires,
et
cette
obser-
vation
liminaire,
digne d'expliquer beaucoup
de
procès
parisiens jus-
tifie
seule
la
présente
instance.
»
«
Il
possédait
de
réelles qualités
oratoires.
Il les fit
constater,
puis
il
s'aperçut
que
l'autorité
se
conquiert lentement.
»
Comme
Suret-Lefort,
le
jeune
député
du
roman
de
l'Energie Nationale
de
Maurice Barrés, Maurice Garçon découvrit
bien vite
et en fit une
règle
de vie que
l'autorité
de
l'orateur
ne
réside
pas
moins
dans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%