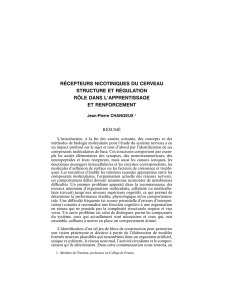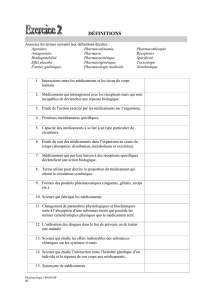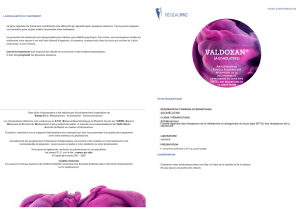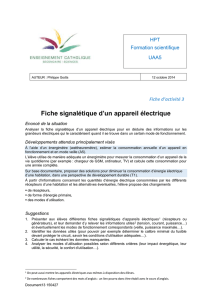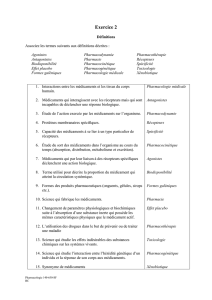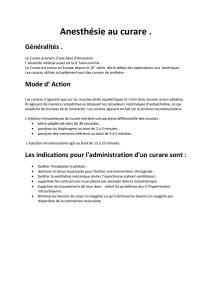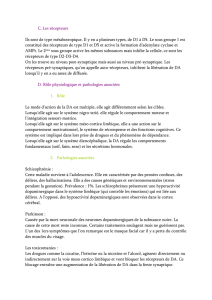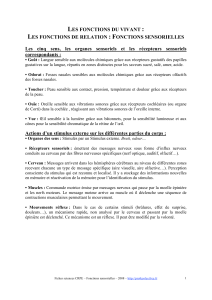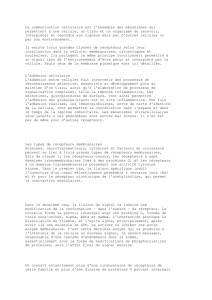Bloqueurs neuromusculaires et anesthésiques : mécanismes pharmacologiques
Telechargé par
jmfdewitte

Nous, les humains, avons su utiliser les ressources naturelles afin de nous aider au quotidien. On
retrouve dans ce cas-là les peuples originaires d’Amazonie, qui, par appropriation de leur milieu,
provoquaient la mort du gibier par asphyxie en enduisant leurs armes de substances végétales : les curares.
Ces connaissances empiriques des autochtones nous a permis de développer notre savoir pharmacologique,
produisant des substances utilisées en médecine lors de l’anesthésie du patient. Nous pouvons donc nous
demander :
Quand le message ne passe plus : comment provoquer les silences du système neuromusculaire ?
Action des curares sur les récepteurs nicotiniques
Cycle : train de potentiel d’action venant d’un neurone pyramidal, libération ACh, destruction ACh par AChE
(à faire avec un schéma présenté et présentation rapide)
Deux types de curares, qui agissent au niveau des récepteurs neuromusculaires :
Curare dépolarisant :
Le seul curare dépolarisant utilisé couramment en milieu hospitalier est la succinylcholine. Il se fixe aux
récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine ET entraîne une dépolarisation prolongée du muscle, et donc les
fasciculations musculaires qui sont la cause de douleurs musculaires au réveil du patient (courbatures).
Point de vue avantages, la succinylcholine agit très vite (en quelques secondes) et dure très peu de temps.
Elle est donc idéale si on se borne à curariser pour intube.
Deux grands problèmes :
-Fasciculations musculaires
-Pas d’antagonistes.
Curare non-dépolarisant :
C'est le cas de la quasi-totalité des curares utilisés en médecine. Ils se fixent aux mêmes récepteurs
nicotiniques de l’acétylcholine MAIS ils n'entraînent pas de dépolarisation du muscle, donc pas de
contractions, donc pas de courbatures.
Plusieurs variétés de molécules existent ayant une durée de vie de quelques minutes à 2 heures. Les points
d’intérêts des curarisants non dépolarisants sont :
-Longue durée d’action
-Absence de fasciculations
-Existence d’antagonistes antidotes
Il existe deux antidotes aux curares non dépolarisants.
Transition : Néanmoins, immobiliser le patient n’est pas suffisant : il est toujours conscient. Comment lui
permettre alors d’atteindre l’état d’inconscience chimiquement ?
Commenté [JD1]: Strychnos toxifera : Cette espèce est
originaire d’Amérique du Sud, où elle est connue sous le
nom de “curare vine”. Les peuples autochtones d’Amazonie
utilisaient traditionnellement la sève de cette plante pour
fabriquer des fléchettes empoisonnées pour la chasse. La
sève contient des alcaloïdes qui paralysent les muscles des
proies facilitant ainsi la capture.
Commenté [JD2]: Neurone pyramidal > cortex moteur >
lobe frontal
Commenté [JD3]: Espérance de vie d’ACh dans la fente
synaptique : inférieure à 1ms
AChE : hydrolyse 25 000 ACh par seconde en choline + AcCoA
Commenté [JD4]: La néostigmine, qui inhibe l'action de
l'acétylcholinestérase (destructeur de l'ACh). Si l'ACh n'est
plus détruite de façon continue, sa concentration sous forme
libre augmente dans la fente synaptique, et elle va ainsi
reprendre plus rapidement sa place sur les récepteurs et
faciliter le retour des contractions musculaires.
Le sugammadex est un antidote de certains curares
seulement. C’est un antidote « pur » qui va se lier avec les
curares (qui réagissent avec lui… cad pas tous…) et en faire
un complexe non utilisable par les récepteurs de la plaque
motrice. Le bloc musculaire est ainsi rapidement levé.

Les anesthésiques : les marchands de sable chimiques
Tout d’abord, un peu d’histoire. Lorsque en octobre 1846, William T. MORTON, au Massachusetts
General Hospital réalisa la première anesthésie à l'éther, il devint rapidement évident qu'une ère nouvelle
s'ouvrait pour la chirurgie. Dans les semaines qui suivirent, les premières se succédèrent à travers le monde,
et c'est ainsi que quatre mois plus tard, est réalisée la première anesthésie à l'éther non-loin d’ici, à l'Hôpital
Saint-Sauveur de Lille.
Depuis l’éther, les substances anesthésiantes ont évolué pour cibler plus spécifiquement les
récepteurs neuronaux.
Les anesthésiques permettent l’état de narcose du patient, par « arrêt chimique » des
communications nerveuses bien que l’on n’en connaisse pas le fonctionnement précis. En effet, ces
substances, tel que le propofol, se fixent sur des récepteurs spécifiques des neurones : les récepteurs à GABA.
Une fois fixés, les récepteurs à GABA s’ouvrent, laissant alors entrer des ions Cl
-
. Cette entrée d’ions provoque
alors une hyperpolarisation du neurone (normalement de -70mV), soit une impossibilité de transmettre un
message nerveux par potentiel d’action, puisque celui-ci nécessite de dépolariser les axones pour parvenir à
sa cible.
Les mécanismes précis restent partiellement élucidés et représentent donc un lieu de recherche
immense, qui n’a fait que de faire progresser les techniques : en 50 ans, on observe un nombre de personnes
réveillées après intervention ayant augmenté de 90%.
Transition : nous avons maintenant de quoi paralyser et endormir une personne chimiquement. Mais dans
cet état où elle ne peut rien faire, elle est tout de même capable de ressentir, notamment la douleur.
Comment palier à cela ?
Opiacés : une intervention sans douleur
Les opioïdes comme le fentanyl sont la clé pour limiter la douleur, que ce soit lors d’interventions
chirurgicales ou simplement dans un sirop pour la toux.
Les opiacés sont des substances issues de l’opium, soit le latex qui provient du Pavot. Ce latex est
alors constitué de codéine et de morphine, qui ont tous deux des propriétés analgésiques.
Notons que l’on distingue les opiacés (substances dérivées de l’opium) des opioïdes (substances
synthétiques dérivées de l’opium ayant des effets similaires).
Ces substances agissent en mimant les effets des opioïdes endogènes (tel que les endorphines). Elles
ciblent les récepteurs opioïdes (plusieurs types mais surreprésentation du récepteur mu (majoritairement
dans le thalamus, lieu d’intégration des influx sensoriels, sensitifs et moteurs) ce qui dissocie la protéine G
auquel il est associé en deux sous-unités :
-d’abord l’unité G
alpha
, qui augmente le seuil d’excitabilité neuronale
-et ensuite G
béta
et gamma
, qui hyperpolarise les neurones et empêche la libération de neurotransmetteurs.
Commenté [JD5]: Pavot somniferum
Commenté [JD6]: Galpha joue alors un rôle inhibiteur sur
l’adénylate cyclase, qui, en temps normal, transforme l’ATP
en AMPc pour phosphoriser les protéines impliquées dans la
transmission de l’influx nerveux et la libération de
neurotransmetteurs. L’inhibition de l’adénylate cyclase
revient donc à diminuer l’excitabilité neuronale (on
augmente le seuil d’excitabilité).
Commenté [JD7]: Gbéta et gamma, quant à lui, ouvre les
canaux potassiques GIRK. Des ions K+ sortent du neurone, ce
qui l’hyperpolarise. Il est alors moins susceptible de produire
un potentiel d’action, et donc de permettre au corps de
réagir face à un signal de douleur.
De plus, ils ouvrent aussi des canaux faisant sortir des
cellules les ions Ca2+, ce qui empêche la fusion des vésicules
avec la membrane des boutons d’axones, et donc pas de
libération de neurotransmetteurs

Ainsi, à travers l’histoire et les progrès pharmacologiques, l’humain a su maîtriser l’art de faire taire
temporairement son propre système nerveux : d’abord en paralysant le muscle, puis en éteignant la
conscience, et enfin en annihilant la douleur. Une maîtrise fascinante, mais aussi porteuse de nombreux
enjeux éthiques et médicaux. Le rôle de l’anesthésiste, expert dans son domaine, consiste alors en la maitrise
des dosages de ces produits qui, à doses infimes ne protègent pas le patient, mais en surdoses sont dangereux
voire mortels tel que les curares qui provoquent une insuffisance respiratoire par la paralysie du diaphragme
et surtout des muscles intercostaux.
Cependant, certains patients témoignent d’avoir été conscients pendant leur opération, incapables de
bouger ou de parler. Et si notre maîtrise de l’anesthésie n’était qu’apparente ?
Commenté [JD8]: Surtout chez les patients atteint de
myasthénie auto-immune (se référer aux connaissances de la
version antérieure du sujet)
1
/
3
100%