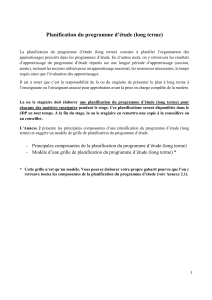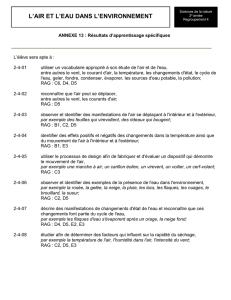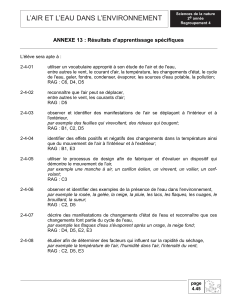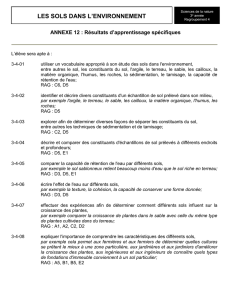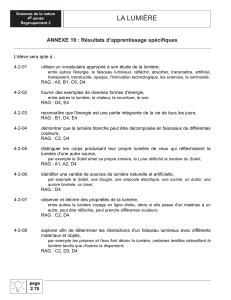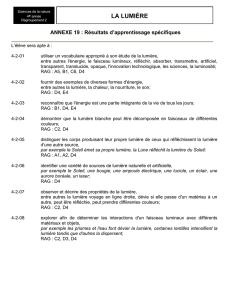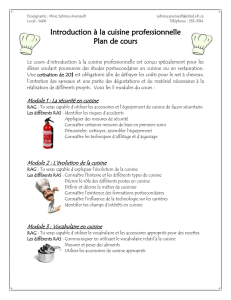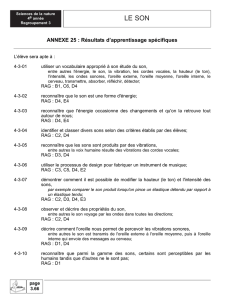Chapitre 2 : Approche Methodologique
Introduction
La technique du Retrieval-Augmented Generation (RAG) constitue une avancée majeure
dans le domaine du traitement du langage naturel (NLP). Elle permet d’enrichir les
capacités des modèles de langage (LLM) en les connectant à des sources de données
externes pertinentes, structurées ou non.
Dans le cadre de notre projet, qui vise à développer un chatbot d’assistance étudiante
dans un environnement universitaire, les modèles LLM présentent certaines limites. En
effet, ces modèles sont entraînés sur des corpus généraux et statiques, ce qui les empêche
d’accéder à des données actualisées ou spécifiques à un domaine précis. Cela peut entraîner
des réponses erronées, incomplètes ou trop génériques.
L’approche RAG permet de dépasser ces limites en intégrant dynamiquement au modèle des
informations extraites à la volée depuis une base documentaire locale. Cette base
comprend ici des documents administratifs universitaires, utilisés pour guider les
réponses du modèle avec plus de précision et de contextualisation.
1. Demarche utilisée
Le développement du système RAG s’est appuyé sur une démarche structurée, comportant
plusieurs étapes essentielles décrites ci-dessous :
La collecte de données
La donnée constitue le socle de tout système RAG. Dans notre cas, il s’agit de documents
officiels issus du milieu universitaire (règlements, descriptions de formations,
procédures administratives, etc.). Ces documents ont été obtenus auprès des
établissements partenaires et serviront de base de connaissances pour guider les
réponses du chatbot.
Segmentation des documents
Une fois collectés, les documents sont segmentés en petits blocs d’information
homogènes. Ce découpage permet de :
Faciliter l’indexation et la recherche,
Éviter d’intégrer des passages non pertinents dans les réponses,

Améliorer la vitesse de traitement du système.
Chaque segment est ainsi plus facilement exploitable pour répondre de manière précise
à une question ciblée de l’utilisateur.
L’image represente le decoupage du document
Conversion des données
Les blocs textuels sont ensuite convertis en représentations vectorielles à l’aide du
modèle sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 de HuggingFace. Cette opération
permet de capturer le sens sémantique des textes et de les rendre comparables
mathématiquement.
La base vectorielle est ensuite construite avec Faiss, un moteur performant conçu par
Facebook pour la recherche rapide de similarité entre vecteurs. Cela permettra, plus
tard, de retrouver les segments les plus proches d'une question donnée.
L’image suivante represente la vectoririsation des données des documents en
representation numerique

Traitement des demandes de l’utilisateur
Lorsqu’un utilisateur soumet une question, celle-ci est également vectorisée selon le
même modèle que celui utilisé pour les documents. Cela garantit une cohérence dans les
représentations.
Le système recherche ensuite, dans la base Faiss, les segments les plus proches de la
requête selon une mesure de similarité (cosinus, distance euclidienne, etc.). Les
passages retrouvés sont alors utilisés pour construire un contexte pertinent. Les
documents fournies proviennent d’une page web oreille du campus ne contenant que
les informations sur l’UFR/SEA .Nous retrouvons donc les passages les plus pertinants à
la requete de l’utilistaur.L’image suivante nous montre une partie des passages. Plus la
requete de l’utilisateur est plus precis plus la reponse est plus coherent.
Générer les reponses avec un LLM

Enfin, les segments extraits, accompagnés de la question de l’utilisateur, sont injectés
dans un modèle de langage (LLM) tel que LLaMA 3 via l’API Groq. Ce modèle génère
alors une réponse formulée naturellement, en prenant en compte le contexte
fourni.L’image suivante represente la reponse du model.
2. Approche et Architecture proposé pour traiter la problematique
Afin de répondre efficacement à la problématique posée – fournir une assistance
contextualisée aux étudiants – une architecture RAG a été conçue. Celle-ci repose sur une
chaîne de traitement articulée autour des étapes suivantes :
Étape 1 : Réception de la requête utilisateur
L’utilisateur interagit avec le chatbot via une interface web. Sa question constitue le point de
départ du pipeline.
Étape 2 : Traitement initial de la requête
Le backend vérifie si une réponse générique peut être fournie. Si ce n’est pas le cas, la
requête est envoyée au moteur de recherche contextuelle.
Étape 3 : Récupération des données
Une recherche est effectuée dans la base documentaire vectorielle locale construite à
partir des documents administratifs. Les blocs les plus pertinents sont extraits pour enrichir
le contexte.
Étape 4 : Construction du contexte
Les segments retrouvés sont organisés et combinés pour former un contexte cohérent
autour de la question posée.
Étape 5 : Génération de la réponse

Ce contexte est ensuite transmis à un LLM qui génère une réponse complète, pertinente et
formulée naturellement. Celle-ci est renvoyée à l’utilisateur via l’interface.
Cette architecture permet de tirer pleinement profit :
de la puissance de généralisation des LLM,
de la précision documentaire du système de récupération,
et de la flexibilité offerte par une base documentaire modifiable à tout moment.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%