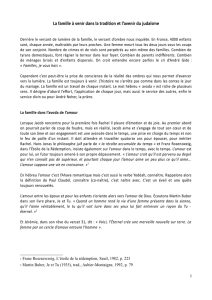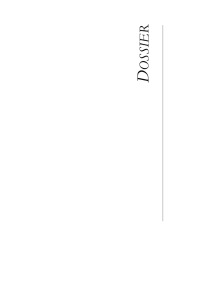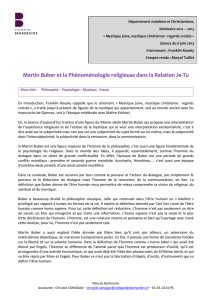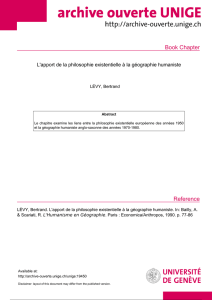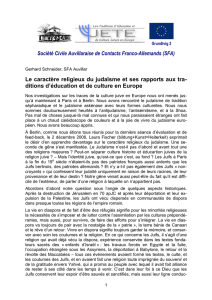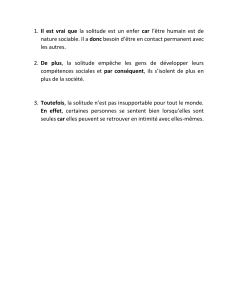La relation : historique du concept selon Martin Buber
Telechargé par
Antoine Lokatikala

CHAPITRE PREMIER
L'HISTORIQUE DU CONCEPT DE LA RELATION
I.0. Introduction partielle
La relation est un thème le plus décisif dans la période contemporaine. La relation comme expression
de l'être, la relation comme rapport entre les humains. Elle implique au moins deux êtres, un être et
un objet, et est souvent décrite via des typologies différentes, selon la personne s'intéressant à la nature
de la relation ou plutôt aux personnes en relation. Les relations humaines d'une manière collective
sont nécessaires au développement individuel et intellectuel de chaque être humain, du fait que grâce
à ces liens, les sociétés sont constituées. Il y a même lieu de dire que, sans bonnes relations humaines,
il ne peut y avoir de bonne qualité de vie. Cela veut dire que Buber a compris qu'une vie pleine se
réalise dans la relation. Et il parvient a envisagé quelques attitudes de l'homme en face de ses
semblables, essentiellement l'isolement, la solidarité et l'amour mutuel. Meilleurs cadeaux pour vos
proches
Dans ce chapitre intitulé `'l'historique du concept de la relation'', nous allons développer la notion
philosophique de la relation en premier lieu ; en deuxième lieu nous allons voir l'homme dans ses
relations ; par après nous verrons les deux couples de relation chez Martin Buber ; nous traiterons
aussi de la relation comme engagement de soi et pour finir, il sera question de voir les attitudes de
l'individu envers autrui dans la relation.
Commençons avec la notion philosophique de la relation.
I.1. Notion philosophique de la relation
La relation fait référence à quelque chose de plus fondamental ; c'est une caractéristique de notre être
en tant qu'elle se définit comme lien à autrui. Dans ce sens, on pourrait dire de manière un peu
sommaire que l'être humain est marqué par les rapports qu'il entretient avec les autres. A vrai dire, ce
concept est interprétatif de la réalité sociale : il exprime d'abord le fait qu'à la base de toute vie, il
existe des liens qui unissent les gens.
Le concept de `'relation'' apparait comme l'un des concepts fondamentaux du discours pertinent dans
la philosophie de Martin Buber. Il désigne toute espèce de rapport. Aristote en fait une des premières
catégories aussitôt après la substance, à côté de la qualité et de la quantité.
L'Antiquité païenne gréco-latine connaissait déjà une notion de personne caractérisée par des aspects
relationnels. Chez Cicéron par exemple, le terme persona désignait l'individu humain doué de raison
et agissant dans un contexte social, la présence singulière d'un homme convaincu dans sa
proximité1(*).
Depuis longtemps, la réflexion philosophique, sociologique et psychologique n'a cessé d'étendre et
d'approfondir la notion de relation, en distinguant ses divers types interpersonnels qui interviennent
dans la constitution, puis dans le développement de la personne humaine.
Dans l'espace de la relation s'orchestre une rencontre des différences, les contestations, les écarts, les
divergences. Cette coprésence se déploie vers le « tout monde », un monde chaotique et imprévisible.
L'analyse de la structure dialogique de la personne, en phénoménologie, part de l'affirmation suivante
: on se découvre être une personne, un `je', lorsqu'on se trouve en relation avec un `Tu'. Cette voie se
réfère souvent à Martin Buber. Elle est celle qui intéresse notre travail tout entier.

En opposition a Martin Heidegger qui nous montre l'être ainsi posé, l'être dans le monde, Buber pose
un principe dialogique. Il ne s'agit plus de décrire la manière dont un sujet atteint un objet mais de
préciser l'espace où trouver les structures qui permettent l'objectivation. Pour sortir de ce je enfermé
en lui-même, Martin Buber présente la doctrine de la relation Je-Tu comme une volonté de décrire
positivement cet effort qui au-delà de l'objet se porte vers l'être sans que cette connaissance n'engendre
une entité inhumaine et neutre, mais rende compte d'une relation et, ce faisant, de la société comme
d'une modification totale de l'être. Martin Buber ne flotte pas dans les parfums de la mystique,
contrairement à ce que certains ont laissé entendre. Il affirme que la condition de toute véritable
rencontre tient à la spécificité de ceux qui y participent.
Passons au point suivant, celui de l'homme dans ses relations.
I.2. L'homme dans ses relations
La relation se définit comme un échange entre deux acteurs, qui éveillent chez eux des attentes
culturellement définies ; elle est un lien de dépendance ou d'influence réciproque entre les personnes.
Ce concept s'oppose tant à l'individualisme, où l'autre n'est perçu que par rapport à lui-même, qu'à la
perspective collective, où l'individu est occulté au profit de la société.
Martin Buber a pris ce concept d'une façon spéciale et lui a donné une valeur. Pour lui, cette relation
n'est pas à voir seulement entre les hommes, mais aussi entre l'homme et Dieu. Il milite pour une
relation fraternelle qui n'exclut pas le dialogue.
Pour Buber, la vraie relation présente quatre aspects importants : la réciprocité, la présence, la totalité
et la responsabilité.
La relation chez Buber repose sur la réciprocité, laquelle n'existe que là où il y a la présence réelle
des autres. Entrer en relation avec l'autre c'est affronter sa réalité et l'assumer dans la vie vécue. C'est
aussi avoir la capacité d'écouter l'autre dans ce qui le touche personnellement. C'est pouvoir l'entendre
affirmer ses convictions, ses désirs, ses attentes, le laisser parler de la façon dont il se vit.
Dans la réciprocité notre auteur suppose que l'autre soit saisi comme conscience et non comme
phénomène. Le Tu agit en moi comme j'agis en lui. Nous parvenons à remarquer ici une attitude
d'opération : Je qui opère Tu et Tu qui opère Je. En parlant du Je ou du Tu, Buber évoque l'homme
réel.
L'autre comme présence, comme être physique est rencontré. Ici on vise l'être intégral. Pour Buber,
lorsque nous sommes en présence de l'autre, nous devons l'aimer d'un amour qui ne soit pas aveugle.
Puisque dans l'amour les deux partenaires sont conviés à un tête-à-tête exclusif2(*). Etant donné que
le Je et le Tu forment un seul monde, celui de la relation dans toute son intégrité, l'action de l'un et de
l'autre les concerne. C'est cela qui se produit sous le nom de responsabilité. Meilleurs cadeaux pour
vos proches
En dehors de ces quatre aspects, Buber parle expressément de l'autre que je rencontre, qui manifeste
un caractère diffèrent que moi, mais qu'il faut supporter et considérer comme tel. Cela nous amène à
dire que chacun doit traiter l'autre non pas comme objet, mais comme son semblable. Et lorsque les
deux partenaires arrivent à s'abandonner dans une complète mutualité, ils atteindront la sphère de
l'interhumain3(*). Voyons à présent les deux couples de relations chez Martin Buber.
I.3. les deux couples de relations chez Buber
Dans ses recherches et expériences, Martin Buber a mis en exergue, sous une forme originale et
expressive au moyen de tournures grammaticales particulières, les deux concepts constitutifs de la

relation, le`'Je-Tu'' et le `'Je-Cela''. Cette diversité de couple ne peut se réduire en un seul, car, dans
notre vie, nous nous rapprochons a des expériences diverses, notamment, dans les rapports avec les
autres sujets et les objets extérieurs. Dans ce sens, la vie humaine est essentiellement une série de
rencontres : rencontres avec les objets extérieurs, rencontres avec les autres sujets, rencontres
intérieures avec nous-mêmes4(*). Buber postule que le monde est double pour l'homme car l'attitude
de l'homme est double en vertu de la dualité des mots fondamentaux, des mots principes qu'il est apte
à prononcer.5(*)
A) La relation Je-Tu
Pour Buber, Le mot-principe Je-Tu confère à la personne sa pleine valeur. Autrement dit, la personne
ne s'accomplit totalement que dans la référence à l'autre. Ce rapport entre Je et Tu s'actualise dans la
parole. Et l'homme devient un Je au contact du Tu.
Dans son analyse, Buber est convaincu que la relation Je-Tu est d'ordre existentiel. Il affirme la
suprématie de cette relation de par sa finalité :
« L'homme devient un Je au contact du Tu. Le partenaire parait et s'efface, les phénomènes de la
relation se condensent ou se dissipent et c'est dans cette alternance que s'éclaircit et croit de proche
en proche la conscience du partenaire qui demeure, la conscience du Je »6(*).
Cette relation est personnelle parce qu'il s'agit des sujets. Lorsqu'elle se prolonge, elle aboutit au Tu
éternel, au divin. Ce dernier occupe une place importante dans la pensée de Buber puisqu'il fait une
forte référence à la religion. A travers l'autre, on arrive au Tu divin, créateur de ce qui existe. L'homme
doit lui rendre grâce et le prier.
B) La relation Je-Cela
Contrairement au couple personnel, celui du Je-Tu, ce deuxième instaure un rapport de type
impersonnel, parce qu'il ne s'agit pas de relation entre les sujets mais entre le sujet et l'objet. Le but
est celui d'utiliser, d'instrumentaliser et d'objectiver.
Cette relation instaure un rapport qui ne permet pas la pleine réalisation du Je, il ne le crée pas et ne
l'édifie pas. C'est un rapport où le sujet est amené à utiliser l'objet dans le but du savoir, du connaitre
et de l'expérience7(*). Ce qui n'est pas le cas pour le couple personnel Je-Tu.
Le Je-Cela est une forme de relation qui repose totalement sur l'expérience objective. Il ignore la
différence entre deux termes. Le Je absorbe complètement l'autre car leurs valeurs sont différentes.
C'est le domaine, selon la conception de Buber, de l'oppression, de l'objectivation, de la totalité. Le
Cela instaure un domaine totalement impersonnel et reste subalterne au couple Je-Tu.
On pourrait dire que le modèle Je-Cela relève de la connaissance de l'autre au sens de l'acquisition
d'un savoir sur l'autre, du rassemblement d'un certain nombre d'éléments permettant une appréciation,
un diagnostic de la personne, qui bien qu'utile, semble insuffisant pour traduire et exprimer l'ensemble
du processus inter-relationnel. Ce couple s'ancre dans le monologue, qui transforme le monde et l'être
humain en objet. Dans l'ordre du monologue, l'autre est réifié, il est perçu et utilisé. Pour qualifier le
monologue, Buber parle d'une expérience superficielle des attributs extérieurs de l'autre ou de
l'expérience intérieure insignifiante, qu'il oppose à la relation authentique qui intervient entre deux
êtres humains.
Une lecture attentive de Buber en ce sens nous pousse à reconnaitre la priorité du premier couple,
celui du Je-Tu par rapport au deuxième, Je-Cela. Parce que c'est le premier seul qui permet le passage

au Tu Absolu. Et son rapport n'est pas de l'ordre des choses, mais des personnes. De ce fait, le rapport
avec Dieu est vu également sous ce caractère personnel.
I.4. La relation, un engagement de soi
La façon dont le concept « relation » est abordé dans ce chapitre se trouve placée à l'abri de toute
particularité entre les humains ; c'est-à-dire qu'il n'est pas question de distinguer les sens de rapport
entre les personnes. Loin de là. Qu'il s'agisse donc de la relation véritable et sincère.
Cependant, un aspect moral qui est l'engagement de « soi » est à dégager dans la relation. La
responsabilité qu'exige la relation ne devient effective, affirme Buber, que s'il existe un juge devant
lequel je dois répondre de moi-même, et dont le seul critère de choix est la compétence.
Ainsi, celui qui exerce la responsabilité dans la relation a toujours comme point de départsoi-même
et comme point d'arrivée la communauté des personnes qu'il rencontre et non le Tu seul. Car, au cours
d'une telle relation on est entièrement engagé par sa présence, ses mouvements et la considération de
l'autre en face de nous. A ce point nous voyons que la philosophie de Levinas, celle de l'autre, se
révolte contre l'enfermement de l'autre et veut que l'autre prime8(*).
Un facteur important à soulever ici est que de nombreuses recherches ont montré que les gens qui se
découvrent avoir les mêmes idées ou les mêmes centres d'intérêt, ont tendance à entrer plus facilement
en relation les uns avec les autres, ils s'engagent sans aucune difficulté.
I.5. Les attitudes de l'individu envers autrui dans la relation
L'individu dans sa façon d'être manifeste en lui-même tout comme devant les autres une diversité
d'attitudes. Buber en cite deux : premièrement il nous parle de la solitude comme abandon de soi par
les autres (la déréliction) et deuxièmement il parle de la solitude comme abandon des autres
(l'égoïsme). A l'opposé de ces deux attitudes, Buber trouve une solution en y ajoutant la notion de
l'amour mutuel. Meilleurs cadeaux pour vos proches Meilleurs cadeaux pour vos proches
Avant de se lancer dans la relation avec les autres, l'homme vit d'abord seul, il vit dans la solitude.
Selon Buber, cette solitude est meilleure puisqu'elle offre au partenaire solitaire l'opportunité de vivre
la vertu de la présence et de bien voir comment s'insérer dans la relation. C'est en vivant de cette vertu
que l'homme se trouve relié aux autres êtres.
Buber considère la solitude selon plusieurs plans, en l'occurrence, la solitude de l'homme abandonné
à lui-même et la solitude de l'homme qui a abandonné les autres êtres. La solitude de l'individu qui a
été abandonné a un nom : la déréliction. L'être en déréliction est diffèrent de l'être qui a abandonné
les autres êtres. C'est au contraire, l'être à la recherche de l'autre, c'est l'être finalement accueilli par
Dieu.
A part la solitude de l'être abandonné à lui-même, il existe une autre : celle de l'individu qui a
abandonné les autres pour vivre dans l'isolement en s'enfermant dans une sorte de forteresse. Cette
solitude, selon Buber, est la véritable déchéance de l'esprit. En effet, l'individu ne peut se suffire à lui-
même. Il a besoin de s'ouvrir aux autres. C'est ce qui amène Buber à parler de la solidarité humaine.
I.6. Conclusion partielle
Ce premier chapitre reposant sur l'historique du concept de la relation démontre l'importance majeure
de l'existence de l'être humain en face de ses semblables. Buber n'a pas développé de manière
imprudente cette philosophie de la relation. Il a mis en place quelques aspects importants qui évoquent

l'existence d'une vraie relation. Il s'agit de la réciprocité, de la présence, de la totalité et de la
responsabilité qui touche de façonparticulière, l'aspect moral de l'homme. En se mettant en relation
avec son prochain, l'homme accepte ce dernier tel qu'il est.
CHAPITRE DEUXIEME
LA PHILOSOPHIE BUBERIENNE DE L'INTERSUBJECTIVITE
II.0. Introduction partielle
Apres avoir vu l'historique du concept de la relation, nous voulons, dans ce deuxième chapitre, faire
voir comment la relation intersubjective est observée comme accomplissement de soi. Ce qui
implique que la relation d'un être humain a d'autres êtres humains n'est pas occasionnelle mais
constitutive de son humanité. L'être humain est conscient du bien et du mal, libre et responsable de
ses actes aux yeux de ses semblables avec lesquels il interagit.
En effet, Parler d'intersubjectivité selon Buber revient à signifier que l'expérience humaine n'est pas
celle d'un être isolé, coupé du monde et des autres, mais celle d'un être en rapport avec les autres
êtres. Ce rapport à l'autre détermine l'être qui, de par sa nature, est un être de relation.
Où que nous nous trouvions, dans la société, dans nos milieux respectifs, notre expérience de chaque
jours nous fait voir que `être homme' veut dire `exister et vivre avec les autres'. En d'autres termes
regarder l'autre et être vu par lui.
Ainsi, dans ce présent chapitre, en premier lieu, nous traiterons de la relation avec la nature, où nous
verrons que la relation y est de manière obscure et non explicite. En deuxième lieu, nous verrons
l'intersubjectivité dans la pensée bubérienne ; troisièmement il sera question de la vie avec les
hommes, et quatrièmement la considération interpersonnelle.
II.1. La relation avec la nature
La relation ici manifeste un caractère obscurément réciproque et n'arrive pas à accéder au
langage. C'est un niveau des flèches allées sans flèches retour et l'homme a, dans cette sphère la
difficulté d'employer le mot-principe Je-Tu à cause du caractère moins rationnel des êtres qu'il
y rencontre. Toutefois dans cette relation, les créatures nous font agir, mais trouvent
l'impossibilité de venir jusqu'à nous. C'est alors un monde du Cela dont aucun homme ne peut
se passer et avec lequel il ne peut vivre sans l'autre monde, celui du Cela. Buber dira à propos
de cette sphère que
« La relation y vibre dans l'obscurité sans atteindre le seuil du langage. Les créatures se
déplacent en notre présence, mais elles ne peuvent venir jusqu'à nous et le Tu que nous leur
adressons bute au seuil du langage »9(*).
Il est évident que le monde d'épanouissement du `Cela' (nature) n'est pas le nôtre et tout désir
de mettre ensemble place le Moi en maître agissant. Tout le reste ne prend son sens que par
rapport à lui. Ainsi, prétendre a un certain dialogue entre le `Je' et le `Tu' serait mener un
combat inégal où l'un a le fil de commandement et l'autre la soumission.
Dans l'optique bubérienne, le `Cela' (nature) ne favorise pas mon épanouissement. Il est cet
autre qui est distrait, qui attend le premier pas qui viendrait de moi. Le langage que le `Tu'
pourrait employer sur le champ de la rencontre entre le `lui' et le `cela' est encore une arme
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%