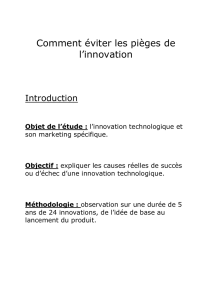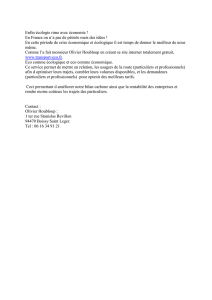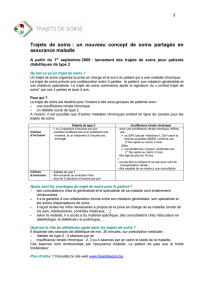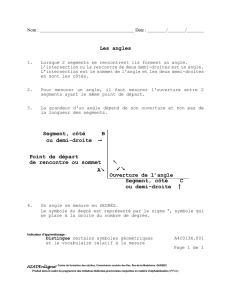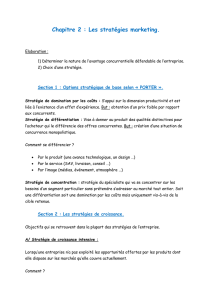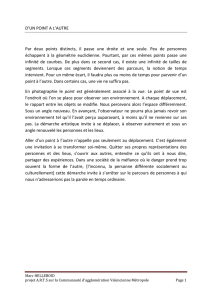Enfance
Le trajet au sol : une épreuve de structuration spatiale
Myriam Pradet, Maria De Agostini, René Zazzo
Abstract
There is a plurality of spaces, constructed and organized progressively during infancy. The different tests which permit the
assessment of space do not attain the same spatial reality, a reality that elsewhere can not be demonstrated independently of
the mode of expression demanded by the test. The route-finding test presented in this article, consists of reproducing, moving
from one point to another (point = round target fixed on the floor), the route represented graphicaly. The route-finding test is a
new way, for the clinician, to explore the spatial abilities seldom studied.
Résumé
Il existe une pluralité d'espaces construits et organisés progressivement au cours de l'enfance. Les divers tests qui permettent
d'appréhender l'espace n'atteignent pas tous la même réalité spatiale, réalité qui, par ailleurs, ne peut pas se manifester
indépendamment des moyens d'expression sollicités par le test. L'épreuve du trajet au sol, présentée dans l'article, consiste à
reproduire, en se déplaçant d'un point à l'autre (point = rond fixé au sol), un parcours représenté graphiquement. Le test du
trajet au sol est un nouveau moyen à la disposition du clinicien pour explorer des capacités spatiales peu étudiées.
Citer ce document / Cite this document :
Pradet Myriam, De Agostini Maria, Zazzo René. Le trajet au sol : une épreuve de structuration spatiale. In: Enfance, tome 35,
n°1-2, 1982. Stratégies de l'enfant et activités finalisées. pp. 61-74;
doi : https://doi.org/10.3406/enfan.1982.2773
https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1982_num_35_1_2773
Fichier pdf généré le 10/05/2018

ENFANCE.
N°
1-2-1982,
page
61
à
74
Le
trajet
au
sol
Une
épreuve
de
structuration
spatiale
par
Myriam
PRADET?
Maria
DE
AGOSTINI?*
René
ZAZZO***
Le
psychologue
clinicien
dispose
déjà
de
nombreuses
épreuves
pour
l'évaluation
des
capacités
d'organisation
ou
de
structuration
spatiale.
Alors
pourquoi
une
épreuve
de
plus
:
celle
que
nous
présentons
ici
sous
le
nom
de
trajet
au
sol
(traduction
libre
du
terme
anglais
route-finding)
.
Il
faut
d'abord
dire
qu'il
en
est
de
l'espace
comme
de
toutes
les
notions
générales
(temps,
intelligence,
socialisation,
par
exemple)
que
la
science
psychologique
tend
à
définir,
et
que
le
psychologue
clinicien
utilise
dans
l'état
actuel
de
nos
connaissances
et
de
nos
techniques.
Le
mot
désignant
cette
notion
recouvre
en
fait
des
réalités
fort
diverses
plus
ou
moins
bien
connues
et
certaines
probablement
ignorées.
L'espace
à
trois
dimensions
dans
lequel
nous
percevons
les
objets
et
organisons
les
directions,
dans
lequel
nous
nous
déplaçons
et
nous
agissons
est
un
autre
espace
que
celui
de
notre
corps
propre,
même
s'ils
procèdent
tous
deux
d'une
genèse
commune.
L'espace
à deux
dimensions,
notamment
celui
de
la
feuille
de
papier
sur
laquelle
l'enfant
va
apprendre
à
dessiner
et
à
écrire,
est
encore
autre
chose
:
espace
sans
volume,
il
est
le
résultat
d'une
abstraction,
il
suppose
toujours
plus
ou
moins
une
capacité
de
représentation,
de
symbolisation.
Il
est
sans
doute
propre
à
notre
espèce
alors
que
l'espace
de
perception
et
d'action
appartient,
sous
des
modalités
variables,
à
toutes
les
espèces
animales.
S'agissant
de
cet
espace
à
trois
dimensions
d'autres
distinctions
seraient
encore
à
faire.
Nous
savons
que,
depuis
une
bonne
dizaine
d'années,
les
psycho-physiologistes
(notamment
Jacques
PAILLARD,
en
France)
ont
été
amenés
à
distinguer
l'espace
des
lieux
(directionnel)
et
l'espace
des
objets,
dualité
d'espaces
que
l'animal
construit
par
ses
activités
au
cours
de
la
prime
enfance,
en
même
temps
qu'il
organise
l'espace
proprioceptif
du
corps
propre
(1).
Ce
que
l'expérimentation
comportementaliste
a
mis
en
évidence
est
vérifié,
d'une
certaine
façon,
par
la
physiologie
du
système
nerveux
:
deux
systèmes
cérébraux
correspondraient
à
ces
deux
espaces
spatio-perceptifs.
En
conséquence
de
quoi
d'ailleurs
la
notion
confuse
de
schéma
corporel
a
éclaté
:
elle
confondait
sous
une
même
expression
qui
a
séduit
les
cliniciens
pendant
un
demi
siècle
*
Université
de
haute-Bretagne.
Rennes
II.
**
Unité
de
recherches
neurolinguistiques
de
TI.N
S.E.R.M.,
E.R.A.
du
C.N.R.S.
(directeur
H.
•
HECAEN).
2
ter.
rue
d'Alésia.
75014
Paris.
***
Université
de
Paris
Xe
Nanterre.
(1
)
J.
PAILLARD
«
Le
traitement
des
informations
spatiales
»
in
De
l'espace
corporel
à
l'espace
écologique,
Paris,
P.U.F.,
1974
(pp.
7-88).

-
62
-
l'expérience
proprioceptive
et
kinesthésique
avec
la
représentation
imagée
du
corps.
C'est-
à-dire
l'expérience
du
corps
propre,
une
capacité
de
représentation
(particulière
à
notre
espèce)
et
les
fantasmes
qui
peuvent
l'accompagner
(2).
Une
fois
reconnue
la
pluralité
des
espaces
construits
et
organisés
progressivement
au
cours
de
l'enfance,
il
faut
aussi
considérer
qu'une
même
capacité,
relative
à
un
même
type
d'espace,
peut
s'exprimer
plus
ou
moins
bien
selon
les
moyens
d'expression
dont
le
sujet
dispose
et
qui
sont
sollicités
par
le
test
auquel
il
est
soumis.
Il
n'est
pas
imaginable
qu'une
épreuve
puisse
explorer
l'espace,
purement
et
simplement,
sans
la
médiation
d'un
moyen
d'expression,
graphique
ou
verbal
par
exemple.
En
d'autres
termes,
ceux
de
l'analyse
factorielle,
il
n'y
a
pas
d'épreuve,
il
n'y
a
pas
d'activité,
définie
exclusivement
par
un
facteur
spatial,
d'autres
facteurs
interviennent
inévitablement
(et
cela
est
probablement
vrai
pour
n'importe
quelle
autre
réalité
psychologique,
l'intelligence
par
exemple).
En
conséquence
de
quoi
pour
tout
examen
individuel,
lorsqu'un
déficit
est
mis
en
évidence
par
un
test
de
structuration
spatiale,
le
clinicien
doit
savoir,
non
seulement
quel
type
de
structuration
spatiale
il
a
éprouvé,
mais
aussi
si
le
déficit
est
bien
relatif
à
la
capacité
spatiale
en
question
ou
s'il
est
dû
au
moyen
d'expression
que
le
test
met
en
oeuvre
:
difficulté
ou
refus
de
l'expression
graphique
par
exemple,
ou
bien
encore
généralisation
d'une
conduite
d'échec
dans
une
situation
qui
lui
fait
référence.
D'où
l'intérêt
de
pouvoir
disposer
de
différentes
épreuves.
Le
test
du
trajet
au
sol
sera
donc
un
moyen
supplémentaire
et
original,
parce
que
non
redondant,
à
la
disposition
du
clinicien.
Dans
cette
épreuve
le
sujet
doit
traduire
sur
le
sol,
par
son
déplacement
de
point
en
point,
les
trajets
représentés
graphiquement
sur
un
modèle.
De
ce
fait,
cette
épreuve
se
situe
à
deux
niveaux
;
elle
requiert,
après
lecture
d'un
modèle
dans
un
espace
graphique,
donc
à
deux
dimensions,
le
passage,
par
l'utilisation
du
corps,
à
un
espace
d'action
à
trois
dimensions.
La
lecture
d'un
plan
se
retrouve
en
d'autres
épreuves
spatiales
mais
la
reproduction
demandée
au
sujet
est
généralement
graphique.
Par
contre
l'utilisation
d'un
espace
à
trois
dimensions
pour
une
épreuve
spatiale
est
peu
fréquente.
L'épreuve
d'imitation
de
gestes
de
BERGES
et
LEZINE
(3)
offre,
entre
autres,
cette
particularité,
mais
à
la
différence
du
test
du
trajet
au
sol,
le
modèle
se
situe
dans
le
même
espace
que
la
reproduction
effectuée
par
le
sujet.
Dans
la
nouvelle
épreuve
que
nous
présentons,
à
l'obligation
de
traduire
des
données
planes
par
une
réalisation
agie
dans
l'espace,
s'ajoute
une
difficulté
supplémentaire
:
il
ne
reste
aucune
trace
visible
du
trajet
au
sol
parcouru
par
l'enfant,
l'effort
de
représentation
ou
la
nécessité
de
prendre
des
points
de
repère
s'en
trouve
donc
encore
accru.
La
réussite
à
cette
épreuve
s'avère
alors
difficile
en
l'absence
d'une
élaboration
spatiale
suffisante
;
autrement
dit
le
recours
à
certaines
stratégies
d'ordre
mnémonique
ou
logique
ne
peut
pas.
comme
cela
semble
être
le
cas
dans
certaines
épreuves,
compenser
ou
masquer
des
difficultés
spatiales.
(2)
Sur
l'histoire
de
la
notion
du
schéma
corporel,
aujourd'hui
abandonnée,
mais
qui
exerce
encore
cependant
un
«
véritable
charme
magique
»
cf.
les
textes
originels
relatifs
à
cette
notion
que
J.
CORRAZE
a
réunis
et
présentés
sous
le
titre
Schéma
corporel
et
image
du
corps,
Toulouse,
E.
Privât,
1973.
(3)
BERGES
J.
et
LEZINE
I.
(1962)
Test
d'imitation
de
gestes,
Masson,
Paris.

-
63
-
EPREUVE
AU
SOL
L'orientation
spatiale,
chez
des
enfants
atteints
de
lésions
corticales
précoces,
a
été
explorée
par
RUDEL
et
al.
(4)
à
l'aide
d'un
test
d'exécution
de
trajets
au
sol.
La
tâche
consistait
à
se
déplacer
selon
un
parcours
représenté
en
diagramme
sur
un
carton,
remis
à
l'enfant.
RUDEL
et
al.
(1
)
ont
constaté
que,
à
cette
épreuve,
les
performances
des
sujets
avec
lésion
de
l'hémisphère
droit
étaient
inférieures
non
seulement
à
celles
des
sujets
sans
aucune
atteinte
(groupe
contrôle)
mais
aussi
à
celle
des
sujets
présentant
une
lésion
gauche.
Le
rôle
prépondérant
joué
par
l'hémisphère
droit
dans
l'exécution
de
tâches
spatiales
a
été
à
maintes
reprises
constaté
lors
d'études
conduites
auprès
de
sujets
adultes,
avec
lésions
corticales
(H.
HECAEN
et
al.
(5).
Cependant
une
étude
de
SEMMES
et
al.
(6)
utilisant
cette
même
épreuve
d'exécution
d'itinéraires
n'avait
pas
abouti
à
différencier,
chez
des
sujets
adultes,
les
lésés
hémisphériques
droits
des
gauches.
Leurs
résultats
relèvent
probablement,
d'une
part
de
l'étiologie
d'origine
traumatique
des
sujets
(le
groupe
était
formé
par
des
blessés
de
guerre
et
dans
ce
cas
malgré
des
signes
apparents
de
lésion
unilatérale,
la
fréquence
des
lésions
bilatérales
est
très
élevée)
et,
d'autre
part,
de
la
stratégie
verbale
induite
par
la
consigne.
En
effet,
l'examinateur
prévenait
les
sujets
qu'ils
étaient
face
au
nord,
et
le
nord
était
indiqué
sur
un
des
côtés
du
plan.
La
plupart
des
sujets
ont
exécuté
la
tâche
à
l'aide
de
repères
verbaux
tels
que
:
«
Je
dois
aller
maintenant
au
cercle
qui
est
au
sud-ouest,
nord,
centre-
sud,
etc.
»
Cette
approche
aurait
donc
permis
aux
sujets
atteints
de
lésion
droite
de
compenser
une
désorganisation
spatiale
éventuelle
et
de
résoudre
la
tâche
au
moyen
d'une
stratégie
verbale.
Nous
avons
repris
ce
test
de
trajets
et
élargi
l'épreuve
initiale
de
SEMMES
et
al.
en
y
ajoutant
une
partie
adaptée
aux
enfants
les
plus
jeunes.
Cette
nouvelle
partie
(10
trajets)
permet
à
l'enfant
d'affronter
graduellement,
par
cette
tâche
de
locomotion
dans
l'espace
extra-corporel,
l'orientation
orthogonale
vers
la
droite
ou
vers
la
gauche,
puis
les
diagonales.
L'exécution
d'un
trajet
nécessite
de
relier
soit
quelques
points,
soit
l'ensemble
des
neuf
points
posés
au
sol.
METHODE
Description
du
test
La
description
et
'^
procédure
sont
les
mêmes
pour
les
deux
parties
du
test.
Les
trajets
sont
tracés
sur
des
cartons
blancs
de
21
x
21
cm.
Des
traits
noirs
relient
entre
eux,
certains
des
9
points
présents
sur
ces
cartons
et
indiquent
le
chemin
à
parcourir.
Ces
traits
sont
en
nombre
variable
d'un
carton
à
l'autre.
Le
point
de
départ
est
signalé
par
un
petit
cercle
et
celui
d'arrivée
par
une
flèche.
9
cercles
de
7
cm
de
diamètre,
en
carton
blanc,
correspondant
aux
points
du
diagramme
sont
posés
sur
le
sol
d'une
pièce,
à
un
mètre
de
distance
les
uns
des
autres.
On
remet
au
sujet,
placé
devant
les
points
au
sol,
un
diagramme
à
la
fois,
dans
la
bonne
orientation.
Le
sujet
est
prévenu
que
les
points
dans
la
partie
supérieure
du
carton
(4)
RUDEL,
R.G.,
TEUBER,
H.L.
and
TWITCHELL.
T.E.
(1974):
Levels
of
impairment
of
sensori-motor
functions
in
children
with
early
brain
damage.
Neuropsychologia,
12,
95-108.
(5)
HECAEN,
H.
and
ALBERT,
M.
(1978)
:
Human
Neuropsychology.
J.
Wiley
and
Sons.
New
York.
(6)
SEMMES,
J.,
WEINSTEIN,
S.,
GHENT,
L.
and
TEUBER,
H.L.
(1963):
correlates
of
impaired
orientation
in
personal
and
extrapersonal
space.
Brain,
86,
747-772.

-
64
-
correspondent
aux
3
points
au
sol,
les
plus
éloignés
de
lui.
L'enfant,
avant
d'effectuer
le
trajet,
montre
à
l'examinateur
le
point
de
départ
au
sol.
S'il
n'a
pas
compris
la
correspondance
entre
les
points
sur
le
plan
et
les
points
au
sol,
la
consigne
est
réexpliquée.
Première
partie
du
test
:
Série
A.
Les
diagrammes
des
10
trajets
à
exécuter
dans
cette
partie
du
test
sont
représentés
ci-dessous.
Deuxième
partie
du
test
:
Série
B
Ces
trajets
(d'après
SEMMES
et
al.)
sont
présentés
à
l'enfant
avec
un
nombre
croissant
de
segments
(7).
Chacun
des
5
trajets
(n°
1-3-5-7-9)
est
présenté
sous
deux
orientations
différentes.
LES
TRAJETS
AU
SOL
:
Série
A
A
:
n
LES
TRAJETS
AU
SOL
:
Série
B
V.
10
\
\
K\
6
7 8
9
10
Traitement
des
données
L'analyse
des
résultats
de
RUDEL
et
al.
portait
sur
le
nombre
de
segments
exacts
accomplis
par
les
sujets.
Or,
cette
cotation
ne
peut
pas
rendre
compte
des
éventuels
segments
supplémentaires
(un
enfant
qui
se
tromperait
de
direction
et
qui
reprendrait
ensuite
le
bon
parcours)
ni
des
trajets
où
la
présence
d'une
seule
erreur
d'orientation
à
un
moment
donné
pénaliserait
trop
lourdement
le
sujet.
(7)
Un
segment
étant
une
partie
de
trajet
délimitée
par
deux
points.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%