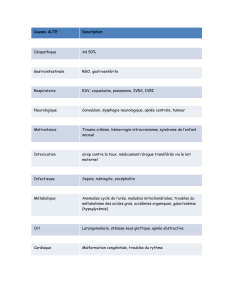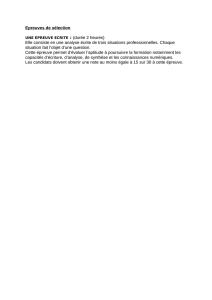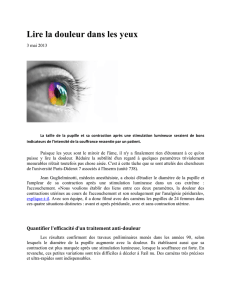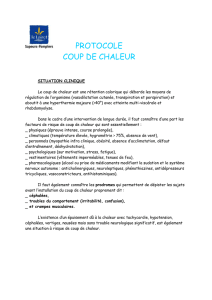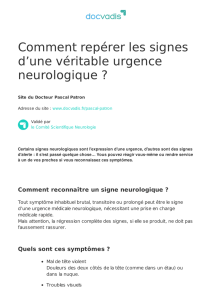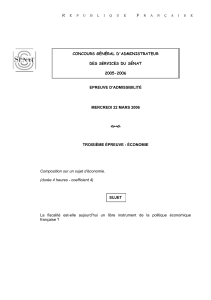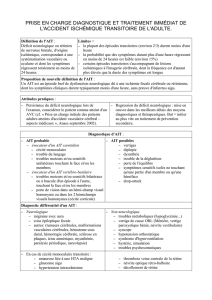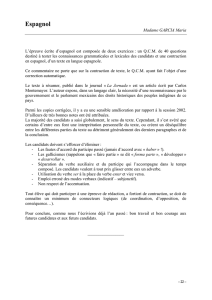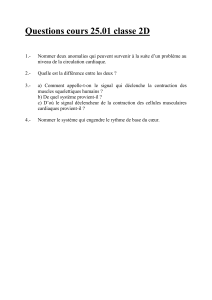Examen neurologique : Anamnèse et examen physique - Cours INSSA
Telechargé par
Taryam

1 sur10
EXAMEN NEUROLOGIQUE
Dr A.A. SAVADOGO L2_Méd INSSA Mars 2025
OBJECTIFS
1) Décrire l’interrogatoire du patient atteint d’une affection neurologique
2) Citer les 10 étapes de l’examen neurologique
3) Décrire chaque étape de l’examen neurologique
PLAN
Introduction
Examen clinique
Interrogatoire
Examen physique
Examen état général
Système nerveux
Examens de autres appareils et systèmes
I. INTRODUCTION
L’observation médicale en neurologie présente certaines particularités qu’il
est important de souligner. L’interrogatoire constitue un temps essentiel de cette
observation et doit être mené avec soin. L’examen clinique doit toujours être réalisé
de façon systématique selon un ordre bien établi. Au décours de l’observation, le
raisonnement neurologique passe par différentes étapes : regroupement
syndromique, éventuellement discussion topographique, puis discussion des
étiologies. Il faut souvent l’adapter en fonction du patient de la plainte et des
circonstances (en cas d’urgence par exemple).
Il ne faut évidemment pas se limiter qu’au système nerveux et examiner les
autres appareils et systèmes.
II. INTERROGATOIRE
L’interrogatoire est la partie la plus importante. Le recueil minutieux du motif
de consultation ou d’hospitalisation, de l’histoire de la maladie et des antécédents
peuvent suffire dans certains cas pour obtenir le bon diagnostic.
Il est en général mené directement auprès du patient lui-même. Mais lorsque ce
dernier est inconscient, dément, aphasique ou non-coopérant, les informations
dépendront des membres de la famille ou d’autres personnes.

2 sur10
1. Etat civil
* Nom
* Âge
* Sexe
* Adresse
* Ethnie
* Religion
* Statut marital
* Profession
* Latéralité (ou préférence manuelle) +++
- Droite
- Gauche
- Ambidextre
2. Motifs de consultation ou d’hospitalisation
* Troubles de la marche
* Déficit moteur
* Troubles sensitifs (douleurs, paresthésies)
* Crises convulsives
* Troubles du comportement
* Altération de la vigilance
* Mouvements anormaux
* Troubles du langage
* Céphalées
* Détérioration intellectuelle
* Troubles du sommeil
* Etc.
3. Histoire de la maladie
L’anamnèse consiste habituellement à identifier la plainte principale, aussi
précisément que possible. Exemple : confusion fréquente entre trouble de la
sensibilité et engourdissement d’un membre.
Il faut préciser, quel que soit le type de plainte les informations suivantes
doivent être précisées :
La date d’apparition
Le mode d’installation : brutal, progressif, rapidement progressif…
Evolution dans le temps : continue, intermittente, stabilisation ou aggravation
Les facteurs d’aggravation ou d’amélioration
Le contexte (fièvre, altération de l’état général…)
Les symptômes associés
Les traitements et investigations antérieurs
L’impact sur la qualité de vie
4. Antécédents
a. Personnels
Médicaux
Terrain : facteurs de risque cardio-vasculaires (HTA, Diabète,
dyslipidémies…) goutte, drépanocytose
Pathologie connue : accidents vasculaire cérébral, épilepsie, cardiopathies
Médicaments : anti-hypertenseurs, anticoagulants, antidépresseurs,
neuroleptiques…
Chirurgicaux :
Cancers, traumatisme cranio-encéphalique récent, intervention chirurgicale
Gynéco-obstétricaux :

3 sur10
Contraceptifs oraux,
Avortements à répétitions ou morts in utero
b. Familiaux et héréditaires
Rechercher de facteurs de risque de maladies neurologiques chez les
parents :
- Ascendants
- Collatéraux
- Les descendants
Maladies héréditaires et réalisation de l’arbre généalogique du patient au
besoin
Rechercher une consanguinité
c. Habitudes et mode de vie :
Cadre de vie et situation sociale, profession,
Sédentarité ou pratique régulière du sport.
La prise ou non d'alcool, de café, de thé et de tabac en précisant la quantité.
Rechercher une notion d’exposition à des toxiques chimiques (agriculture,
industrie…),
Consommation de substances psychoactives (cannabis, cocaïne).
III. EXAMEN PHYSIQUE
1. ÉTAT GENERAL
Appréciation générale : bon, mauvais
Pli cutanée de déshydration, OMI, état des muqueuses, hippocratisme digital
Réserver l’examen de la conscience pour l’examen neurologique
Paramètres vitaux
Tension artérielle, pouls, fréquence respiratoire, Fréquence cardiaque,
température, SpO2 (1)
Mensurations
Poids, taille, périmètre ombilical
IMC = poids/taille2
2. EXAMEN NEUROLOGIQUE
Il est comparatif (droite/gauche) partout où cela est possible
(1) SpO2 = saturation pulsée en
oxygène

4 sur10
Matériel de l’examen neurologique
Marteau à reflexe
Aiguille
Tubes à eau chaude &
froide ou testeur
sensoriel (GIMA)
Lampe de poche
Diapason de 128 Hz
Coton hydrophile
Abaisse-langue
Ophtalmoscope (2)
Il comprend 10 étapes :
1. Les fonctions supérieures
2. La motricité
3. Le tonus
4. Les réflexes
5. La coordination
6. La trophicité
7. La sensibilité
8. Les nerfs crâniens
9. Les méninges
10. Le système neurovégétatif
2.1. Les fonctions supérieures
On désigne par fonctions supérieures :
La vigilance ou éveil cortical (≈ conscience)
Les fonctions exécutives et l'attention
Les fonctions instrumentales
Le langage (expression et compréhension)
La praxie (gestes)
La gnosie
Le calcul
La mémoire (immédiate, à long terme)
La vigilance ou conscience
Le patient est-il éveillé ? exécute-t-il les ordres simples (lever la main) ou non ?
Ou alors utiliser l’échelle de Glasgow (confère annexe)
Les fonctions exécutives et l'attention
L’orientation (3) : existe-t-il chez le patient une désorientation temporo-spatiale ?
(2) L’examen ophtalmoscopique
du fond d’œil est en réalité la
11e étape de l’examen
neurologique. Mais il est
actuellement sous-utilisé en
neurologie
(3) L’orientation est explorée
en examinant le rapport du
patient :

5 sur10
Epreuve paume-tranche-poing (4)
Résolution de problèmes
L’attention est évaluée en utilisant un « span » digital (5) ou par des tests
psychométriques
Mémoire
Mémoire immédiate
Demander au patient de répéter sans délai une série de chiffres ou de consonnes
Mémoire à long terme
Rappel des faits anciens autobiographiques et de la vie sociale
Langage (= phasies)
On étudiera l’expression et la compréhension orales mais aussi l’expression et la
compréhension écrites
Exemples de troubles du langage : l’aphasie de Broca et l’aphasie de Wernicke
Les praxies
On étudie ici les activités gestuelles
Les troubles de l’activité gestuelle : les apraxies (6)
Les gnosies
C’est la connaissance par la perception de notre corps en tant qu’espace défini,
de l’espace extracorporel et des objets
Exemple 1 : hémiasomatognosie, trouble dans lequel le patient refuse de reconnaitre
comme sien l’hémicorps paralysée
Exemple 2 : l’astéréognosie désigne l’incapacité d’identifier un objet par la palpation
le patient ayant les yeux fermés
Le calcul
Par exemple demander au patient de soustraire de 7 en 7 à partir de 100
2.2. La motricité
La station debout et la marche en ligne droite est très informative :
Démarche spastique de l’hémiplégique
Démarche labyrinthique
Démarche du myopathe
Démarche ébrieuse
Evaluation globale de la force musculaire (7)
Membres thoraciques : Manœuvre de Barré ou épreuve de bras tendus
Membres pelviens : Manœuvres de Barré et Mingazzini
Il convient d'attendre 10 secondes avant de conclure quant à l'absence de déficit,
lors de ces manœuvres
Un déficit moteur est mis en évidence lorsque le ou les membre(s) déficitaire(s)
chute(nt) lentement.
- Au temps (demander au
patient de nommer le jour, la
date, le mois ? la saison,
l’heure)
- A l’espace (nom du lieu
où il est, de l’hôpital, de la
ville)
- A sa propre personne et
aux autres (Son nom,
profession, domicile, sa
famille)
(4) Epreuve paume-tranche-
poing ou séquences
motrices de
Luria : l'examinateur
montre au malade une
séquence gestuelle
consistant à plaquer la
paume de la main sur la
table, puis la tranche et enfin
le poing. Le malade est
invité à la reproduire
(5) Annoncez au patient que
vous souhaitez qu’il répète
quelques chiffres que vous
allez lui donner.
Commencez avec trois ou
quatre chiffres et augmentez
jusqu’à ce que le patient
fasse plusieurs erreurs pour
un nombre donné de
chiffres.
Ensuite expliquez-lui que
vous souhaitez qu’il répète
les nombres à l’envers – par
exemple :
« Quand je dis un, deux,
trois, vous dites trois, deux,
un. »
Notez le nombre de chiffres
dont le patient est capable
de se souvenir à l’endroit et
à l’envers.
Normalement : sept en sept
avant, cinq en arrière.
(6) L’apraxie est un trouble de
la réalisation des
mouvements appris, non
expliqué par un déficit
neurologique élémentaire
(7) Manœuvre de
Mingazzini : le patient est
en décubitus dorsal, cuisses
à la verticale, jambes à
l'horizontale. Manœuvre de
barré : aux membres
pelviens, Le patient est en
décubitus ventral, jambes à
la verticale. Aux membres
thoraciques, il est assis ou
couché les bras tendus
perpendiculairement au
thorax.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%