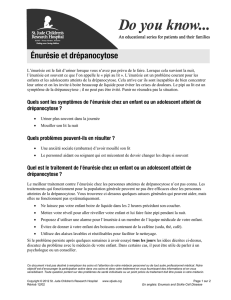Drépanocytose : Accompagnement infirmier au long cours
Telechargé par
Abdoulhakim Ousmane

Classification: Public
Dochead Dossier
Sous-dochead Parcours patient et drépanocytose
Accompagnement infirmier au long cours du patient drépanocytaire adulte
Vanessa Vasseur*
Infirmière
Céline Barbin
Infirmière
Hôpital de jour de médecine interne, hôpital Tenon, 4 rue de la Chine, 75020 Paris, France
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : vanessvasseur@hotmail.fr (V. Vasseur).
Résumé
Maladie génétique et chronique, la drépanocytose nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Celle-ci
demande un investissement tant de la part du patient que de l’ensemble de l’équipe soignante. Dans la
plupart des cas, le malade drépanocytaire est diagnostiqué environ deux mois après la naissance. Le parcours
de soins de l’adulte s’inscrit dans la continuité du travail effectué en pédiatrie. La chronicité de la pathologie
engendre des venues régulières à l’hôpital qui impactent la vie personnelle et professionnelle des patients.
Un accompagnement infirmier adapté permet d’améliorer leur quotidien.
© 2021
Mots clés – confiance ; connaissance ; drépanocytose ; maladie chronique ; soin infirmier
Summary à traduire
© 2021
Keywords à traduire et à mettre en ordre alphabétique
Après une période de transition entre l’hôpital pédiatrique et l’hôpital adulte, le patient drépanocytaire est
amené à devenir plus autonome et acteur de sa maladie. L’infirmier occupe une place essentielle dans la
réussite de ces objectifs.
Son rôle est en effet central dans l’accompagnement de l’adulte drépanocytaire. Ses interventions ciblent
différents domaines : les soins préventifs et curatifs, l’éducation thérapeutique et les conseils éducatifs, la
relation de confiance avec les soignants, la connaissance de la pathologie et de la composante culturelle.
C’est en prenant en compte ces différents aspects que s’organise un accompagnement au long cours du
patient efficace.
T1 Rôle infirmier dans les soins préventifs et curatifs
Les soins majoritairement retrouvés dans la prise en charge des patients sont l’antalgie (encadré 1), les
échanges transfusionnels (encadré 2), les saignées, les pansements (ulcères cutanés), les bilans sanguins. Ces
actes ont pour point commun d’être douloureux. Les infirmiers ont souvent, du fait de la prise en charge au
long cours et de la répétition des actes, une relation de proximité avec les soignés.
TEG1 Connus pour avoir des abords veineux difficiles, les patients drépanocytaires envisagent souvent
l’enjeu de la pose de perfusion comme un incontournable dans la relation entretenue avec les infirmiers qui
les prennent en charge. En effet, c’est la plupart du temps par ce biais que le patient est en partie soulagé
et/ou traité au long terme (saignées, transfusions).
TEG1 De plus, l’infirmier fait face à des patients chroniques, qui connaissent les modes d’expression de
leur maladie. Il convient, par conséquent, de prendre en compte leurs dires, mais aussi de démontrer une
expertise de pratique professionnelle ainsi qu’une aisance dans les soins.
TEG1 La connaissance de protocoles propres à la drépanocytose, l’évaluation systématique de la douleur
et le bon usage des antalgiques font ainsi partie intégrante des soins infirmiers courants.
T1 Éducation thérapeutique et conseils éducatifs
La prise en charge des patients drépanocytaires, comme pour toute personne atteinte d’une pathologie
chronique, passe notamment par de l’éducation thérapeutique. Bien qu’expérimentés, les malades ont besoin,
© 2021 published by Elsevier. This manuscript is made available under the Elsevier user license
https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/
Version of Record: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293850521003584
Manuscript_ed182543c2e0f60bc8c7c619f21a6545

Classification: Public
selon leur vécu et leur niveau de connaissances, d’explications claires et répétées. Que ce soit du simple
conseil (hydratation quotidienne suffisante, habillement adapté) aux ateliers d’éducation thérapeutique,
l’infirmier exerce un rôle central dans l’éducation du patient vis-à-vis de sa maladie.
TEG1 Cette démarche commence systématiquement par une évaluation des connaissances des
patients, puis par la mise en place d’actions appuyées tant que possible de supports visuels, notamment pour
les personnes qui ne maîtrisent pas parfaitement la lecture ou la langue.
De nombreux points peuvent ainsi être abordés :
• règles hygiéno-diététiques (hydratation, éviter les variations de températures trop importantes, gestion du
stress, repos) ;
• transmission génétique de la maladie ;
• suivi gynécologique lors des grossesses ;
• préconisations pour les voyages ;
• activités sportives ;
• gestion de la douleur et soins infirmiers à domicile ;
• prise du traitement.
TEG1 Qu’elle soit à la demande du malade ou à l’initiative de l’infirmier, l’éducation thérapeutique
est un soin à part entière pour le patient drépanocytaire. L’hôpital de jour (HDJ) est un service de soins
parfaitement adapté pour mener ces actions éducatives. La présence d’un soignant dédié à celles-ci est un
avantage considérable. L’échange entre patients lors des ateliers ou des groupes de parole est vécu comme
très positif ; ce partage d’expérience a un impact non négligeable dans la gestion quotidienne de leur
maladie.
T1 Relation de confiance
L’adulte drépanocytaire pris en charge depuis l’enfance est suivi par un médecin référent, par une équipe
soignante (médecins, psychologue, diététicien) et par divers intervenants qu’il connaît et reconnaît au cours
de ses différents passages à l’hôpital. L’infirmier, acteur central de ce schéma de soins, assure fréquemment
la liaison entre les membres de l’équipe soignante. Le besoin d’établir une relation privilégiée n’est pas
systématique, il est cependant très fréquent et rassurant pour le patient.
TEG1 La relation de confiance entre le malade et le soignant “référent” s’établit par une bonne
connaissance du dossier du patient, par une écoute bienveillante et par une la prise en charge dans la durée. Il
convient d’accepter les périodes de relâchement qui peuvent également arriver chez l’adulte. Il est alors
possible de s’appuyer sur cette relation de confiance pour remotiver un patient en rupture de suivi ou en refus
de soins.
TEG1 La transition entre les services de pédiatrie et ceux pour adultes s’avère être une période
charnière. Le soignant qui accueille un “jeune adulte” en unité de soins se doit de prendre en considération
la difficulté liée à la perte complète de repères (environnement, personnes, fonctionnement) que ce patient
peut éprouver. Une attention particulière s’impose à ce stade de la prise en charge.
T1 Connaissance de la pathologie et de la composante culturelle
La drépanocytose requiert des compétences professionnelles spécifiques à la pathologie, mais aussi des
connaissances étendues du fait de la possible atteinte multiviscérale. La drépanocytose est encore
relativement méconnue de la population et parfois même de certains soignants, ce qui augmente chez les
patients le besoin d’une prise en charge singulière.
À cela s’ajoute la nécessité d’une ouverture à la diversité culturelle des malades pour proposer une prise en
soins adaptée. Il convient par ailleurs de respecter les croyances et les coutumes des patients – notamment
quant à leur douleur, à leur refus de certains soins ou traitements (saignées, transfusion, etc.) – tout en
appliquant le principe de laïcité au sein de l’hôpital.
T1 Conclusion
En tant qu’infirmier, accompagner au long cours un patient drépanocytaire adulte requiert une expertise et
des compétences professionnelles adaptées, tant sur les plans technique que relationnel
1
. Accepter les
périodes de “relâchement” des patients fait partie intégrante de cet accompagnement. La drépanocytose est
une maladie chronique complexe qui s’exprime différemment selon les individus (crise douloureuse,
priapisme, atteinte ophtalmique, rénale, etc.), la bonne connaissance de cette pathologie participe à instaurer
un climat de confiance capital à une prise en charge durable.

Classification: Public
Déclaration de liens d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
Remerciements
Remerciements à Jacqueline Faure, psychologue et infirmière de formation initiale, pour sa contribution dans
la rédaction des situations cliniques décrites.
Note
1
Plusieurs universités proposent des diplômes universitaires sur la drépanocytose. Le centre de la
drépanocytose de l’hôpital Tenon (AP-HP, Paris, 20
e
) organise chaque année, en mars, une journée
paramédicale de formation gratuite dédiée à la drépanocytose.
Pour en savoir plus
Dzierynski N, Stankovic K, Georgin-Lavialle S, Lionnet F. Enjeux et difficultés de la relation entre soignants
et patients drépanocytaires au cours de la crise douloureuse aiguë. Rev Med Interne 2016;37(2):111-6.
Habibi A, Arlet JB, Stankovic K, et al. Recommandations françaises de prise en charge de la drépanocytose
de l’adulte : actualisation 2015. Rev Med Interne 2015;36(5 Suppl 1):5S3-84.
Haute Autorité de santé. Guide – Affection de longue durée. Syndromes drépanocytaires majeurs de l’adulte.
Protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare. Janvier 2010. www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-04/ald_10_guide_drepano_adulte_web.pdf.
Encadré 1. Crise vaso-occlusive et soins infirmiers
Alors que M. B., âgé de 35 ans, est au travail, une crise douloureuse au niveau de son bassin se déclenche.
Ce patient est atteint d’une forme sévère de drépanocytose, il a déjà fait un séjour en réanimation par le
passé. Il connaît bien sa pathologie et la conduite à tenir. Malgré les antalgiques de palier 2 (paracétamol
codéiné en alternance avec le néfopam), la douleur est si intense qu’il doit être transporté par les pompiers
aux urgences de l’hôpital.
TEG1 À son arrivée, bien qu’anxieux et algique, M. B. est rassuré d’être accueilli par une infirmière qu’il
connaît bien. Alors qu’il est réputé “difficile à piquer”, l’infirmière trouve tout de suite la bonne veine pour
le bilan sanguin spécifique à la drépanocytose et la pose d’une voie veineuse pour l’hydratation. Elle instaure
l’oxygénothérapie (la crise vaso-occlusive provoque le plus souvent un infarctus osseux, ici au bassin) et
surveille régulièrement la pression artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire, la saturation de
l’hémoglobine en oxygène et la température.
TEG1 Lors de la précédente crise, il y a trois semaines, la prise en charge aux urgences avait suffi et
M. B. était rentré à son domicile quelques heures plus tard. Cette fois, la douleur ne cesse pas et nécessite
l’administration de morphine (antalgique de palier 3) par voie veineuse, selon un protocole précis suivi par
l’infirmière : association de titrations et de bolus par analgésie autocontrôlée (patient controlled analgesia),
surveillance de l’efficacité en mesurant l’intensité douloureuse et de la tolérance (niveau d’éveil sur l’échelle
de sédation et fréquence respiratoire).
TEG1 Le patient est hospitalisé dans le service de référence, la surveillance des différents paramètres se
poursuit. M. B. présente alors une douleur thoracique et des difficultés respiratoires, signes qui évoquent un
syndrome thoracique aigu. Il craint d’être à nouveau transféré en réanimation. Une spirométrie incitative est
prescrite ainsi que de la kinésithérapie respiratoire. La situation clinique s’améliore.
TEG1 Après dix jours d’hospitalisation, le patient quitte l’établissement avec un arrêt maladie d’une
semaine.
Encadré 2. Échanges transfusionnels et soins infirmiers
Mme T., âgée de 25 ans, est atteinte d’une forme sévère de drépanocytose. Il y a deux ans, à la suite d’une
récidive de syndrome thoracique aigu avec séjour en réanimation, des échanges transfusionnels mensuels lui
ont été prescrits en hôpital de jour (HDJ).
TEG1 Ce jour-là, à son arrivée en HDJ, Mme T., bien connue du personnel soignant, est installée pour la
prise de ses paramètres vitaux. Comme de nombreux patients drépanocytaires, elle a subi régulièrement et
depuis des années des prises de sang, des poses de perfusion, etc. Son capital veineux s’en trouve fragilisé.

Classification: Public
Afin de faciliter la pose du garde veine (sérum physiologique), l’infirmière réchauffe les deux bras avec des
compresses chaudes et demande à la patiente de s’hydrater pour faciliter la saignée.
TEG1 Une fois le bilan sanguin envoyé en urgence, le médecin fait le point avec Mme T. sur les rendez-
vous d’imagerie médicale ou de consultations spécialisées, la questionne sur les faits marquants depuis son
dernier passage à l’HDJ et l’ausculte. Il prescrit ensuite le schéma de l’échange transfusionnel en fonction du
résultat d’hémoglobine (ce jour : 9,6 grammes par décilitre), de la tolérance et des antécédents médicaux de
la patiente.
TEG1 Sur prescription du médecin, l’infirmière procède alors à une première saignée de 400 millilitres
(mL) avec une poche à phlébotomie branchée au robinet de la tubulure, posée en déclive alors que le lit est
surélevé. Puis, elle transfuse le premier culot globulaire (CG). À la suite à ce premier échange, le cathéter se
bouche (le sang visqueux caractéristique de la drépanocytose crée souvent un dépôt de caillots dans le
cathéter et la tubulure, d’où la nécessité de s’hydrater pour faciliter l’évacuation du sang).
TEG1 L’infirmière doit alors reperfuser la patiente pour la deuxième saignée de 300 mL et la transfusion
du deuxième CG. Malgré le stress, Mme T. a toute confiance dans “son” infirmière et subit sans aucune
plainte cette nouvelle piqûre, car « elle a l’habitude ».
TEG1 Pendant les soins, Mme T. insiste auprès de l’infirmière pour obtenir un bulletin de présence à
l’hôpital et lui fait part des difficultés rencontrées auprès de son employeur pour justifier ses nombreuses
absences.
TEG1 L’échange transfusionnel a été bien toléré, malgré une sensation de fatigue en fin de journée.
Auscultée par le médecin et déperfusée, Mme T. repart avec les conseils de surveillance de l’infirmière et un
prochain rendez-vous dans quatre semaines.
1
/
4
100%
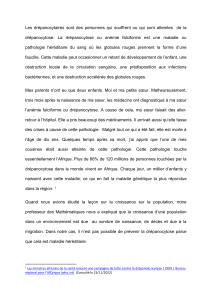



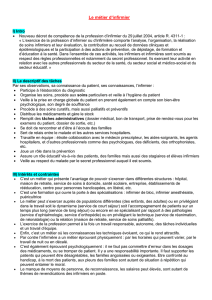
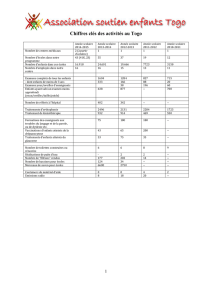
![Logo Myriade - Centre de réadaptation [ La Myriade ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000239065_1-aece08eeda3a23cd4cbfba00319bf79e-300x300.png)