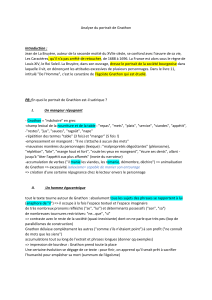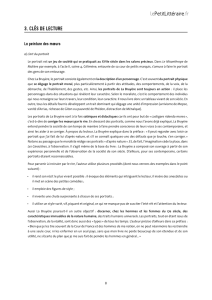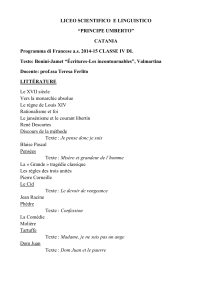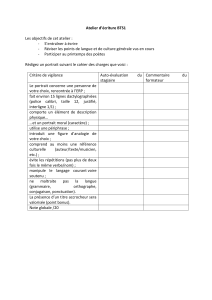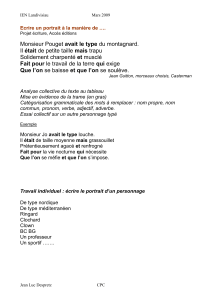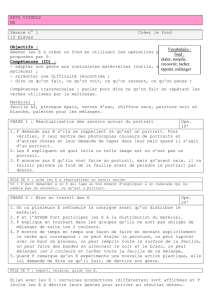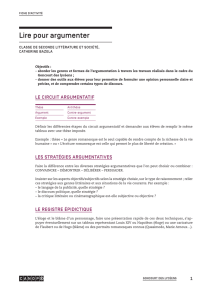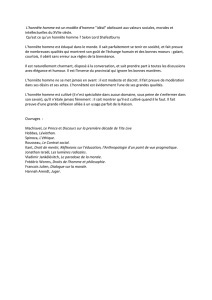Analyse linéaire Arrias - La Bruyère : L'honnête homme
Telechargé par
NOUR pipionkakionpipikakaland

Analyse linéaire Texte 1 : "Arrias" Jean de La Bruyère, Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,
1688-1694, « De la société et de la conversation »
INTRODUCTION
La Bruyère fait paraître, en 1688, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec Les Caractères
ou les Mœurs de ce siècle. Par l’ordre des termes dans ce titre, il s’affirme partisan des « Anciens » et
se donne ainsi une caution morale utile ; la centaine de pages traduites dissimule ses réflexions
personnelles, deux cents pages comptant quatre cent vingt remarques, essentiellement des maximes
générales, et une douzaine de portraits, deux genres à la mode dans les salons.
Mais l’ouvrage, divisé en seize « sections », a tellement de succès – notamment les portraits dont les
lecteurs cherchent la « clé » – que les rééditions se succèdent, dont la quatrième, en
1689, considérablement enrichie, la sixième en 1691, la première à être signée et inversion la taille des
deux intitulés, enfin la huitième, en 1694, atteint un total de mille cent vingt remarques.
Le portrait d’Arrias s’inscrit dans la section « De la société et de la conversation », et prend pour
modèle un portrait de Théophraste, « Le grand diseur », celui d’un bavard qu’il est impossible de faire
taire, qu’il amalgame avec un autre portrait « Du débit des nouvelles», qui, lui, dépeint un homme qui
se plaît à raconter des « faits remplis de fausseté ».
Comment la satire d’Arrias permet-elle de faire ressortir le comportement attendu de "l’honnête
homme" ?
1ère partie : un personnage-type (des lignes 1 à 3)
La démesure
Dès l’ouverture du portrait la démesure du personnage est mise en évidence, d’abord par rythme
binaire, avec le pronom répété et l’assonance : « Arrias a tout lu, a tout vu ». Le choix du passé composé,
temps de l’accompli, jouant avec le présent de l’énonciation dans la définition qui suit,
renforce l’assurance de ce bavard omniscient. Cela se trouve complété par l’adjectif ironique, qui
résume son caractère : « c’est un homme universel ». Cet excès est la première faille par rapport à
l’idéal de modération et d’équilibre en tout propre à "l’honnête homme".
Le masque arboré
Mais, parallèlement, La Bruyère fait de son personnage un acteur qui joue un rôle, car, tel le metteur
en scène dans la coulisse, il glisse dans cette brève présentation, deux indices qui révèlent qu’il s’agit
là d’une illusion, habilement construite : « il veut le persuader ainsi », « il se donne pour tel ». Puis
l’accusation se fait directe, avec un comparatif qui fait ressortir le défaut : « il aime mieux mentir que de
se taire ou de paraître ignorer quelque chose. » Les deux infinitifs, mis sur le même plan, semblent ainsi
synonymes, ce qui élargit le reproche : dans cette société mondaine, où seule compte l’apparence,
le silence – pourtant souhaitable pour l’homme sincère – n’est-il pas souvent assimilé à une coupable
ignorance, voire à de la sottise ?
2ème partie : la parole monopolisée (des lignes 3 à 8)
L'irrespect des bienséances
Après la présentation générale, le portrait se fait en action, dans une situation propre à la vie
mondaine du XVIIème siècle, « à la table d’un grand d’une cour du Nord », contexte qui devrait tout
particulièrement exiger le respect des bienséances, ensemble des codes de politesse qui régissent
la vie publique. Or, la prise de parole d’Arrias est doublement inconvenante, mise en valeur par la
présentation chronologiquement inversée : « il prend la parole », avec une brutalité illustrée par
l’allitération en [p], « il l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ». Dans son désir de briller,
d’attirer l’attention sur soi, il s’impose donc au premier plan, ce que souligne l’anaphore du pronom
sujet « il », et monopolise la conversation, ce que ne ferait en aucun cas "l’honnête homme" qui, lui,

veillerait à l’équilibre et la l’harmonie dans une assemblée. De plus, il n’est pas l’hôte, ce « grand »
auquel appartient, en principe, le rôle de diriger la conversation.
À cela s’ajoute son manque de discrétion, avec ce rire grossier amplifié par l’hyperbole : « il en rit
jusqu’à éclater ». Excessivement bruyant, il se fait remarquer mais surtout, plus grave encore, il s’est
coupé de son auditoire en se laissant emporter par ses propres paroles, qu’il « trouve plaisantes »,
jusqu’à rire « le premier » de ses « historiettes ». Isolé dans son narcissisme, c’est donc un conteur
maladroit, qui devance les réactions de ses auditeurs en étant d’abord à lui-même son propre public.
La prise de parole
Arrias est bien, pour reprendre le titre de Théophraste, un « grand parleur », défaut annoncé par le
verbe de parole introducteur, « il discourt », et reproduit par la structure même de la longue deuxième
phrase : l’asyndète, absence de liens, qui permet la parataxe, juxtaposition de courtes propositions,
donne l’impression que la parole du personnage a envahi tout l’espace, tel un flux que rien ne peut
arrêter. C’est aussi ce que traduit l’énumération des sujets abordés : « il discourt des mœurs de cette
cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes » Rien ne lui est étranger, du plus général
au plus particulier, jusqu’aux « historiettes », des anecdotes frivoles. Dans ce monologue semblable à
un récit de voyage, La Bruyère souligne à quel point tout est faux, « il s'oriente dans cette région
lointaine comme s'il en était originaire », et le choix du verbe « il récite » en fait une sorte de discours
artificiel, préparé, comme celui d’un acteur. Tout cela est l’exact opposé de la conversation attendue
d’un "honnête homme".
3ème partie : le mensonge (des lignes 8 à 14)
L'inconvenance grossière
Dans cette conversation, un élément perturbateur s’introduit, désigné par l’indéfini, « Quelqu’un », repris
par la périphrase péjorative, « l’interrupteur », qui se place du point de vue d’Arrias. Pourtant, face à
l’assurance de celui-ci, ce convive, lui, se montre discret, presque prudent, faisant preuve de calme
et de retenue, puisqu’il « se hasarde de la contredire », alors que le lexique choisi par La Bruyère insiste
sur le fait que son discours est porteur d’une vérité, martelée par les monosyllabes : il « lui prouve
nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies ». La réaction d’Arrias qui « ne se trouble point,
prend feu au contraire contre l’interrupteur », avec la métaphore guerrière qui illustre une violence
excessive, est donc d’autant plus choquante. A-t-il même écouté l’argumentation de son interlocuteur,
suggérée par le verbe « prouve » ? En fait, il n’accepte tout simplement pas que quelqu’un d’autre
que lui puisse se faire entendre.
Le mensonge
Le mensonge de sa riposte est mis en relief par le choix du discours rapporté directement. La litote
qui l’ouvre, « Je n'avance […], je ne raconte rien que je ne sache d'original », bien loin d’atténuer la
certitude du « je », en renforce le ton sec et péremptoire. Il s’agit bien, pour Arrias, de réduire à néant
la contradiction, ce qu’accentue l’ampleur de la phrase suivante. Pour soutenir son mensonge, il
mentionne d’abord un argument d’autorité, renforcé par le luxe de précisions apportées, preuve du
sérieux d’une véritable enquête : « je l'ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à Paris depuis quelques jours » Toujours pour se mettre en valeur et confirmer le mensonge,
tout en se posant en familier de l’ambassadeur, presqu’en confident, la phrase se déploie ensuite
en trois relatives en gradation : « que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a
caché aucune circonstance. » Vantard, loin de la modestie propre à "l'honnête homme", il compte
bien se faire ainsi valoir dans une société où comptent les fréquentations que l’on peut avoir.
4ème partie : la "chute" (de la ligne 14 à la fin)
Le portrait de La Bruyère, soucieux de plaire à ses lecteurs, se termine par une "chute", qui, par le
changement de temps, apporte une conclusion à cette scène. Elle fait sourire, car elle enlève le
masque que portait Arrias, dont le lecteur peut imaginer la honte subie.

Le comparatif, associé au contraste entre l’imparfait et le passé simple, accentue la brutalité de ce
retournement de situation, même si la neutralité du verbe « dire » suggère le ton calme et modéré
de l'intervenant : « Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencée,
lorsque l'un des conviés lui dit ». Le recours au discours direct donne plus de vie et de force à
l’intervention, tout en la rendant plaisante, car elle assène un coup définitif à ce bavard menteur en
le réduisant au silence. Le présentatif, « C’est Sethon », amplifie la révélation, ainsi que le pronom en
apposition, « lui-même », l’apogée étant atteint par la dernière précision apportée : « et qui arrive
fraîchement de son ambassade. »
En fait, cette "chute" révèle un ultime défaut d’Arrias, son manque de prudence, car il n’a pas pensé
une seule minute qu’un témoin pourrait le démentir.
CONCLUSION
Ce portrait compose une sorte de petite pièce de théâtre, où le personnage, d’abord présenté
rapidement, est ensuite, tel un acteur, mis en scène, puis il vit une péripétie, qui conduit au coup de
théâtre final. Le désir d’Arrias de jouer le premier rôledans cette situation mondaine où l’apparence
est un signe de qualité, mais aussi son amour-propre, le conduisent à dépasser les limites des
convenances sociales en même temps que celles de la morale et du bon sens. Inscrit dans une
époque, elle aussi critiquée pour sa superficialité, ce portrait, tout en faisant sourire le lecteur,
lui permet, par contrepoint, de dégager les critères de l’idéal de "l’honnête homme". Il a aussi une
fonction morale, puisque la vérité finit par triompher.
Ce texte pose aussi les caractéristiques de ce genre littéraire, le portrait, qui, par sa brièveté,
impose des contraintes : il doit capter immédiatement l’attention par son amorce, plaire au lecteur en
l’intriguant, enfin le surprendre, voire le faire sourire, par sa "chute". De plus, il combine, au XVIIème
siècle, la vraisemblance, règle de l’art classique, et la satire, d’où le difficile équilibre à trouver entre
les effets de réels (cadre spatio-temporel, gestes, ton, discours direct) et la nécessaire exagération
propre à la caricature.
1
/
3
100%